-
 Miroitement et reflet de la femme : histoire critique d'un motif
Miroitement et reflet de la femme : histoire critique d'un motif À la fois objet du quotidien et surface réfléchissante, au sens propre comme au figuré, le miroir accompagne depuis toujours la représentation de la femme. Plus qu’un simple objet, il ouvre une infinité de surfaces où se déploie le motif du reflet : dans l’eau, le verre, l’ombre, ou encore le regard. Reflet de soi ou regard de l’autre, trace d’une mémoire ou illusion d’une image, il traverse les siècles et les œuvres comme un lien fragile et chargé de sens.
Ce mémoire propose un travail propose une traversée critique, esthétique et symbolique de ce motif récurrent du reflet féminin, de l’Antiquité à nos jours. À travers la littérature, les arts visuels, la philosophie et les pensées féministes, il interroge ce que le miroir donne à voir, et à penser.
Reflet de soi, regard de l’autre, trace du passé ou outil de réinvention, le miroir devient un espace réflexif où s’articulent désir, mémoire, identité et pouvoir. De Narcisse au selfie d'aujourd'hui, le motif prend des sens différents : perte de liberté ou émancipation ; il idéalise, ou bien il critique…
Car le reflet n’est jamais neutre : c’est une surface symbolique, qui condense à la fois le regard porté sur la femme, le regard qu’elle porte sur elle-même, et le regard construit autour d’elle.
-
 Légitimité, éthique et possibilité de la relation intersubjective entre l’enseignant(e) et l’apprenant(e)
Légitimité, éthique et possibilité de la relation intersubjective entre l’enseignant(e) et l’apprenant(e) Il arrive que l'enseignant(e) se sente intimement investi(e) d'une mission pour des apprenant(e)s en particulier, qu'il(elle) veuille dépasser sa fonction pour se porter aux secours d'un(e) élève. Mais dans la quotidienneté de la vie des équipes pédagogiques, ces dépassements sont souvent vus comme un manque de professionnalisme, une sensibilité à refreiner, un danger pour l'équité dans le traitement des besoins de tou(te)s les apprenant(e)s et pour la cohésion de l'équipe pédagogique. Nous voudrions montrer dans ce travail qu'au contraire, la relation intersubjective attentionnée entre un enseignant(e) et un apprenant(e) est légitime et universalisable. Plutôt que la dissimuler, il serait plus juste de travailler à la rendre possible pour tous les apprenant(e)s et d'articuler cette justice dans la prise en compte d'une subjectivité avec la nécessité de justice dans l'égalité de traitement de tou(te)s les membres d'un groupe. Nous allons ainsi commencer par décrire les enjeux et limites de la relation entre l'enseignant(e) et ses apprenant(e)s dans la quotidienneté du groupe, puis nous montrerons la légitimité et l'universalité d'une relation intersubjective attentionnée dont nous formulerons ensuite une première éthique. Dans une dernière partie, à partir des concepts de "communauté pédagogique en portance" et de "responsabilisation agissante", nous formulerons quelques pistes pour rendre possible cette approche intersubjective tout en l'articulant avec les nécessités du groupe. Enfin, nous mettrons à l'épreuve ces concepts en les expérimentant avec une équipe pédagogique et en observant le travail d'un chorégraphe qui nous semble, dans son accompagnement de ses danseur(se)s, proche de ce rapport privilégié à l'apprenant(e).
-
 Récits de l'homosexualité masculine à l'épreuve du sida (Hervé Guibert, Edmund White)
Récits de l'homosexualité masculine à l'épreuve du sida (Hervé Guibert, Edmund White) Ce travail rend compte des différents récits de l'homosexualité masculine à l'épreuve du sida, avec un intérêt particulier pour les œuvres d'Hervé Guibert et Edmund White, ainsi que d'autres œuvres, la plupart en français, sur ce thème entre les années 1980 et 2000.
-
 Les tanks à l’assaut : think tanks, réseaux d’élites et gouvernance au Chili (1980-2024) : le Centre d’Études Publiques (CEP) et la Fondation pour le Progrès (FPP)
Les tanks à l’assaut : think tanks, réseaux d’élites et gouvernance au Chili (1980-2024) : le Centre d’Études Publiques (CEP) et la Fondation pour le Progrès (FPP) Ce mémoire examine le rôle des think tanks en tant qu’intermédiaires intellectuels dans la structuration des élites au Chili. Agissant comme des brokers entre les sphères académique, médiatique, économique et politique, ces institutions participent activement à la circulation des idées, à la production de récits légitimants et à la consolidation de coalitions idéologiques. En mobilisant une approche interdisciplinaire mêlant sociologie des élites, analyse de réseaux, méthodes numériques et analyse de discours, ce travail met en lumière les logiques de légitimation à l’œuvre dans le champ des idées pro-marché. L’analyse approfondie de deux think tanks majeurs – le Centre d’études publiques (CEP) et la Fundación para el Progreso (FPP) – s’appuie sur un corpus varié : cartographies relationnelles, archives numériques, productions médiatiques et interventions publiques.
Ce mémoire s’inscrit dans une réflexion plus large sur l’économie politique de la production intellectuelle, les circulations transnationales d’idées et la recomposition des élites chiliennes à la lumière du soulèvement social d’octobre 2019.
-
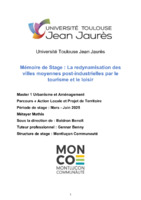 La redynamisation des villes moyennes post-industrielles par le tourisme et le loisir.
La redynamisation des villes moyennes post-industrielles par le tourisme et le loisir. Les villes moyennes en France sont nombreuses à avoir souffert du processus de désindustrialisation survenu à la fin du XXe siècle. Face à cela, certaines décident de se réinventer et de se construire une nouvelle image en partant de l'existant et en modifiant plus ou moins profondément les usages de ce dernier. Dans cette optique, le tourisme et le loisir semblent être des axes sur lesquels ces villes peuvent s'appuyer.
-
 L’école Réunionnaise, un levier de santé et d’égalité territoriale
L’école Réunionnaise, un levier de santé et d’égalité territoriale Ce mémoire a exploré un thème très actuel en cet été 2025, comment accompagner les transitions climatiques et sociales auxquels les territoires sont confrontés ? Existe-t-il une solution pour offrir aux habitants des espaces de soin et de vivre ensemble contribuant à leur bien-être individuelle et collectif ? Comment engager la population et les futures générations dans ces enjeux et à la prise de conscience ?
Cette analyse a été conduite sous le prisme de l'Urbanisme Favorable à la Santé. Cette approche novatrice intègre la dualité sanitaire. Au-delà de l'urbanisme pur ce mémoire tente de prouver, qu'impliquer un public vulnérable comme la jeunesse, les forme à une citoyenneté juvénile et à la résilience, cruciale pour les générations à venir. Au-delà, ce sont aussi les effets des projets sur le psychisme et le mental des usagers.
La Réunion fait partie des territoires insulaires ultramarins qui seront d'autant plus touchés par les transitions climatiques en raison de sa situation géographique (tropique du Capricorne). Il est donc crucial pour les pouvoirs publics d'anticiper ses résultantes. Nous verrons ensemble comment la vulnérabilité devient une force de transformation urbaine et sociale à travers l’imaginaire collectif des élèves, de leur besoin, de leur perception. Comment les écoles sont à en devenir des espaces de lieux de soin et d’éducation à la résilience et à la citoyenneté juvénile.
-
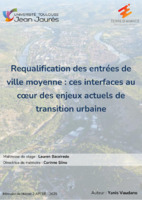 Requalification des entrées de ville moyenne : ces interfaces au cœur des enjeux actuels de transition urbaine
Requalification des entrées de ville moyenne : ces interfaces au cœur des enjeux actuels de transition urbaine Symboles d’un modèle urbanistique fonctionnaliste, les entrées de nos villes ont été, à partir des années 60, marquées par le développement soutenu de zones monofonctionnelles, dominées par de l'activités économiques commerciales. Ces espaces, peu qualitatifs d’un point de vue paysager, environnemental et accordant une place prépondérante à la voiture, souffrent d’un manque de vision globale, perdent progressivement en attractivité et sont de plus en plus dégradés. Traversés par une artificialisation massive, une faible optimisation foncière, ils ont largement transformé la physionomie de nos périphéries et concurrencé nos centres-villes. De plus, dans un contexte marqué par la baisse du pouvoir d’achat, d’évolution des comportements, des attentes et modes de consommation, de durcissement des exigences environnementales (ZAN, neutralité carbone, rénovation énergétique…), la requalification de ces entrées de ville moyenne n’a jamais été autant nécessaire et opportune. Répondant aux aspirations des nouvelles générations, ces dernières sont appelées à devenir de véritables quartiers mixtes, vivants et ouverts sur la ville. Ce passage « de la route au quartier » traduit un changement de paradigme, de lieux de consommation (aussi bien d’espaces que de biens) monofonctionnel à des centralités secondaires mixtes, soutenables et conviviales. Mais cette mutation ambitieuse se heurte à de nombreux défis : multiplicité des acteurs privés aux intérêts divergents, faible maîtrise foncière publique, des outils lourds ou inadaptés, complexité opérationnelle, difficultés budgétaires, complémentarité à réinterroger avec le centre-ville et le territoire...
Ce travail interroge la façon de repenser ces espaces pour les rendre plus conviviaux, attractifs et durables, tout en répondant aux enjeux de transitions urbaines et de sobriété foncière.
L’analyse repose d’abord sur une clarification des notions d’entrée de ville, abordée comme interface urbaine, avant d’examiner les dynamiques commerciales et les mutations sociétales. Cela nous a permis de mieux comprendre les enjeux majeurs de requalification, mais aussi les attentes et les aspirations grandissantes des français les concernant. Par la suite, nous avons identifié des leviers opérationnels, organisationnels... sur lesquels agir. Enfin, l’étude de cas de l’entrée sud de Cahors illustre la complexité des projets de requalification, la nécessité d’un pilotage public fort, d’une stratégie foncière partagée, d’un urbanisme négocié et la pertinence de mobiliser une approche paysagère. Ce mémoire met en lumière la nécessité de repenser ces espaces comme de véritables quartiers vivants et désirables, au service des habitants, des consommateurs et des transitions en cours. Il s'efforce également d’identifier les leviers, les outils et méthodes mobilisables pour parvenir à ces objectifs.
-
 La végétalisation des centres urbains dans un contexte de crise climatique
La végétalisation des centres urbains dans un contexte de crise climatique Le dérèglement climatique, accéléré par l’industrialisation et la surconsommation, est aujourd’hui l'un des principaux enjeux mondiaux aux conséquences irréversibles. Face à cette urgence, l’urbanisme devient un levier essentiel d’adaptation. À travers l’étude de la végétalisation urbaine ce mémoire s’interroge sur son rôle dans les centres urbains et les apports que celle-ci génère. S’appuyant sur une recherche bibliographique, un questionnaire citoyen et une étude de cas à Angers, il explore comment les politiques de végétalisation peuvent améliorer concrètement la qualité de vie en ville et répondre aux défis climatiques.
-
 Comment le réchauffement climatique au cours des années modifie-t-il la phénologie de ponte des mésanges le long d’un gradient altitudinal en montagne ?
Comment le réchauffement climatique au cours des années modifie-t-il la phénologie de ponte des mésanges le long d’un gradient altitudinal en montagne ? Ce mémoire a été écrit durant mes deux mois de stage de Master 1 “Gestion et évaluation des environnements montagnards” réalisé au sein de la station d’écologie théorique et expérimentale du CNRS, à Moulis en Ariège en 2025. Durant ce stage j’ai pu suivre le chercheur Alexis Chaine dans son travail sur les populations de mésanges dans les Pyrénées Ariégeoises.
On sait que le changement climatique impacte fortement la biodiversité et les écosystèmes des montagnes. Au cours des 10 dernières décennies, les températures dans ces régions ont augmenté deux fois plus vite que la moyenne mondiale. Dans les Pyrénées on évalue ce réchauffement entre 0,2 et 0,4 °C par décennie. Pourtant dans la recherche, les zones montagneuses sont plutôt sous représentées malgré le fort impact de ces changements environnementaux. C’est pourquoi dans ce mémoire je répondrai à la problématique suivante :
Comment le réchauffement climatique au cours des années modifie-t-il la phénologie
de ponte des mésanges le long d’un gradient altitudinal en montagne ?
Les résultats obtenus montrent une tendance générale à l’avancement des dates de ponte au cours des années, avec une moyenne de 0,27 jour plus précoce par an. Par ailleurs, l’analyse a révélé un effet significatif de l’altitude. Plus on monte en altitude, plus la date de ponte est retardée, avec un décalage moyen de 1,44 jour pour chaque 100 mètres supplémentaires. Ce résultat souligne le rôle structurant du gradient altitudinal.
De plus, le modèle intégrant l’interaction entre l’année et l’altitude révèle un point particulièrement intéressant. L’avancement des dates de ponte au fil du temps est d’autant plus marqué que l’altitude est élevée. Cela signifie que le réchauffement climatique a un impact différencié selon l’altitude, avec une accélération de la réponse phénologique des mésanges en haute montagne. Si nous prenons uniquement ce modèle pour des prédictions futures, on suppose que les mésanges de hautes altitudes pondront en même temps que celles des basses altitudes. Il est donc important de construire un modèle plus élaboré pour visualiser et prédire l’impact du réchauffement climatique sur la phénologie des mésanges. Ces études nous aident à comprendre ce qui se passera dans le temps à une échelle écosystémique montagnarde plus grande.
-
 Mise en place d'un sentier d'interprétation sur la tourbière des Moussels (11) : concilier pratiques agricoles, biodiversité et sensibilisation
Mise en place d'un sentier d'interprétation sur la tourbière des Moussels (11) : concilier pratiques agricoles, biodiversité et sensibilisation Dans le cadre du programme « Zone humide en Montagne Noire », fédérant plusieurs acteurs de l’environnement pour accompagner les agriculteurs dans leur gestion des zones humides sur leur exploitation, l’association Ecodiv, financée par le Département de l’Aude et l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, a restauré une grande partie de la tourbière des Moussels (11). Aujourd’hui, à la demande du Département, Ecodiv étudie ici l’installation potentielle d’un sentier d’interprétation, dans le but de valoriser cet habitat naturel rare et patrimonial.
Cette tourbière est une propriété privée de cinq hectares, appartenant au GAEC Lassalle, qui l’utilise quelques semaines par an pour faire pâturer des Gasconnes Pyrénéennes. De plus, la zone humide est classée ZNIEFF de type II, et Zone humide prioritaire par le SMMAR.
Ainsi, après plusieurs entretiens et visites de terrain, trois propositions de sentiers ont été conçues, permettant d’adapter le projet au financement qui sera débloqué.
Ce sentier permettra aux visiteurs de découvrir l’importance des zones humides et de leur conservation, au travers de divers panneaux disposés le long du sentier.
-
 Crise des financements publics : quels impacts sur les mouvements d’éducation populaire en Haute-Garonne ? Analyse de leur rôle structurant dans les territoires.
Crise des financements publics : quels impacts sur les mouvements d’éducation populaire en Haute-Garonne ? Analyse de leur rôle structurant dans les territoires. Depuis plusieurs années, le paysage associatif français évolue aux rythmes des contextes politiques, économiques et sociaux. Redéfinissant l’organisation des structures associatives, la France, dont l’organisation est fondée sur le principe de décentralisation, a vu se renforcer la délégation de compétences aux collectivités territoriales depuis 1982, et, plus récemment par la loi NOTRe en 2015. Si ces mutations ont permis de mieux adapter les politiques publiques aux réalités du terrain, elles se sont également accompagnées de transformations profondes des modalités de financement des associations. L’éducation populaire comme notion héritière de longs combats pour l'émancipation individuelle et collective se trouve aujourd’hui confrontée à une crise de financement sans précédent.
Dans ce contexte national, les fédérations d’éducation populaire doivent composer avec la précarisation de leurs ressources et de nouvelles manières de faire par les principes d’innovation sociale. À l’échelle locale, le département de la Haute-Garonne n’échappe pas à ces tensions. Actrices du développement local, les fédérations y constituent un maillage dense de structures animant la vie locale. Parmi elles, la Fédération Départementale des MJC 31 (FDMJC 31) créée en 1969. La FDMJC 31 regroupe aujourd’hui 35 MJC réparties sur l'ensemble du département et rassemble plus de 18 000 adhérents. Par son objet social et ses actions, elle favorise l’accès de toutes et tous à la culture, à l'éducation et au partage des savoirs sans condition. Pourtant, comme beaucoup d’autres fédérations, la FDMJC 31 fait face à une fragilisation de son modèle économique menaçant la pérennité de ses actions.
L’enjeu de ce mémoire est d’analyser comment ces fédérations parviennent à maintenir leur rôle essentiel sur les territoires et à y inventer de nouvelles formes d’actions collectives. Dans un contexte de crise, interroger l'impact de cette dernière sur les mouvements d’éducation populaire est nécessaire. Car, au-delà de leurs activités éducatives et culturelles, ces fédérations portent une vision de l’intérêt général et participent à un projet démocratique. Ainsi ce travail essaiera de répondre à la question suivante : Comment les fédérations d’éducation populaire réagissent elles à la crise actuelle et quel rôle continuent-elles à jouer dans leurs territoires ? Pour y parvenir, l’analyse s’appuiera sur l’exemple de la Haute-Garonne et sur l’étude plus approfondie des fédérations signataires d’une lettre ouverte d’interpellation collective. À travers l’analyse de leurs pratiques, stratégies d'adaptation et de leur engagement collectif, ce mémoire entend contribuer à une réflexion plus large sur l'avenir de l’éducation populaire et sur ses capacités de transformation face aux recompositions contemporaines de l’action publique.
-
 La voie verte : un compromis entre développement des mobilités actives, contraintes foncières et réalités économiques
La voie verte : un compromis entre développement des mobilités actives, contraintes foncières et réalités économiques Ce mémoire est issu d’un stage de quatre mois effectué au sein du service voirie du Muretain Agglo. Il aborde la question des voies vertes, aménagement de plus en plus utilisé pour développer la cyclabilité d’un territoire.
Le développement du vélo est un enjeu central sur le territoire du Muretain Agglo afin de contenir la congestion routière et réduire les émissions de Gaz à Effet de Serre. Pour favoriser ce mode, il est nécessaire de créer de nouveaux aménagements cyclables sécurisés, confortables et continus. Dans le cadre de sa politique cyclable, pour faire face aux contraintes économiques et d’emprises spatiales, le Muretain Agglo choisit de miser en grande partie sur un type d’aménagement : la voie verte.
La voie verte, aménagement mixte piétons-cycles, est un aménagement sécuritaire car séparé de la chaussée. Aujourd’hui, cet aménagement se trouve davantage dans les territoires périurbains car il s’intègre dans un environnement faiblement urbanisé afin d’offrir un cadre agréable pour une pratique cyclable récréative. Toutefois, cet usage de la voie verte tend, au sein du Muretain Agglo, à se renouveler grâce au caractère sécuritaire que cet aménagement peut apporter pour les trajets utilitaires. La diversification des usages de la voie verte permet alors d’accueillir une diversité d’usagers, impliquant de la cohabitation non seulement entre les différents modes mais aussi entre les différentes pratiques. Cette cohabitation est souvent source de conflits d’usage, représentant ainsi un risque de freins au développement du vélo. Toutefois, ces conflits sont surtout présents quand la largeur n’est pas suffisante par rapport aux nombres d’usagers. Sachant, que les mobilités actives restent encore peu développées sur le territoire, le risque que la voie verte soit un frein à la cyclabilité reste minime à l’heure actuelle.
La voie verte reste alors un aménagement pertinent pour favoriser le vélo à l’échelle du Muretain Agglo, mais il est toutefois nécessaire de l’adapter aux spécificités territoriales et aux besoins présents et futurs des usagers.
-
 Faire cohabiter les mobilités dans une ville urbaine dense : vers un partage équilibré de l’espace public à Vincennes
Faire cohabiter les mobilités dans une ville urbaine dense : vers un partage équilibré de l’espace public à Vincennes Ce mémoire analyse comment adapter un document d'information de bonne conduite dans l'espace public, le Code de la rue aux spécificités urbaines, sociales et de mobilité de Vincennes, afin d’en faire un levier efficace pour optimiser la cohabitation des modes de transport dans l’espace public vincennois. Il approfondit l'étude des enjeux de la mobilité dans l'espace public pour construire le mieux possible un document propre à la population.
-
 Narration sensible
Narration sensible La standardisation est un phénomène mondial qui touche un grand
nombre de secteurs et a un impact significatif sur notre quotidien.
Que ce soit en matière d’objets, de loisirs ou encore d’espaces, elle
est omniprésente et influence notre manière de vivre, de percevoir,
et d’interagir avec notre environnement. Dans le cadre de mes
recherches, il me semble pertinent d’ interroger la standardisation des
espaces verts. À travers ma pratique de designer paysagiste, je cherche
à proposer une vision plus sensible, en essayant de créer une relation
entre celui qui contemple et ce qui est contemplé. La spécificité de mon
approche repose sur ce qui constitue le fondement même du design,
placer l’humain au cœur du processus de recherche et de création.
Par la suite, j’utilise ma pratique pour observer et comprendre
l’existant, tout en m’interrogeant sur les mécanismes qui conduisent
les espaces verts à devenir, progressivement, des lieux standardisés.
Mon objectif est d’explorer comment, en s’affranchissant de certains
cadres normatifs, il est possible de concevoir des espaces porteurs
de sens, capables de générer une expérience à la fois émotionnelle,
physique et sensorielle afin de re-proposer un dialogue vivant entre
l’homme et son paysage.
-
 Les gardiens du tan
Les gardiens du tan Ce mémoire explore comment les passionnés de l’histoire des tanneries et les initiatives autour des anciennes tanneries de la Sarthe peuvent contribuer à l’attractivité des territoires. Au-delà d’une simple valorisation patrimoniale institutionnelle, il s’agit d’un engagement profond pour redonner vie à une mémoire ouvrière longtemps laissée de côté. Cette étude interroge aussi comment la mémoire du tannage peut devenir un levier de valorisation culturelle et territoriale. Elle révèle modestement un réseau discret d’acteurs engagés dans la reconnaissance et la réappropriation de leur patrimoine, fondées sur la mémoire ouvrière, l’identité locale et le vécu des habitants.
-
 À la rencontre des parents et de soi dans le récit de filiation contemporain (avec un corpus de quatre textes contemporains)
À la rencontre des parents et de soi dans le récit de filiation contemporain (avec un corpus de quatre textes contemporains) Cette thèse explore le récit de filiation contemporain à travers quatre textes : La personne qui m’aimait le plus au monde est partie de Zhang Jie, Une Femme d’Annie Ernaux, La Reine du silence de Marie Nimier et Lettre morte de Linda Lê. Le récit de filiation contemporain, une écriture émergente depuis les années 1980, est caractérisé par l’exploration de l’héritage familial et des dynamiques entre générations. Ce genre de textes, selon Dominique Viart, constitue une nouvelle forme d’écriture de soi, distincte de l’autobiographie traditionnelle, souvent sous la forme d’enquête et de recueil plutôt que de narration linéaire. Les quatre écrivaines représentent une diversité d’identités, qu’il s’agisse d’une écrivaine chinoise couronnée deux fois du Prix littéraire Mao Dun, d’une lauréate française du Prix Nobel de littérature, d’une écrivaine dont le père est un auteur célèbre et encore d’une écrivaine d’origine vietnamienne. Leur diversité d’expériences enrichit les récits qu’elles proposent, permettant d’aborder des thèmes complexes comme l’absence, la culpabilité, l’identité et les relations familiales. À travers cinq chapitres, cette thèse examine les stratégies textuelles utilisées dans le récit, les lettres et la maison familiale – ces éléments récurrents qui servent de points d’ancrage pour des sujets en quête de leurs racines –, les témoignages et les rêves qui enrichissent les récits en apportant des perspectives extérieures et des dimensions imaginaires, l’absence et l’oubli qui compliquent ces récits, enfin la quête des parents et de soi qui sont l’objectif principal. La thèse vise à éclairer comment le récit de filiation permet de construire un pont entre le passé et le présent, et comment la quête des ancêtres révèle des aspects cachés de soi-même. En examinant ces récits sous divers angles, la recherche contribue à une compréhension plus approfondie du genre et de ses spécificités dans le contexte littéraire contemporain.
-
 Accessibilité et communs de la connaissance : le professeur documentaliste, artisan de l'exigence politique de l'Ecole
Accessibilité et communs de la connaissance : le professeur documentaliste, artisan de l'exigence politique de l'Ecole La notion du « vivre-ensemble » est parfois moquée. Les discours politiques et institutionnels en ont épuisé le sens en l’associant à des verbes d’action. « Favoriser », « promouvoir », « construire », « développer », « encourager » ont fini par en faire un prêt-à-penser pratique que l’on n’a plus besoin de questionner. Jusqu’à ce que plus personne ne comprenne concrètement de quoi il s’agit. Répétées, usées et éculées dans une succession de rapports, de vademecums et de supports de communication, ces expressions ont vidé le vivre-ensemble de son assise philosophique, de son substrat politique.
Pourtant, tout nouvel enseignant qui intègre d’Éducation nationale et qui est affecté dans un établissement scolaire, sait à quel point le vivre-ensemble n’est pas qu’un outil de communication. L’École publique et républicaine est la seule à accueillir tous les élèves sans distinction d’origine sociale ou de niveau de réussite scolaire des élèves. Le vivre-ensemble n’est donc pas qu’un décorum ; il nourrit nos gestes professionnels et soutient l’exercice même de nos missions. Il nous rappelle que l’École joue un rôle politique fondamental.
Dans un premier temps seront présentés le rôle du professeur documentaliste et l’exigence politique de l’École. En interrogeant la circulaire de mission et l’histoire des Centres de Documentation et d’Information, il s’agira de faire apparaître le rôle hybride des professeurs documentalistes. L’exigence politique de l’École sera définie et pensée à travers les textes juridiques tout en convoquant la philosophe Hannah Arendt pour lier cette exigence à la nécessité d’élaborer un monde commun.
Dans un second temps, seront présentés la conception universelle des apprentissages et les communs de la connaissance pour comprendre en quoi ces approches peuvent nous aider à penser nos cadres pédagogiques et éducatifs. En favorisant l’émergence d’une éducation inclusive et coopérative, ces approches nous permettent d’envisager notre pratique comme une contribution active à l’ambition politique de l’École.
-
 Les femmes noires et l'avortement dans le Sud des Etats-Unis après Roe v. Wade.
Les femmes noires et l'avortement dans le Sud des Etats-Unis après Roe v. Wade. L’objectif de ce mémoire est de démontrer que les femmes noires ne bénéficiaient pas du même accès à l’avortement que les femmes blanches, et d’analyser les différentes causes expliquant cette inégalité.
-
 Le Féminin Divin dans Les Récits d'îles de Lawrence Durrell
Le Féminin Divin dans Les Récits d'îles de Lawrence Durrell Ce mémoire porte sur une analyse de la représentation du féminin sacré dans la trilogie des récits de voyages de Lawrence Durrell : Prospero’s Cell, Reflections on a Marine Venus et Bitter Lemons of Cyprus. L’étude commence par replacer ces œuvres dans le contexte du genre du récit de voyage, qui relie entre fiction et réalité, introspection et témoignage historique. Durrell, écrivain influencé par le modernisme et le postmodernisme, explore les îles méditerranéennes comme des lieux de transformation personnelle et spirituelle. Ensuite, l’étude examine comment Durrell utilise un langage poétique pour construire des liens intimes avec le paysage, souvent féminisé, et comment les îles deviennent des entités presque humaines, parfois inspirées par des divinités grecques. Le féminin est perçu comme sacré, omniprésent et complexe : à la fois sensuel, spirituel et métaphysique. Enfin, l’analyse souligne le décalage entre les représentations du féminin et des femmes ainsi que les tensions entre l’imaginaire romantique des îles et les réalités coloniales dans lesquelles s’inscrivent les récits de Durrell, tout en réévaluant son positionnement entre orientaliste et poète exilé.
-
 L'enfant dans l'oeuvre de Mo Yan
L'enfant dans l'oeuvre de Mo Yan Le personnage enfant ou le narrateur enfant dans un texte littéraire soulève plusieurs questions complexes, à la fois sur le plan thématique et narratif – questions qui méritent d’être étudiés de près. Qu’il soit un symbole d’innocence et de pureté, un témoin de violence et de trauma, un critique social et politique ou un vecteur de mémoire et de nostalgie, l’enfant enrichit singulièrement le récit et invite à une réflexion profonde. Dans la littérature chinoise contemporaine, Mo Yan, lauréat de prix Nobel de littérature en 2012, utilise fréquemment des enfants dans ses récits. La présence marquée des enfants chez lui est un choix qui touche à la fois à sa vision artistique et à ses préoccupations sociales. Ainsi, nous nous demandons comment et pourquoi l’enfant, en tant que personnage ou narrateur, joue un rôle central dans l’œuvre de Mo Yan, et comment cette représentation reflète les tensions sociales et historiques de la Chine contemporaine ? La problématique qui guide notre analyse de l’existence de l’enfant chez Mo Yan, consiste à explorer la manière dont l’auteur se sert de cette figure pour traiter des thèmes complexes, créer une perspective unique et susciter des réactions émotionnelles chez le lecteur. Ainsi, nous avons abordé l’étude de l’enfant sous deux perspectives distinctes, d’une part, en examinant les thèmes liés au personnage enfant et d’autre part, en analysant le rôle du narrateur enfant dans les nouvelles et les romans de Mo Yan où sa présence est significative. Sont notamment étudiées : la représentation de l’enfant, y compris sa dénomination, sa typologie et ses caractéristiques physiques remarquables, l’utilisation de la perspective de l’enfant, sa voix et sa parole, enfin la perspective du lecteur.
 Miroitement et reflet de la femme : histoire critique d'un motif À la fois objet du quotidien et surface réfléchissante, au sens propre comme au figuré, le miroir accompagne depuis toujours la représentation de la femme. Plus qu’un simple objet, il ouvre une infinité de surfaces où se déploie le motif du reflet : dans l’eau, le verre, l’ombre, ou encore le regard. Reflet de soi ou regard de l’autre, trace d’une mémoire ou illusion d’une image, il traverse les siècles et les œuvres comme un lien fragile et chargé de sens. Ce mémoire propose un travail propose une traversée critique, esthétique et symbolique de ce motif récurrent du reflet féminin, de l’Antiquité à nos jours. À travers la littérature, les arts visuels, la philosophie et les pensées féministes, il interroge ce que le miroir donne à voir, et à penser. Reflet de soi, regard de l’autre, trace du passé ou outil de réinvention, le miroir devient un espace réflexif où s’articulent désir, mémoire, identité et pouvoir. De Narcisse au selfie d'aujourd'hui, le motif prend des sens différents : perte de liberté ou émancipation ; il idéalise, ou bien il critique… Car le reflet n’est jamais neutre : c’est une surface symbolique, qui condense à la fois le regard porté sur la femme, le regard qu’elle porte sur elle-même, et le regard construit autour d’elle.
Miroitement et reflet de la femme : histoire critique d'un motif À la fois objet du quotidien et surface réfléchissante, au sens propre comme au figuré, le miroir accompagne depuis toujours la représentation de la femme. Plus qu’un simple objet, il ouvre une infinité de surfaces où se déploie le motif du reflet : dans l’eau, le verre, l’ombre, ou encore le regard. Reflet de soi ou regard de l’autre, trace d’une mémoire ou illusion d’une image, il traverse les siècles et les œuvres comme un lien fragile et chargé de sens. Ce mémoire propose un travail propose une traversée critique, esthétique et symbolique de ce motif récurrent du reflet féminin, de l’Antiquité à nos jours. À travers la littérature, les arts visuels, la philosophie et les pensées féministes, il interroge ce que le miroir donne à voir, et à penser. Reflet de soi, regard de l’autre, trace du passé ou outil de réinvention, le miroir devient un espace réflexif où s’articulent désir, mémoire, identité et pouvoir. De Narcisse au selfie d'aujourd'hui, le motif prend des sens différents : perte de liberté ou émancipation ; il idéalise, ou bien il critique… Car le reflet n’est jamais neutre : c’est une surface symbolique, qui condense à la fois le regard porté sur la femme, le regard qu’elle porte sur elle-même, et le regard construit autour d’elle. Légitimité, éthique et possibilité de la relation intersubjective entre l’enseignant(e) et l’apprenant(e) Il arrive que l'enseignant(e) se sente intimement investi(e) d'une mission pour des apprenant(e)s en particulier, qu'il(elle) veuille dépasser sa fonction pour se porter aux secours d'un(e) élève. Mais dans la quotidienneté de la vie des équipes pédagogiques, ces dépassements sont souvent vus comme un manque de professionnalisme, une sensibilité à refreiner, un danger pour l'équité dans le traitement des besoins de tou(te)s les apprenant(e)s et pour la cohésion de l'équipe pédagogique. Nous voudrions montrer dans ce travail qu'au contraire, la relation intersubjective attentionnée entre un enseignant(e) et un apprenant(e) est légitime et universalisable. Plutôt que la dissimuler, il serait plus juste de travailler à la rendre possible pour tous les apprenant(e)s et d'articuler cette justice dans la prise en compte d'une subjectivité avec la nécessité de justice dans l'égalité de traitement de tou(te)s les membres d'un groupe. Nous allons ainsi commencer par décrire les enjeux et limites de la relation entre l'enseignant(e) et ses apprenant(e)s dans la quotidienneté du groupe, puis nous montrerons la légitimité et l'universalité d'une relation intersubjective attentionnée dont nous formulerons ensuite une première éthique. Dans une dernière partie, à partir des concepts de "communauté pédagogique en portance" et de "responsabilisation agissante", nous formulerons quelques pistes pour rendre possible cette approche intersubjective tout en l'articulant avec les nécessités du groupe. Enfin, nous mettrons à l'épreuve ces concepts en les expérimentant avec une équipe pédagogique et en observant le travail d'un chorégraphe qui nous semble, dans son accompagnement de ses danseur(se)s, proche de ce rapport privilégié à l'apprenant(e).
Légitimité, éthique et possibilité de la relation intersubjective entre l’enseignant(e) et l’apprenant(e) Il arrive que l'enseignant(e) se sente intimement investi(e) d'une mission pour des apprenant(e)s en particulier, qu'il(elle) veuille dépasser sa fonction pour se porter aux secours d'un(e) élève. Mais dans la quotidienneté de la vie des équipes pédagogiques, ces dépassements sont souvent vus comme un manque de professionnalisme, une sensibilité à refreiner, un danger pour l'équité dans le traitement des besoins de tou(te)s les apprenant(e)s et pour la cohésion de l'équipe pédagogique. Nous voudrions montrer dans ce travail qu'au contraire, la relation intersubjective attentionnée entre un enseignant(e) et un apprenant(e) est légitime et universalisable. Plutôt que la dissimuler, il serait plus juste de travailler à la rendre possible pour tous les apprenant(e)s et d'articuler cette justice dans la prise en compte d'une subjectivité avec la nécessité de justice dans l'égalité de traitement de tou(te)s les membres d'un groupe. Nous allons ainsi commencer par décrire les enjeux et limites de la relation entre l'enseignant(e) et ses apprenant(e)s dans la quotidienneté du groupe, puis nous montrerons la légitimité et l'universalité d'une relation intersubjective attentionnée dont nous formulerons ensuite une première éthique. Dans une dernière partie, à partir des concepts de "communauté pédagogique en portance" et de "responsabilisation agissante", nous formulerons quelques pistes pour rendre possible cette approche intersubjective tout en l'articulant avec les nécessités du groupe. Enfin, nous mettrons à l'épreuve ces concepts en les expérimentant avec une équipe pédagogique et en observant le travail d'un chorégraphe qui nous semble, dans son accompagnement de ses danseur(se)s, proche de ce rapport privilégié à l'apprenant(e). Récits de l'homosexualité masculine à l'épreuve du sida (Hervé Guibert, Edmund White) Ce travail rend compte des différents récits de l'homosexualité masculine à l'épreuve du sida, avec un intérêt particulier pour les œuvres d'Hervé Guibert et Edmund White, ainsi que d'autres œuvres, la plupart en français, sur ce thème entre les années 1980 et 2000.
Récits de l'homosexualité masculine à l'épreuve du sida (Hervé Guibert, Edmund White) Ce travail rend compte des différents récits de l'homosexualité masculine à l'épreuve du sida, avec un intérêt particulier pour les œuvres d'Hervé Guibert et Edmund White, ainsi que d'autres œuvres, la plupart en français, sur ce thème entre les années 1980 et 2000. Les tanks à l’assaut : think tanks, réseaux d’élites et gouvernance au Chili (1980-2024) : le Centre d’Études Publiques (CEP) et la Fondation pour le Progrès (FPP) Ce mémoire examine le rôle des think tanks en tant qu’intermédiaires intellectuels dans la structuration des élites au Chili. Agissant comme des brokers entre les sphères académique, médiatique, économique et politique, ces institutions participent activement à la circulation des idées, à la production de récits légitimants et à la consolidation de coalitions idéologiques. En mobilisant une approche interdisciplinaire mêlant sociologie des élites, analyse de réseaux, méthodes numériques et analyse de discours, ce travail met en lumière les logiques de légitimation à l’œuvre dans le champ des idées pro-marché. L’analyse approfondie de deux think tanks majeurs – le Centre d’études publiques (CEP) et la Fundación para el Progreso (FPP) – s’appuie sur un corpus varié : cartographies relationnelles, archives numériques, productions médiatiques et interventions publiques. Ce mémoire s’inscrit dans une réflexion plus large sur l’économie politique de la production intellectuelle, les circulations transnationales d’idées et la recomposition des élites chiliennes à la lumière du soulèvement social d’octobre 2019.
Les tanks à l’assaut : think tanks, réseaux d’élites et gouvernance au Chili (1980-2024) : le Centre d’Études Publiques (CEP) et la Fondation pour le Progrès (FPP) Ce mémoire examine le rôle des think tanks en tant qu’intermédiaires intellectuels dans la structuration des élites au Chili. Agissant comme des brokers entre les sphères académique, médiatique, économique et politique, ces institutions participent activement à la circulation des idées, à la production de récits légitimants et à la consolidation de coalitions idéologiques. En mobilisant une approche interdisciplinaire mêlant sociologie des élites, analyse de réseaux, méthodes numériques et analyse de discours, ce travail met en lumière les logiques de légitimation à l’œuvre dans le champ des idées pro-marché. L’analyse approfondie de deux think tanks majeurs – le Centre d’études publiques (CEP) et la Fundación para el Progreso (FPP) – s’appuie sur un corpus varié : cartographies relationnelles, archives numériques, productions médiatiques et interventions publiques. Ce mémoire s’inscrit dans une réflexion plus large sur l’économie politique de la production intellectuelle, les circulations transnationales d’idées et la recomposition des élites chiliennes à la lumière du soulèvement social d’octobre 2019.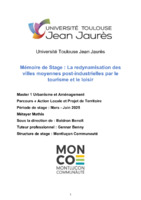 La redynamisation des villes moyennes post-industrielles par le tourisme et le loisir. Les villes moyennes en France sont nombreuses à avoir souffert du processus de désindustrialisation survenu à la fin du XXe siècle. Face à cela, certaines décident de se réinventer et de se construire une nouvelle image en partant de l'existant et en modifiant plus ou moins profondément les usages de ce dernier. Dans cette optique, le tourisme et le loisir semblent être des axes sur lesquels ces villes peuvent s'appuyer.
La redynamisation des villes moyennes post-industrielles par le tourisme et le loisir. Les villes moyennes en France sont nombreuses à avoir souffert du processus de désindustrialisation survenu à la fin du XXe siècle. Face à cela, certaines décident de se réinventer et de se construire une nouvelle image en partant de l'existant et en modifiant plus ou moins profondément les usages de ce dernier. Dans cette optique, le tourisme et le loisir semblent être des axes sur lesquels ces villes peuvent s'appuyer. L’école Réunionnaise, un levier de santé et d’égalité territoriale Ce mémoire a exploré un thème très actuel en cet été 2025, comment accompagner les transitions climatiques et sociales auxquels les territoires sont confrontés ? Existe-t-il une solution pour offrir aux habitants des espaces de soin et de vivre ensemble contribuant à leur bien-être individuelle et collectif ? Comment engager la population et les futures générations dans ces enjeux et à la prise de conscience ? Cette analyse a été conduite sous le prisme de l'Urbanisme Favorable à la Santé. Cette approche novatrice intègre la dualité sanitaire. Au-delà de l'urbanisme pur ce mémoire tente de prouver, qu'impliquer un public vulnérable comme la jeunesse, les forme à une citoyenneté juvénile et à la résilience, cruciale pour les générations à venir. Au-delà, ce sont aussi les effets des projets sur le psychisme et le mental des usagers. La Réunion fait partie des territoires insulaires ultramarins qui seront d'autant plus touchés par les transitions climatiques en raison de sa situation géographique (tropique du Capricorne). Il est donc crucial pour les pouvoirs publics d'anticiper ses résultantes. Nous verrons ensemble comment la vulnérabilité devient une force de transformation urbaine et sociale à travers l’imaginaire collectif des élèves, de leur besoin, de leur perception. Comment les écoles sont à en devenir des espaces de lieux de soin et d’éducation à la résilience et à la citoyenneté juvénile.
L’école Réunionnaise, un levier de santé et d’égalité territoriale Ce mémoire a exploré un thème très actuel en cet été 2025, comment accompagner les transitions climatiques et sociales auxquels les territoires sont confrontés ? Existe-t-il une solution pour offrir aux habitants des espaces de soin et de vivre ensemble contribuant à leur bien-être individuelle et collectif ? Comment engager la population et les futures générations dans ces enjeux et à la prise de conscience ? Cette analyse a été conduite sous le prisme de l'Urbanisme Favorable à la Santé. Cette approche novatrice intègre la dualité sanitaire. Au-delà de l'urbanisme pur ce mémoire tente de prouver, qu'impliquer un public vulnérable comme la jeunesse, les forme à une citoyenneté juvénile et à la résilience, cruciale pour les générations à venir. Au-delà, ce sont aussi les effets des projets sur le psychisme et le mental des usagers. La Réunion fait partie des territoires insulaires ultramarins qui seront d'autant plus touchés par les transitions climatiques en raison de sa situation géographique (tropique du Capricorne). Il est donc crucial pour les pouvoirs publics d'anticiper ses résultantes. Nous verrons ensemble comment la vulnérabilité devient une force de transformation urbaine et sociale à travers l’imaginaire collectif des élèves, de leur besoin, de leur perception. Comment les écoles sont à en devenir des espaces de lieux de soin et d’éducation à la résilience et à la citoyenneté juvénile.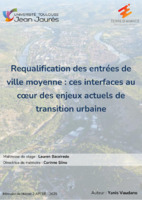 Requalification des entrées de ville moyenne : ces interfaces au cœur des enjeux actuels de transition urbaine Symboles d’un modèle urbanistique fonctionnaliste, les entrées de nos villes ont été, à partir des années 60, marquées par le développement soutenu de zones monofonctionnelles, dominées par de l'activités économiques commerciales. Ces espaces, peu qualitatifs d’un point de vue paysager, environnemental et accordant une place prépondérante à la voiture, souffrent d’un manque de vision globale, perdent progressivement en attractivité et sont de plus en plus dégradés. Traversés par une artificialisation massive, une faible optimisation foncière, ils ont largement transformé la physionomie de nos périphéries et concurrencé nos centres-villes. De plus, dans un contexte marqué par la baisse du pouvoir d’achat, d’évolution des comportements, des attentes et modes de consommation, de durcissement des exigences environnementales (ZAN, neutralité carbone, rénovation énergétique…), la requalification de ces entrées de ville moyenne n’a jamais été autant nécessaire et opportune. Répondant aux aspirations des nouvelles générations, ces dernières sont appelées à devenir de véritables quartiers mixtes, vivants et ouverts sur la ville. Ce passage « de la route au quartier » traduit un changement de paradigme, de lieux de consommation (aussi bien d’espaces que de biens) monofonctionnel à des centralités secondaires mixtes, soutenables et conviviales. Mais cette mutation ambitieuse se heurte à de nombreux défis : multiplicité des acteurs privés aux intérêts divergents, faible maîtrise foncière publique, des outils lourds ou inadaptés, complexité opérationnelle, difficultés budgétaires, complémentarité à réinterroger avec le centre-ville et le territoire... Ce travail interroge la façon de repenser ces espaces pour les rendre plus conviviaux, attractifs et durables, tout en répondant aux enjeux de transitions urbaines et de sobriété foncière. L’analyse repose d’abord sur une clarification des notions d’entrée de ville, abordée comme interface urbaine, avant d’examiner les dynamiques commerciales et les mutations sociétales. Cela nous a permis de mieux comprendre les enjeux majeurs de requalification, mais aussi les attentes et les aspirations grandissantes des français les concernant. Par la suite, nous avons identifié des leviers opérationnels, organisationnels... sur lesquels agir. Enfin, l’étude de cas de l’entrée sud de Cahors illustre la complexité des projets de requalification, la nécessité d’un pilotage public fort, d’une stratégie foncière partagée, d’un urbanisme négocié et la pertinence de mobiliser une approche paysagère. Ce mémoire met en lumière la nécessité de repenser ces espaces comme de véritables quartiers vivants et désirables, au service des habitants, des consommateurs et des transitions en cours. Il s'efforce également d’identifier les leviers, les outils et méthodes mobilisables pour parvenir à ces objectifs.
Requalification des entrées de ville moyenne : ces interfaces au cœur des enjeux actuels de transition urbaine Symboles d’un modèle urbanistique fonctionnaliste, les entrées de nos villes ont été, à partir des années 60, marquées par le développement soutenu de zones monofonctionnelles, dominées par de l'activités économiques commerciales. Ces espaces, peu qualitatifs d’un point de vue paysager, environnemental et accordant une place prépondérante à la voiture, souffrent d’un manque de vision globale, perdent progressivement en attractivité et sont de plus en plus dégradés. Traversés par une artificialisation massive, une faible optimisation foncière, ils ont largement transformé la physionomie de nos périphéries et concurrencé nos centres-villes. De plus, dans un contexte marqué par la baisse du pouvoir d’achat, d’évolution des comportements, des attentes et modes de consommation, de durcissement des exigences environnementales (ZAN, neutralité carbone, rénovation énergétique…), la requalification de ces entrées de ville moyenne n’a jamais été autant nécessaire et opportune. Répondant aux aspirations des nouvelles générations, ces dernières sont appelées à devenir de véritables quartiers mixtes, vivants et ouverts sur la ville. Ce passage « de la route au quartier » traduit un changement de paradigme, de lieux de consommation (aussi bien d’espaces que de biens) monofonctionnel à des centralités secondaires mixtes, soutenables et conviviales. Mais cette mutation ambitieuse se heurte à de nombreux défis : multiplicité des acteurs privés aux intérêts divergents, faible maîtrise foncière publique, des outils lourds ou inadaptés, complexité opérationnelle, difficultés budgétaires, complémentarité à réinterroger avec le centre-ville et le territoire... Ce travail interroge la façon de repenser ces espaces pour les rendre plus conviviaux, attractifs et durables, tout en répondant aux enjeux de transitions urbaines et de sobriété foncière. L’analyse repose d’abord sur une clarification des notions d’entrée de ville, abordée comme interface urbaine, avant d’examiner les dynamiques commerciales et les mutations sociétales. Cela nous a permis de mieux comprendre les enjeux majeurs de requalification, mais aussi les attentes et les aspirations grandissantes des français les concernant. Par la suite, nous avons identifié des leviers opérationnels, organisationnels... sur lesquels agir. Enfin, l’étude de cas de l’entrée sud de Cahors illustre la complexité des projets de requalification, la nécessité d’un pilotage public fort, d’une stratégie foncière partagée, d’un urbanisme négocié et la pertinence de mobiliser une approche paysagère. Ce mémoire met en lumière la nécessité de repenser ces espaces comme de véritables quartiers vivants et désirables, au service des habitants, des consommateurs et des transitions en cours. Il s'efforce également d’identifier les leviers, les outils et méthodes mobilisables pour parvenir à ces objectifs. La végétalisation des centres urbains dans un contexte de crise climatique Le dérèglement climatique, accéléré par l’industrialisation et la surconsommation, est aujourd’hui l'un des principaux enjeux mondiaux aux conséquences irréversibles. Face à cette urgence, l’urbanisme devient un levier essentiel d’adaptation. À travers l’étude de la végétalisation urbaine ce mémoire s’interroge sur son rôle dans les centres urbains et les apports que celle-ci génère. S’appuyant sur une recherche bibliographique, un questionnaire citoyen et une étude de cas à Angers, il explore comment les politiques de végétalisation peuvent améliorer concrètement la qualité de vie en ville et répondre aux défis climatiques.
La végétalisation des centres urbains dans un contexte de crise climatique Le dérèglement climatique, accéléré par l’industrialisation et la surconsommation, est aujourd’hui l'un des principaux enjeux mondiaux aux conséquences irréversibles. Face à cette urgence, l’urbanisme devient un levier essentiel d’adaptation. À travers l’étude de la végétalisation urbaine ce mémoire s’interroge sur son rôle dans les centres urbains et les apports que celle-ci génère. S’appuyant sur une recherche bibliographique, un questionnaire citoyen et une étude de cas à Angers, il explore comment les politiques de végétalisation peuvent améliorer concrètement la qualité de vie en ville et répondre aux défis climatiques. Comment le réchauffement climatique au cours des années modifie-t-il la phénologie de ponte des mésanges le long d’un gradient altitudinal en montagne ? Ce mémoire a été écrit durant mes deux mois de stage de Master 1 “Gestion et évaluation des environnements montagnards” réalisé au sein de la station d’écologie théorique et expérimentale du CNRS, à Moulis en Ariège en 2025. Durant ce stage j’ai pu suivre le chercheur Alexis Chaine dans son travail sur les populations de mésanges dans les Pyrénées Ariégeoises. On sait que le changement climatique impacte fortement la biodiversité et les écosystèmes des montagnes. Au cours des 10 dernières décennies, les températures dans ces régions ont augmenté deux fois plus vite que la moyenne mondiale. Dans les Pyrénées on évalue ce réchauffement entre 0,2 et 0,4 °C par décennie. Pourtant dans la recherche, les zones montagneuses sont plutôt sous représentées malgré le fort impact de ces changements environnementaux. C’est pourquoi dans ce mémoire je répondrai à la problématique suivante : Comment le réchauffement climatique au cours des années modifie-t-il la phénologie de ponte des mésanges le long d’un gradient altitudinal en montagne ? Les résultats obtenus montrent une tendance générale à l’avancement des dates de ponte au cours des années, avec une moyenne de 0,27 jour plus précoce par an. Par ailleurs, l’analyse a révélé un effet significatif de l’altitude. Plus on monte en altitude, plus la date de ponte est retardée, avec un décalage moyen de 1,44 jour pour chaque 100 mètres supplémentaires. Ce résultat souligne le rôle structurant du gradient altitudinal. De plus, le modèle intégrant l’interaction entre l’année et l’altitude révèle un point particulièrement intéressant. L’avancement des dates de ponte au fil du temps est d’autant plus marqué que l’altitude est élevée. Cela signifie que le réchauffement climatique a un impact différencié selon l’altitude, avec une accélération de la réponse phénologique des mésanges en haute montagne. Si nous prenons uniquement ce modèle pour des prédictions futures, on suppose que les mésanges de hautes altitudes pondront en même temps que celles des basses altitudes. Il est donc important de construire un modèle plus élaboré pour visualiser et prédire l’impact du réchauffement climatique sur la phénologie des mésanges. Ces études nous aident à comprendre ce qui se passera dans le temps à une échelle écosystémique montagnarde plus grande.
Comment le réchauffement climatique au cours des années modifie-t-il la phénologie de ponte des mésanges le long d’un gradient altitudinal en montagne ? Ce mémoire a été écrit durant mes deux mois de stage de Master 1 “Gestion et évaluation des environnements montagnards” réalisé au sein de la station d’écologie théorique et expérimentale du CNRS, à Moulis en Ariège en 2025. Durant ce stage j’ai pu suivre le chercheur Alexis Chaine dans son travail sur les populations de mésanges dans les Pyrénées Ariégeoises. On sait que le changement climatique impacte fortement la biodiversité et les écosystèmes des montagnes. Au cours des 10 dernières décennies, les températures dans ces régions ont augmenté deux fois plus vite que la moyenne mondiale. Dans les Pyrénées on évalue ce réchauffement entre 0,2 et 0,4 °C par décennie. Pourtant dans la recherche, les zones montagneuses sont plutôt sous représentées malgré le fort impact de ces changements environnementaux. C’est pourquoi dans ce mémoire je répondrai à la problématique suivante : Comment le réchauffement climatique au cours des années modifie-t-il la phénologie de ponte des mésanges le long d’un gradient altitudinal en montagne ? Les résultats obtenus montrent une tendance générale à l’avancement des dates de ponte au cours des années, avec une moyenne de 0,27 jour plus précoce par an. Par ailleurs, l’analyse a révélé un effet significatif de l’altitude. Plus on monte en altitude, plus la date de ponte est retardée, avec un décalage moyen de 1,44 jour pour chaque 100 mètres supplémentaires. Ce résultat souligne le rôle structurant du gradient altitudinal. De plus, le modèle intégrant l’interaction entre l’année et l’altitude révèle un point particulièrement intéressant. L’avancement des dates de ponte au fil du temps est d’autant plus marqué que l’altitude est élevée. Cela signifie que le réchauffement climatique a un impact différencié selon l’altitude, avec une accélération de la réponse phénologique des mésanges en haute montagne. Si nous prenons uniquement ce modèle pour des prédictions futures, on suppose que les mésanges de hautes altitudes pondront en même temps que celles des basses altitudes. Il est donc important de construire un modèle plus élaboré pour visualiser et prédire l’impact du réchauffement climatique sur la phénologie des mésanges. Ces études nous aident à comprendre ce qui se passera dans le temps à une échelle écosystémique montagnarde plus grande. Mise en place d'un sentier d'interprétation sur la tourbière des Moussels (11) : concilier pratiques agricoles, biodiversité et sensibilisation Dans le cadre du programme « Zone humide en Montagne Noire », fédérant plusieurs acteurs de l’environnement pour accompagner les agriculteurs dans leur gestion des zones humides sur leur exploitation, l’association Ecodiv, financée par le Département de l’Aude et l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, a restauré une grande partie de la tourbière des Moussels (11). Aujourd’hui, à la demande du Département, Ecodiv étudie ici l’installation potentielle d’un sentier d’interprétation, dans le but de valoriser cet habitat naturel rare et patrimonial. Cette tourbière est une propriété privée de cinq hectares, appartenant au GAEC Lassalle, qui l’utilise quelques semaines par an pour faire pâturer des Gasconnes Pyrénéennes. De plus, la zone humide est classée ZNIEFF de type II, et Zone humide prioritaire par le SMMAR. Ainsi, après plusieurs entretiens et visites de terrain, trois propositions de sentiers ont été conçues, permettant d’adapter le projet au financement qui sera débloqué. Ce sentier permettra aux visiteurs de découvrir l’importance des zones humides et de leur conservation, au travers de divers panneaux disposés le long du sentier.
Mise en place d'un sentier d'interprétation sur la tourbière des Moussels (11) : concilier pratiques agricoles, biodiversité et sensibilisation Dans le cadre du programme « Zone humide en Montagne Noire », fédérant plusieurs acteurs de l’environnement pour accompagner les agriculteurs dans leur gestion des zones humides sur leur exploitation, l’association Ecodiv, financée par le Département de l’Aude et l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, a restauré une grande partie de la tourbière des Moussels (11). Aujourd’hui, à la demande du Département, Ecodiv étudie ici l’installation potentielle d’un sentier d’interprétation, dans le but de valoriser cet habitat naturel rare et patrimonial. Cette tourbière est une propriété privée de cinq hectares, appartenant au GAEC Lassalle, qui l’utilise quelques semaines par an pour faire pâturer des Gasconnes Pyrénéennes. De plus, la zone humide est classée ZNIEFF de type II, et Zone humide prioritaire par le SMMAR. Ainsi, après plusieurs entretiens et visites de terrain, trois propositions de sentiers ont été conçues, permettant d’adapter le projet au financement qui sera débloqué. Ce sentier permettra aux visiteurs de découvrir l’importance des zones humides et de leur conservation, au travers de divers panneaux disposés le long du sentier. Crise des financements publics : quels impacts sur les mouvements d’éducation populaire en Haute-Garonne ? Analyse de leur rôle structurant dans les territoires. Depuis plusieurs années, le paysage associatif français évolue aux rythmes des contextes politiques, économiques et sociaux. Redéfinissant l’organisation des structures associatives, la France, dont l’organisation est fondée sur le principe de décentralisation, a vu se renforcer la délégation de compétences aux collectivités territoriales depuis 1982, et, plus récemment par la loi NOTRe en 2015. Si ces mutations ont permis de mieux adapter les politiques publiques aux réalités du terrain, elles se sont également accompagnées de transformations profondes des modalités de financement des associations. L’éducation populaire comme notion héritière de longs combats pour l'émancipation individuelle et collective se trouve aujourd’hui confrontée à une crise de financement sans précédent. Dans ce contexte national, les fédérations d’éducation populaire doivent composer avec la précarisation de leurs ressources et de nouvelles manières de faire par les principes d’innovation sociale. À l’échelle locale, le département de la Haute-Garonne n’échappe pas à ces tensions. Actrices du développement local, les fédérations y constituent un maillage dense de structures animant la vie locale. Parmi elles, la Fédération Départementale des MJC 31 (FDMJC 31) créée en 1969. La FDMJC 31 regroupe aujourd’hui 35 MJC réparties sur l'ensemble du département et rassemble plus de 18 000 adhérents. Par son objet social et ses actions, elle favorise l’accès de toutes et tous à la culture, à l'éducation et au partage des savoirs sans condition. Pourtant, comme beaucoup d’autres fédérations, la FDMJC 31 fait face à une fragilisation de son modèle économique menaçant la pérennité de ses actions. L’enjeu de ce mémoire est d’analyser comment ces fédérations parviennent à maintenir leur rôle essentiel sur les territoires et à y inventer de nouvelles formes d’actions collectives. Dans un contexte de crise, interroger l'impact de cette dernière sur les mouvements d’éducation populaire est nécessaire. Car, au-delà de leurs activités éducatives et culturelles, ces fédérations portent une vision de l’intérêt général et participent à un projet démocratique. Ainsi ce travail essaiera de répondre à la question suivante : Comment les fédérations d’éducation populaire réagissent elles à la crise actuelle et quel rôle continuent-elles à jouer dans leurs territoires ? Pour y parvenir, l’analyse s’appuiera sur l’exemple de la Haute-Garonne et sur l’étude plus approfondie des fédérations signataires d’une lettre ouverte d’interpellation collective. À travers l’analyse de leurs pratiques, stratégies d'adaptation et de leur engagement collectif, ce mémoire entend contribuer à une réflexion plus large sur l'avenir de l’éducation populaire et sur ses capacités de transformation face aux recompositions contemporaines de l’action publique.
Crise des financements publics : quels impacts sur les mouvements d’éducation populaire en Haute-Garonne ? Analyse de leur rôle structurant dans les territoires. Depuis plusieurs années, le paysage associatif français évolue aux rythmes des contextes politiques, économiques et sociaux. Redéfinissant l’organisation des structures associatives, la France, dont l’organisation est fondée sur le principe de décentralisation, a vu se renforcer la délégation de compétences aux collectivités territoriales depuis 1982, et, plus récemment par la loi NOTRe en 2015. Si ces mutations ont permis de mieux adapter les politiques publiques aux réalités du terrain, elles se sont également accompagnées de transformations profondes des modalités de financement des associations. L’éducation populaire comme notion héritière de longs combats pour l'émancipation individuelle et collective se trouve aujourd’hui confrontée à une crise de financement sans précédent. Dans ce contexte national, les fédérations d’éducation populaire doivent composer avec la précarisation de leurs ressources et de nouvelles manières de faire par les principes d’innovation sociale. À l’échelle locale, le département de la Haute-Garonne n’échappe pas à ces tensions. Actrices du développement local, les fédérations y constituent un maillage dense de structures animant la vie locale. Parmi elles, la Fédération Départementale des MJC 31 (FDMJC 31) créée en 1969. La FDMJC 31 regroupe aujourd’hui 35 MJC réparties sur l'ensemble du département et rassemble plus de 18 000 adhérents. Par son objet social et ses actions, elle favorise l’accès de toutes et tous à la culture, à l'éducation et au partage des savoirs sans condition. Pourtant, comme beaucoup d’autres fédérations, la FDMJC 31 fait face à une fragilisation de son modèle économique menaçant la pérennité de ses actions. L’enjeu de ce mémoire est d’analyser comment ces fédérations parviennent à maintenir leur rôle essentiel sur les territoires et à y inventer de nouvelles formes d’actions collectives. Dans un contexte de crise, interroger l'impact de cette dernière sur les mouvements d’éducation populaire est nécessaire. Car, au-delà de leurs activités éducatives et culturelles, ces fédérations portent une vision de l’intérêt général et participent à un projet démocratique. Ainsi ce travail essaiera de répondre à la question suivante : Comment les fédérations d’éducation populaire réagissent elles à la crise actuelle et quel rôle continuent-elles à jouer dans leurs territoires ? Pour y parvenir, l’analyse s’appuiera sur l’exemple de la Haute-Garonne et sur l’étude plus approfondie des fédérations signataires d’une lettre ouverte d’interpellation collective. À travers l’analyse de leurs pratiques, stratégies d'adaptation et de leur engagement collectif, ce mémoire entend contribuer à une réflexion plus large sur l'avenir de l’éducation populaire et sur ses capacités de transformation face aux recompositions contemporaines de l’action publique. La voie verte : un compromis entre développement des mobilités actives, contraintes foncières et réalités économiques Ce mémoire est issu d’un stage de quatre mois effectué au sein du service voirie du Muretain Agglo. Il aborde la question des voies vertes, aménagement de plus en plus utilisé pour développer la cyclabilité d’un territoire. Le développement du vélo est un enjeu central sur le territoire du Muretain Agglo afin de contenir la congestion routière et réduire les émissions de Gaz à Effet de Serre. Pour favoriser ce mode, il est nécessaire de créer de nouveaux aménagements cyclables sécurisés, confortables et continus. Dans le cadre de sa politique cyclable, pour faire face aux contraintes économiques et d’emprises spatiales, le Muretain Agglo choisit de miser en grande partie sur un type d’aménagement : la voie verte. La voie verte, aménagement mixte piétons-cycles, est un aménagement sécuritaire car séparé de la chaussée. Aujourd’hui, cet aménagement se trouve davantage dans les territoires périurbains car il s’intègre dans un environnement faiblement urbanisé afin d’offrir un cadre agréable pour une pratique cyclable récréative. Toutefois, cet usage de la voie verte tend, au sein du Muretain Agglo, à se renouveler grâce au caractère sécuritaire que cet aménagement peut apporter pour les trajets utilitaires. La diversification des usages de la voie verte permet alors d’accueillir une diversité d’usagers, impliquant de la cohabitation non seulement entre les différents modes mais aussi entre les différentes pratiques. Cette cohabitation est souvent source de conflits d’usage, représentant ainsi un risque de freins au développement du vélo. Toutefois, ces conflits sont surtout présents quand la largeur n’est pas suffisante par rapport aux nombres d’usagers. Sachant, que les mobilités actives restent encore peu développées sur le territoire, le risque que la voie verte soit un frein à la cyclabilité reste minime à l’heure actuelle. La voie verte reste alors un aménagement pertinent pour favoriser le vélo à l’échelle du Muretain Agglo, mais il est toutefois nécessaire de l’adapter aux spécificités territoriales et aux besoins présents et futurs des usagers.
La voie verte : un compromis entre développement des mobilités actives, contraintes foncières et réalités économiques Ce mémoire est issu d’un stage de quatre mois effectué au sein du service voirie du Muretain Agglo. Il aborde la question des voies vertes, aménagement de plus en plus utilisé pour développer la cyclabilité d’un territoire. Le développement du vélo est un enjeu central sur le territoire du Muretain Agglo afin de contenir la congestion routière et réduire les émissions de Gaz à Effet de Serre. Pour favoriser ce mode, il est nécessaire de créer de nouveaux aménagements cyclables sécurisés, confortables et continus. Dans le cadre de sa politique cyclable, pour faire face aux contraintes économiques et d’emprises spatiales, le Muretain Agglo choisit de miser en grande partie sur un type d’aménagement : la voie verte. La voie verte, aménagement mixte piétons-cycles, est un aménagement sécuritaire car séparé de la chaussée. Aujourd’hui, cet aménagement se trouve davantage dans les territoires périurbains car il s’intègre dans un environnement faiblement urbanisé afin d’offrir un cadre agréable pour une pratique cyclable récréative. Toutefois, cet usage de la voie verte tend, au sein du Muretain Agglo, à se renouveler grâce au caractère sécuritaire que cet aménagement peut apporter pour les trajets utilitaires. La diversification des usages de la voie verte permet alors d’accueillir une diversité d’usagers, impliquant de la cohabitation non seulement entre les différents modes mais aussi entre les différentes pratiques. Cette cohabitation est souvent source de conflits d’usage, représentant ainsi un risque de freins au développement du vélo. Toutefois, ces conflits sont surtout présents quand la largeur n’est pas suffisante par rapport aux nombres d’usagers. Sachant, que les mobilités actives restent encore peu développées sur le territoire, le risque que la voie verte soit un frein à la cyclabilité reste minime à l’heure actuelle. La voie verte reste alors un aménagement pertinent pour favoriser le vélo à l’échelle du Muretain Agglo, mais il est toutefois nécessaire de l’adapter aux spécificités territoriales et aux besoins présents et futurs des usagers. Faire cohabiter les mobilités dans une ville urbaine dense : vers un partage équilibré de l’espace public à Vincennes Ce mémoire analyse comment adapter un document d'information de bonne conduite dans l'espace public, le Code de la rue aux spécificités urbaines, sociales et de mobilité de Vincennes, afin d’en faire un levier efficace pour optimiser la cohabitation des modes de transport dans l’espace public vincennois. Il approfondit l'étude des enjeux de la mobilité dans l'espace public pour construire le mieux possible un document propre à la population.
Faire cohabiter les mobilités dans une ville urbaine dense : vers un partage équilibré de l’espace public à Vincennes Ce mémoire analyse comment adapter un document d'information de bonne conduite dans l'espace public, le Code de la rue aux spécificités urbaines, sociales et de mobilité de Vincennes, afin d’en faire un levier efficace pour optimiser la cohabitation des modes de transport dans l’espace public vincennois. Il approfondit l'étude des enjeux de la mobilité dans l'espace public pour construire le mieux possible un document propre à la population. Narration sensible La standardisation est un phénomène mondial qui touche un grand nombre de secteurs et a un impact significatif sur notre quotidien. Que ce soit en matière d’objets, de loisirs ou encore d’espaces, elle est omniprésente et influence notre manière de vivre, de percevoir, et d’interagir avec notre environnement. Dans le cadre de mes recherches, il me semble pertinent d’ interroger la standardisation des espaces verts. À travers ma pratique de designer paysagiste, je cherche à proposer une vision plus sensible, en essayant de créer une relation entre celui qui contemple et ce qui est contemplé. La spécificité de mon approche repose sur ce qui constitue le fondement même du design, placer l’humain au cœur du processus de recherche et de création. Par la suite, j’utilise ma pratique pour observer et comprendre l’existant, tout en m’interrogeant sur les mécanismes qui conduisent les espaces verts à devenir, progressivement, des lieux standardisés. Mon objectif est d’explorer comment, en s’affranchissant de certains cadres normatifs, il est possible de concevoir des espaces porteurs de sens, capables de générer une expérience à la fois émotionnelle, physique et sensorielle afin de re-proposer un dialogue vivant entre l’homme et son paysage.
Narration sensible La standardisation est un phénomène mondial qui touche un grand nombre de secteurs et a un impact significatif sur notre quotidien. Que ce soit en matière d’objets, de loisirs ou encore d’espaces, elle est omniprésente et influence notre manière de vivre, de percevoir, et d’interagir avec notre environnement. Dans le cadre de mes recherches, il me semble pertinent d’ interroger la standardisation des espaces verts. À travers ma pratique de designer paysagiste, je cherche à proposer une vision plus sensible, en essayant de créer une relation entre celui qui contemple et ce qui est contemplé. La spécificité de mon approche repose sur ce qui constitue le fondement même du design, placer l’humain au cœur du processus de recherche et de création. Par la suite, j’utilise ma pratique pour observer et comprendre l’existant, tout en m’interrogeant sur les mécanismes qui conduisent les espaces verts à devenir, progressivement, des lieux standardisés. Mon objectif est d’explorer comment, en s’affranchissant de certains cadres normatifs, il est possible de concevoir des espaces porteurs de sens, capables de générer une expérience à la fois émotionnelle, physique et sensorielle afin de re-proposer un dialogue vivant entre l’homme et son paysage. Les gardiens du tan Ce mémoire explore comment les passionnés de l’histoire des tanneries et les initiatives autour des anciennes tanneries de la Sarthe peuvent contribuer à l’attractivité des territoires. Au-delà d’une simple valorisation patrimoniale institutionnelle, il s’agit d’un engagement profond pour redonner vie à une mémoire ouvrière longtemps laissée de côté. Cette étude interroge aussi comment la mémoire du tannage peut devenir un levier de valorisation culturelle et territoriale. Elle révèle modestement un réseau discret d’acteurs engagés dans la reconnaissance et la réappropriation de leur patrimoine, fondées sur la mémoire ouvrière, l’identité locale et le vécu des habitants.
Les gardiens du tan Ce mémoire explore comment les passionnés de l’histoire des tanneries et les initiatives autour des anciennes tanneries de la Sarthe peuvent contribuer à l’attractivité des territoires. Au-delà d’une simple valorisation patrimoniale institutionnelle, il s’agit d’un engagement profond pour redonner vie à une mémoire ouvrière longtemps laissée de côté. Cette étude interroge aussi comment la mémoire du tannage peut devenir un levier de valorisation culturelle et territoriale. Elle révèle modestement un réseau discret d’acteurs engagés dans la reconnaissance et la réappropriation de leur patrimoine, fondées sur la mémoire ouvrière, l’identité locale et le vécu des habitants. À la rencontre des parents et de soi dans le récit de filiation contemporain (avec un corpus de quatre textes contemporains) Cette thèse explore le récit de filiation contemporain à travers quatre textes : La personne qui m’aimait le plus au monde est partie de Zhang Jie, Une Femme d’Annie Ernaux, La Reine du silence de Marie Nimier et Lettre morte de Linda Lê. Le récit de filiation contemporain, une écriture émergente depuis les années 1980, est caractérisé par l’exploration de l’héritage familial et des dynamiques entre générations. Ce genre de textes, selon Dominique Viart, constitue une nouvelle forme d’écriture de soi, distincte de l’autobiographie traditionnelle, souvent sous la forme d’enquête et de recueil plutôt que de narration linéaire. Les quatre écrivaines représentent une diversité d’identités, qu’il s’agisse d’une écrivaine chinoise couronnée deux fois du Prix littéraire Mao Dun, d’une lauréate française du Prix Nobel de littérature, d’une écrivaine dont le père est un auteur célèbre et encore d’une écrivaine d’origine vietnamienne. Leur diversité d’expériences enrichit les récits qu’elles proposent, permettant d’aborder des thèmes complexes comme l’absence, la culpabilité, l’identité et les relations familiales. À travers cinq chapitres, cette thèse examine les stratégies textuelles utilisées dans le récit, les lettres et la maison familiale – ces éléments récurrents qui servent de points d’ancrage pour des sujets en quête de leurs racines –, les témoignages et les rêves qui enrichissent les récits en apportant des perspectives extérieures et des dimensions imaginaires, l’absence et l’oubli qui compliquent ces récits, enfin la quête des parents et de soi qui sont l’objectif principal. La thèse vise à éclairer comment le récit de filiation permet de construire un pont entre le passé et le présent, et comment la quête des ancêtres révèle des aspects cachés de soi-même. En examinant ces récits sous divers angles, la recherche contribue à une compréhension plus approfondie du genre et de ses spécificités dans le contexte littéraire contemporain.
À la rencontre des parents et de soi dans le récit de filiation contemporain (avec un corpus de quatre textes contemporains) Cette thèse explore le récit de filiation contemporain à travers quatre textes : La personne qui m’aimait le plus au monde est partie de Zhang Jie, Une Femme d’Annie Ernaux, La Reine du silence de Marie Nimier et Lettre morte de Linda Lê. Le récit de filiation contemporain, une écriture émergente depuis les années 1980, est caractérisé par l’exploration de l’héritage familial et des dynamiques entre générations. Ce genre de textes, selon Dominique Viart, constitue une nouvelle forme d’écriture de soi, distincte de l’autobiographie traditionnelle, souvent sous la forme d’enquête et de recueil plutôt que de narration linéaire. Les quatre écrivaines représentent une diversité d’identités, qu’il s’agisse d’une écrivaine chinoise couronnée deux fois du Prix littéraire Mao Dun, d’une lauréate française du Prix Nobel de littérature, d’une écrivaine dont le père est un auteur célèbre et encore d’une écrivaine d’origine vietnamienne. Leur diversité d’expériences enrichit les récits qu’elles proposent, permettant d’aborder des thèmes complexes comme l’absence, la culpabilité, l’identité et les relations familiales. À travers cinq chapitres, cette thèse examine les stratégies textuelles utilisées dans le récit, les lettres et la maison familiale – ces éléments récurrents qui servent de points d’ancrage pour des sujets en quête de leurs racines –, les témoignages et les rêves qui enrichissent les récits en apportant des perspectives extérieures et des dimensions imaginaires, l’absence et l’oubli qui compliquent ces récits, enfin la quête des parents et de soi qui sont l’objectif principal. La thèse vise à éclairer comment le récit de filiation permet de construire un pont entre le passé et le présent, et comment la quête des ancêtres révèle des aspects cachés de soi-même. En examinant ces récits sous divers angles, la recherche contribue à une compréhension plus approfondie du genre et de ses spécificités dans le contexte littéraire contemporain. Accessibilité et communs de la connaissance : le professeur documentaliste, artisan de l'exigence politique de l'Ecole La notion du « vivre-ensemble » est parfois moquée. Les discours politiques et institutionnels en ont épuisé le sens en l’associant à des verbes d’action. « Favoriser », « promouvoir », « construire », « développer », « encourager » ont fini par en faire un prêt-à-penser pratique que l’on n’a plus besoin de questionner. Jusqu’à ce que plus personne ne comprenne concrètement de quoi il s’agit. Répétées, usées et éculées dans une succession de rapports, de vademecums et de supports de communication, ces expressions ont vidé le vivre-ensemble de son assise philosophique, de son substrat politique. Pourtant, tout nouvel enseignant qui intègre d’Éducation nationale et qui est affecté dans un établissement scolaire, sait à quel point le vivre-ensemble n’est pas qu’un outil de communication. L’École publique et républicaine est la seule à accueillir tous les élèves sans distinction d’origine sociale ou de niveau de réussite scolaire des élèves. Le vivre-ensemble n’est donc pas qu’un décorum ; il nourrit nos gestes professionnels et soutient l’exercice même de nos missions. Il nous rappelle que l’École joue un rôle politique fondamental. Dans un premier temps seront présentés le rôle du professeur documentaliste et l’exigence politique de l’École. En interrogeant la circulaire de mission et l’histoire des Centres de Documentation et d’Information, il s’agira de faire apparaître le rôle hybride des professeurs documentalistes. L’exigence politique de l’École sera définie et pensée à travers les textes juridiques tout en convoquant la philosophe Hannah Arendt pour lier cette exigence à la nécessité d’élaborer un monde commun. Dans un second temps, seront présentés la conception universelle des apprentissages et les communs de la connaissance pour comprendre en quoi ces approches peuvent nous aider à penser nos cadres pédagogiques et éducatifs. En favorisant l’émergence d’une éducation inclusive et coopérative, ces approches nous permettent d’envisager notre pratique comme une contribution active à l’ambition politique de l’École.
Accessibilité et communs de la connaissance : le professeur documentaliste, artisan de l'exigence politique de l'Ecole La notion du « vivre-ensemble » est parfois moquée. Les discours politiques et institutionnels en ont épuisé le sens en l’associant à des verbes d’action. « Favoriser », « promouvoir », « construire », « développer », « encourager » ont fini par en faire un prêt-à-penser pratique que l’on n’a plus besoin de questionner. Jusqu’à ce que plus personne ne comprenne concrètement de quoi il s’agit. Répétées, usées et éculées dans une succession de rapports, de vademecums et de supports de communication, ces expressions ont vidé le vivre-ensemble de son assise philosophique, de son substrat politique. Pourtant, tout nouvel enseignant qui intègre d’Éducation nationale et qui est affecté dans un établissement scolaire, sait à quel point le vivre-ensemble n’est pas qu’un outil de communication. L’École publique et républicaine est la seule à accueillir tous les élèves sans distinction d’origine sociale ou de niveau de réussite scolaire des élèves. Le vivre-ensemble n’est donc pas qu’un décorum ; il nourrit nos gestes professionnels et soutient l’exercice même de nos missions. Il nous rappelle que l’École joue un rôle politique fondamental. Dans un premier temps seront présentés le rôle du professeur documentaliste et l’exigence politique de l’École. En interrogeant la circulaire de mission et l’histoire des Centres de Documentation et d’Information, il s’agira de faire apparaître le rôle hybride des professeurs documentalistes. L’exigence politique de l’École sera définie et pensée à travers les textes juridiques tout en convoquant la philosophe Hannah Arendt pour lier cette exigence à la nécessité d’élaborer un monde commun. Dans un second temps, seront présentés la conception universelle des apprentissages et les communs de la connaissance pour comprendre en quoi ces approches peuvent nous aider à penser nos cadres pédagogiques et éducatifs. En favorisant l’émergence d’une éducation inclusive et coopérative, ces approches nous permettent d’envisager notre pratique comme une contribution active à l’ambition politique de l’École. Les femmes noires et l'avortement dans le Sud des Etats-Unis après Roe v. Wade. L’objectif de ce mémoire est de démontrer que les femmes noires ne bénéficiaient pas du même accès à l’avortement que les femmes blanches, et d’analyser les différentes causes expliquant cette inégalité.
Les femmes noires et l'avortement dans le Sud des Etats-Unis après Roe v. Wade. L’objectif de ce mémoire est de démontrer que les femmes noires ne bénéficiaient pas du même accès à l’avortement que les femmes blanches, et d’analyser les différentes causes expliquant cette inégalité. Le Féminin Divin dans Les Récits d'îles de Lawrence Durrell Ce mémoire porte sur une analyse de la représentation du féminin sacré dans la trilogie des récits de voyages de Lawrence Durrell : Prospero’s Cell, Reflections on a Marine Venus et Bitter Lemons of Cyprus. L’étude commence par replacer ces œuvres dans le contexte du genre du récit de voyage, qui relie entre fiction et réalité, introspection et témoignage historique. Durrell, écrivain influencé par le modernisme et le postmodernisme, explore les îles méditerranéennes comme des lieux de transformation personnelle et spirituelle. Ensuite, l’étude examine comment Durrell utilise un langage poétique pour construire des liens intimes avec le paysage, souvent féminisé, et comment les îles deviennent des entités presque humaines, parfois inspirées par des divinités grecques. Le féminin est perçu comme sacré, omniprésent et complexe : à la fois sensuel, spirituel et métaphysique. Enfin, l’analyse souligne le décalage entre les représentations du féminin et des femmes ainsi que les tensions entre l’imaginaire romantique des îles et les réalités coloniales dans lesquelles s’inscrivent les récits de Durrell, tout en réévaluant son positionnement entre orientaliste et poète exilé.
Le Féminin Divin dans Les Récits d'îles de Lawrence Durrell Ce mémoire porte sur une analyse de la représentation du féminin sacré dans la trilogie des récits de voyages de Lawrence Durrell : Prospero’s Cell, Reflections on a Marine Venus et Bitter Lemons of Cyprus. L’étude commence par replacer ces œuvres dans le contexte du genre du récit de voyage, qui relie entre fiction et réalité, introspection et témoignage historique. Durrell, écrivain influencé par le modernisme et le postmodernisme, explore les îles méditerranéennes comme des lieux de transformation personnelle et spirituelle. Ensuite, l’étude examine comment Durrell utilise un langage poétique pour construire des liens intimes avec le paysage, souvent féminisé, et comment les îles deviennent des entités presque humaines, parfois inspirées par des divinités grecques. Le féminin est perçu comme sacré, omniprésent et complexe : à la fois sensuel, spirituel et métaphysique. Enfin, l’analyse souligne le décalage entre les représentations du féminin et des femmes ainsi que les tensions entre l’imaginaire romantique des îles et les réalités coloniales dans lesquelles s’inscrivent les récits de Durrell, tout en réévaluant son positionnement entre orientaliste et poète exilé. L'enfant dans l'oeuvre de Mo Yan Le personnage enfant ou le narrateur enfant dans un texte littéraire soulève plusieurs questions complexes, à la fois sur le plan thématique et narratif – questions qui méritent d’être étudiés de près. Qu’il soit un symbole d’innocence et de pureté, un témoin de violence et de trauma, un critique social et politique ou un vecteur de mémoire et de nostalgie, l’enfant enrichit singulièrement le récit et invite à une réflexion profonde. Dans la littérature chinoise contemporaine, Mo Yan, lauréat de prix Nobel de littérature en 2012, utilise fréquemment des enfants dans ses récits. La présence marquée des enfants chez lui est un choix qui touche à la fois à sa vision artistique et à ses préoccupations sociales. Ainsi, nous nous demandons comment et pourquoi l’enfant, en tant que personnage ou narrateur, joue un rôle central dans l’œuvre de Mo Yan, et comment cette représentation reflète les tensions sociales et historiques de la Chine contemporaine ? La problématique qui guide notre analyse de l’existence de l’enfant chez Mo Yan, consiste à explorer la manière dont l’auteur se sert de cette figure pour traiter des thèmes complexes, créer une perspective unique et susciter des réactions émotionnelles chez le lecteur. Ainsi, nous avons abordé l’étude de l’enfant sous deux perspectives distinctes, d’une part, en examinant les thèmes liés au personnage enfant et d’autre part, en analysant le rôle du narrateur enfant dans les nouvelles et les romans de Mo Yan où sa présence est significative. Sont notamment étudiées : la représentation de l’enfant, y compris sa dénomination, sa typologie et ses caractéristiques physiques remarquables, l’utilisation de la perspective de l’enfant, sa voix et sa parole, enfin la perspective du lecteur.
L'enfant dans l'oeuvre de Mo Yan Le personnage enfant ou le narrateur enfant dans un texte littéraire soulève plusieurs questions complexes, à la fois sur le plan thématique et narratif – questions qui méritent d’être étudiés de près. Qu’il soit un symbole d’innocence et de pureté, un témoin de violence et de trauma, un critique social et politique ou un vecteur de mémoire et de nostalgie, l’enfant enrichit singulièrement le récit et invite à une réflexion profonde. Dans la littérature chinoise contemporaine, Mo Yan, lauréat de prix Nobel de littérature en 2012, utilise fréquemment des enfants dans ses récits. La présence marquée des enfants chez lui est un choix qui touche à la fois à sa vision artistique et à ses préoccupations sociales. Ainsi, nous nous demandons comment et pourquoi l’enfant, en tant que personnage ou narrateur, joue un rôle central dans l’œuvre de Mo Yan, et comment cette représentation reflète les tensions sociales et historiques de la Chine contemporaine ? La problématique qui guide notre analyse de l’existence de l’enfant chez Mo Yan, consiste à explorer la manière dont l’auteur se sert de cette figure pour traiter des thèmes complexes, créer une perspective unique et susciter des réactions émotionnelles chez le lecteur. Ainsi, nous avons abordé l’étude de l’enfant sous deux perspectives distinctes, d’une part, en examinant les thèmes liés au personnage enfant et d’autre part, en analysant le rôle du narrateur enfant dans les nouvelles et les romans de Mo Yan où sa présence est significative. Sont notamment étudiées : la représentation de l’enfant, y compris sa dénomination, sa typologie et ses caractéristiques physiques remarquables, l’utilisation de la perspective de l’enfant, sa voix et sa parole, enfin la perspective du lecteur.