-
 La valse des acteurs de la fabrique urbaine toulousaine - Le cas de l'urbanisme transitoire sur la ZAC Malepère
La valse des acteurs de la fabrique urbaine toulousaine - Le cas de l'urbanisme transitoire sur la ZAC Malepère La triplicité de l’espace, triple dimension entre le perçu, le vécu et le conçu, permet d’apprécier le processus de serendipity qu’offre l’urbanisme transitoire. Longtemps aux marges de l’urbanisme, il est aujourd’hui un élément clef de la fabrique urbaine. Son mode innovant de fabrique de la ville lui permet de s’adapter aux enjeux formulés par le renouvellement urbain ainsi que l’éclatement des temporalités. Les acteurs institutionnels, interpellés par l'ébullition autour de ce phénomène, s’en saisissent. Une valse des acteurs se met alors en route. Ainsi, quelle sera la place de l’urbanisme transitoire dans ces futures villes ? Va t-il révolutionner la planification institutionnelle ? Malgré les limites, les contraintes et le caractère instrumentalisé du dispositif, n’y a t-il pas là les germes d’un détournement de la conception par le vécu - fût-il temporaire ?
Situé entre l’Hers et la Marcaissonne, à l’est du continuum urbain de la ville de Toulouse et à la limite de la commune de Saint Orens de Gameville, le secteur de Malepère est en passe d’entamer sa métamorphose. De par sa taille, la durée de concession (22 ans), un important morcellement parcellaire, le projet Malepère constitue un cas singulier des opérations d’aménagement de la SEM Oppidea. A ces particularités s’ajoute l’absence de maîtrise du foncier qui bouleverse le jeu des acteurs et fait de cette opération un cas pionnier.
En quoi l’urbanisme transitoire peut-il être un outil pour faire passer la pilule de l’urbanisme (mal)négocié ?
C’est à ces questionnements que nous allons tenter de répondre à travers le cas, certes particulier de Malepère, mais dont les propriétés intrinsèques ouvrent sur des réflexions plus générales que nous pourrions aisément transposer à d’autres opérations. Ce cas d’urbanisme “à la parcelle” avec une multiplicité de propriétaires et de fonctions, pourrait se multiplier dans les années à venir. Après le temps de l’étalement urbain, puis celui de la reconversion des friches urbaines, aussi bien industrielles que militaires ou ferroviaires, viendra sans doute celui de la transformation de ces territoires hybrides, fabriqués au coup par coup.
-
 Le stockage carbone, enjeux de mise en oeuvre et d'évaluation dans le cadre du Plan Climat du Pays du Mans
Le stockage carbone, enjeux de mise en oeuvre et d'évaluation dans le cadre du Plan Climat du Pays du Mans Le stage réalisé au Syndicat Mixte du Pays du Mans a donnée l’occasion de se rendre compte du rôle et de l’importance de l’évaluation mi-parcours du Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET). La mise en évidence des difficultés que rencontrent les territoires quant à l’évaluation de leurs actions reflète une véritable problématique. Le champ de l’évaluation des politiques publiques françaises est sujet à un retard important au regard des pays nordiques notamment. L’évaluation mi-parcours est le moment pour le territoire de valoriser toutes les actions que celui-ci a mis en œuvre, avec tous les acteurs du territoire, dans le but de répondre aux objectifs qu’il s’est fixé. La valorisation de ces actions peut être quantitative ou qualitative mais toutes deux sont soumises à des obstacles. Ces difficultés peuvent venir freiner les territoires quant à l’atteinte de leurs objectifs de neutralité carbone d’ici 2050. L’atteinte de la neutralité carbone peut se faire seulement si nos modes de vie, de consommation et de production évoluent.
Le stockage carbone apparaît sur le territoire du Pays du Mans, de même que de nombreux territoire en France, comme une solution importante à prendre en compte pour atteindre la neutralité carbone fixée. Favoriser des actions de stockage carbone nécessite un changement de nos pratiques et de nos politiques publiques. Une meilleure prise en compte de ces notions de stockage carbone, notamment dans les documents de planification est primordiale pour que celles-ci aient un véritable impact sur le territoire. Son évaluation est également un enjeu important dans la réussite d’action de stockage carbone. La mobilisation et la contribution des acteurs du territoire semble être un élément déterminant à la réussite à ces actions de stockage carbone. Mais mobiliser ces acteurs demande une appropriation du sujet, de son rôle et de son impact sur un territoire. L’action publique a un rôle important à jouer dans ce processus de stockage carbone. Les fonds carbones locaux semblent être un outil commun pouvant répondre à ces besoins.
-
 La diversité des outils en faveur de la revitalisation des centres-villes suffit-elle à accueillir tous les publics ?
La diversité des outils en faveur de la revitalisation des centres-villes suffit-elle à accueillir tous les publics ? Dans le cadre de mon Master 1 Villes Habitat et Transition Écologique, j’ai effectué un stage de quatre mois au sein de la Communauté d’agglomération de la région de Château-Thierry. Ma mission de stage consistait à réaliser un observatoire de l’habitat sur la commune de Château-Thierry, ville Action Cœur de Ville d’environ 15 000 habitants. Cet observatoire tient compte des dynamiques résidentielles des ménages, des évolutions démographiques, des différentes types de parcs et typologies de logements, ainsi que toutes les spécificités de la ville. La vacance des logements étant très présente, notamment en cœur de ville, il semblait nécessaire de réaliser une veille active sur ces logements vacants. Ainsi, l’étude a été réalisée via divers outils, comme les données LOVAC par exemple. A cela s’ajoute des études de terrains et de nombreuses réunions avec une grande diversité d’acteurs du territoire. Dans un contexte où il faut proscrire l’étalement urbain et envisager l’utilisation des dents creuses ou des friches mais également densifier davantage, l’étude des logements vacants permet de savoir si ces logements sont re-mobilisables, afin d’éviter de nouvelles constructions. Ainsi, ce rapport présente le portrait de territoire de Château-Thierry et sa Communauté d’agglomération, la volonté d’améliorer le cadre de vie au travers de divers aménagements réalisés ou en cours de réflexion. Ma mission de stage sera détaillée avec les objectifs et enjeux du territoire, les actions menées lors de ces trois premiers mois de stage et une ébauche de résultats. Mais il sera aussi présenté les différents outils proposés aux habitants qui souhaitent rénover ou réhabiliter leur logement, et d’autres initiatives dans d’autres villes. Cette diversité d’outils mis en place nous a amené à nous poser la question suivante : La diversité des outils en faveur de la revitalisation des centres-villes suffit-elle à accueillir tous les publics ? Afin de répondre à cette problématique, nous développerons l’exemple de la ville de Château-Thierry.
-
 L’action publique par la catégorisation des villes petites et moyennes : un choix favorable à leur accompagnement et à la mise en œuvre de projets de territoire ?
L’action publique par la catégorisation des villes petites et moyennes : un choix favorable à leur accompagnement et à la mise en œuvre de projets de territoire ? Les notions de « ville moyenne » et de « petite ville » sont en usage dans beaucoup de systèmes statistiques et de représentation des villes mais il existe encore un flou qui entoure la définition de ces catégories. Les processus d’évolutions différenciées viennent réinterroger les places et rôles attribuées à ces catégories de ville. Entre affaiblissement, déclin, mutation ou métropolisation, c’est tout le système urbain qui évolue. Les pouvoirs publics ont renforcé leur action à travers un engagement auprès des centralités avec de nouvelles stratégies territoriales. Les opérations se sont multipliées ces dernières années avec des plans d’investissements massifs (Action Cœur de Ville, Petite Ville de Demain, etc.) supposant apporter des réponses pour réguler le développement des petites et moyennes villes. Notre questionnement porte sur la pertinence des actions et projets existants mais également sur la méthodologie engagée par l’Etat : est-ce que les solutions retenues à l’échelle nationale puis déclinées localement sont les plus adaptées pour réaliser des démarches d’aménagements aujourd’hui ? Est-ce que les catégories « petite ville », « moyenne ville » sont des périmètres pertinents pour les modalités d’intervention ? Sans oublier que les territoires évoluent à des vitesses fulgurantes et que la catégorisation peut sembler dépassée dans la complexité du système urbain actuel. Les acteurs de l’ingénierie privée occupent une place grandissante dans la mise en œuvre de l’action
publique. Ces experts, accompagnent les collectivités locales sur les dimensions techniques et sont de véritables acteurs du changement. Les bureaux d’études, sont actifs et présents pour répondre aux nouveaux enjeux et défis des territoires.
-
 Mise en oeuvre d'un projet de rénovation et d'inscription du centre de vacances "le Relais du Bois Perché" dans son territoire.
Mise en oeuvre d'un projet de rénovation et d'inscription du centre de vacances "le Relais du Bois Perché" dans son territoire. Le centre est un outil majeur de promotion des valeurs de la Ligue de l’Éducation Populaire
et de la Ligue de l’Enseignement. Implanté dans le territoire depuis 1984, le centre est un
réel moteur de développement local. Acteur du tourisme social et solidaire, le Bois Perché
est un ambassadeur pour le rayonnement du Comminges. Néanmoins, ses actions sont
compromises par de nombreuses rénovations impératives. Ces dernières apparaissent
comme nécessaires à la poursuite des activités d’accueil de ce centre de vacances. Le projet
de rénovation et de valorisation du centre s’articule de manière cohérente avec
l’écosystème local et se positionne comme porteur pour le territoire. De plus, ce projet a été
construit en collaboration étroite avec les acteurs locaux. Le développement du centre passe
par des investissements à hauteur de ses besoins.
-
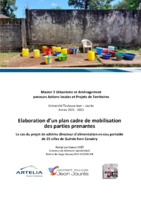 Élaboration d'un plan cadre de mobilisation des parties prenantes
Élaboration d'un plan cadre de mobilisation des parties prenantes En 2017 l’Unicef estimait que 2,1 milliards de personnes n’avait pas accès à l’eau potable dans le monde. La Guinée Conakry entre dans la catégorie des pays ne disposant pas d’infrastructures modernes d’alimentation en eau au bénéfice de sa population. En 2020 dans les communes urbaines du pays, le taux d’accès à l’eau potable varie entre 14 et 59%. C’est pourquoi le Gouvernement de la Guinée appuyé par l’Agence Française de Développement a commandé une étude de schéma directeur nationale dans 25 des plus grandes villes de Guinée (hors Conakry), pour identifier les besoins et élaborer des solutions à l’horizon 2040. Cette première étape va permettre au gouvernement de posséder des documents de planification permettant une recherche de financement lui permettant de pouvoir développer ces infrastructures. Ce schéma directeur inclut des phases de diagnostics, de définitions des besoins et d’analyses des solutions prenant en considération les impacts du changement climatique.
La bonne réussite de chaque projet passe par la mobilisation de l’ensemble des acteurs et parties prenantes de manière transparente et participative. Cette mobilisation permet d’approfondir le diagnostic, permet d’éviter les blocages, favorise l’implication de la population. L’ensemble de ces facteurs favorisent la réussite et la durabilité du projet.
Dans ce mémoire, nous proposerons un travail d’élaboration d’un plan de mobilisation des parties prenantes prenant en compte l’ensemble des phases du projet. Il sera effectué un état des lieux primaire des initiatives de concertation et de pilotage territoriales réalisées sur les différentes communes bénéficiaires du projet. Nous ferons le point sur les activités déjà réalisées dans le cadre du schéma directeur et proposerons des recommandations et une proposition de planification d’activités pouvant être réalisés de manière participative et inclusive.
-
 Restreindre l’usage de la voiture dans le Parc National de la Vanoise : la confrontation de logiques incompatibles de protection environnementale et de marketing touristique dans un territoire montagnard.
Restreindre l’usage de la voiture dans le Parc National de la Vanoise : la confrontation de logiques incompatibles de protection environnementale et de marketing touristique dans un territoire montagnard. Le Parc National de la Vanoise cherche à se positionner comme aide à la décision aux élus des
collectivités de son territoire sur des mesures de lutte contre la surfréquentation automobile
touristique. Or, en Vanoise, la notion de restriction de la place de la voiture y est source de
questionnements dans la mesure où elle semble faire s’affronter des questions de
préservation de l’environnement et de marketing touristique. En effet, le territoire est
fortement dépendant de la qualité de sa mise en tourisme pour garder son équilibre
économique et donc son équilibre social. Or, l’automobile est le mode de déplacement
dominant dans les dynamiques touristiques, faisant de sa réduction un risque pour le
territoire. Néanmoins, réduire la place de la voiture dans les déplacements touristiques serait
une action déterminante pour protéger l’environnement et aller dans le sens d’un territoire
durable. Cependant, il semblerait que, bien exécutée, réduire la place de la voiture soit une
action plus fédératrice que cause de désunion et qu’elle fusionne environnement et
markéting touristique. Elle permettrait de préserver les composantes environnementales du
territoire tout en lui donnant de multiples arguments pour mener une communication
touristique axée sur le respect de l’environnement, fortement recherchée dans un contexte
de prise de conscience environnementale généralisée. Ainsi, le recul de la voiture pourrait
être une opportunité territoriale vectrice d’un renouveau de l’offre touristique.
-
 Les enjeux du recyclage urbain en matière d'habitat dans les villes petites et moyennes. Le rôle de l'Établissement Public Foncier d'Occitanie
Les enjeux du recyclage urbain en matière d'habitat dans les villes petites et moyennes. Le rôle de l'Établissement Public Foncier d'Occitanie Dans un contexte de lutte contre l’artificialisation des sols et au regard des réglementations de plus en plus restrictives suite à la loi Climat et Résilience du 22 août 2021, la revalorisation des espaces en déshérence s’impose désormais aux aménageurs du territoire. Ce mémoire s’intéresse au processus de recyclage urbain en matière d’habitat dans les villes petites et moyennes en portant une attention particulière sur leur centre. Ces territoires hors des métropoles s’affirment de plus en plus comme une préoccupation de l’action publique au travers de programmes nationaux qui visent à les redynamiser. Aujourd’hui, il s’agit d’engager la phase opérationnelle du recyclage urbain, une tâche loin d’être facile en raison du manque d’ingénierie technique et financière dans les villes petites et moyennes. Les opérateurs, bailleurs sociaux, promoteurs et collectivités se confrontent à la difficile équation économique dans des marchés peu porteurs et affichent une certaine réticence pour produire des logements à partir de l’existant. Pour réaliser ces opérations, les Établissements Publics Fonciers deviennent indispensables et suscitent l’intérêt des acteurs de l’aménagement du territoire.
À partir de l’exemple de l’EPF d’Occitanie, la première partie de ce travail vise à apporter des éléments de compréhension sur le rôle et le fonctionnement de ce type de structure. Il s’agira également de s’intéresser à l’objectif de capitalisation d’informations et de retours d’expérience comme moyen d’encourager le recyclage urbain dans un contexte de passage à l’opérationnel. La deuxième partie, elle, propose un cadrage théorique et une contextualisation sur les enjeux d’attractivité, d’habitabilité et de sobriété foncière dans les territoires fragilisés. Cette partie présente aussi les dispositifs d’interventions publiques et souligne les décalages existant parfois avec la réalité des situations et des territoires. Enfin, elle montre la naissance de nouveaux savoir-faire par le biais d’une identification d’acteurs dynamiques du recyclage urbain dans les territoires peu denses.
-
 Comment une association peut-elle se positionner comme moteur de l’action touristique sociale et solidaire dans un écosystème local rural ? L’exemple du Bois Perché à Aspet.
Comment une association peut-elle se positionner comme moteur de l’action touristique sociale et solidaire dans un écosystème local rural ? L’exemple du Bois Perché à Aspet. Comment une association peut jouer un rôle dans le développement de l’action touristique, sociale et solidaire au sein d'un l’écosystème local, quels sont les enjeux de son intégration, comment sa raison d’être, ses missions, en un mot son identité, s’ancrent, se diffusent et desservent les territoires, en relation avec les enjeux touristiques, économiques, sociaux actuels, et dans une perspective de modernisation de sa structure.
-
 Le développement de la pratique cyclable dans l’aire urbaine d’une ville moyenne :
Le cas de Carcassonne Agglomération.
Le développement de la pratique cyclable dans l’aire urbaine d’une ville moyenne :
Le cas de Carcassonne Agglomération. Par les évènements hétéroclites que nous traversons, le vélo est en passe de devenir un moyen de déplacement incontournable des mobilités en France. En concordance avec les objectifs du plan vélo, les collectivités locales notamment les Autorités Organisatrices des Mobilités s’affairent avec pragmatisme à insuffler des politiques publiques destinées à cette dernière. Le présent mémoire nous plonge dans une Communauté d’Agglomération rurale du Sud de la France. Résultant d’un stage de Master 1 d’une durée de 3 mois, il témoigne des actions que mène une intercommunalité d’un point de vue technique. Il propose un regard sur les potentiels d’essor, les freins à la pratique, les pistes à envisager pour répondre à ce défi multidimensionnel.
-
 La démocratie participative, maillon essentiel d'une conception renouvelée des projets de territoires
La démocratie participative, maillon essentiel d'une conception renouvelée des projets de territoires La démocratie participative se développe particulièrement à l’échelle internationale depuis plusieurs années. Ce constat reflète une aspiration particulière des populations à se saisir de la chose publique afin de se faire entendre et de contribuer à l’évolution de leur territoire. Une certaine tendance à l’institutionnalisation de cette attente démocratique est observée de plusieurs années déjà, induisant le développement d’une certaine niche professionnelle. Mais alors que l’injonction institutionnelle française est de plus en plus forte en matière de participation citoyenne, à toutes les échelles de l’action publique, les acteurs locaux sont parfois frileux à l’idée de mettre en œuvre cette démocratie participative.
Ce travail s’attache à montrer que la participation des citoyens à la construction des politiques publiques constitue aujourd’hui une réelle plus-value, en mobilisant les exemples de trois territoires différents (Agen, Villeneuve-sur-Lot, Saint-Sauveur) accompagnés par l’Agence Aurélie Corbineau. L’expertise d’usage des citoyens est un pilier indispensable pour construire des projets d’action locale pertinents, cohérents et efficients au regard des défis contemporains. Un enjeu fort de formation des acteurs locaux se pose alors afin de permettre à ces derniers, parfois réfractaires au déploiement du pouvoir d’agir des citoyens, de mesurer l’ampleur des bienfaits de la participation citoyenne dans les territoires.
La formation puis l’approche méthodologique et stratégique de la construction des processus participatifs au profit des projets de territoire permettront le développement d’un travail partenarial de l’ensemble des acteurs des territoires : décideurs politiques, techniciens et citoyens. Dès lors il sera possible d’appréhender les territoires de façon beaucoup plus systémique et transversale, renforçant l’idée renouvelée des projets de territoires qui est actuellement à l’œuvre.
-
 Les espaces littoraux français au cœur d'enjeux multiples
Les espaces littoraux français au cœur d'enjeux multiples Les territoires littoraux touristiques français sont au cœur de toutes les attentions, et notamment
des inquiétudes. Actuellement considérés comme principaux espaces dynamiques français, ces derniers
ne demeurent pas moins au cœur de la problématique de la crise du logement, au même titre que certaines
grandes villes françaises. En dépit d’une volonté nationale de fléchage des personnes défavorisées dans
le logement et de leur priorisation, la pénurie et la fragilisation des plus démunis se renforce dans ces
espaces. En effet, un besoin accru en termes de logements sociaux se fait notamment sentir sur ces
territoires, qui bien souvent leur font défaut. Principal facteur d’inquiétude, cette pénurie de logements
sociaux enclenche un véritable signal de point de non-retour donné par des acteurs multiples et variés
concernant la crainte de déclin, voire d’extinction, de leur commune.
En réalité, il s’agit d’un territoire aux enjeux complexes menacé par l’essence même de son
dynamisme : le tourisme de masse ; et impacté par la principale caractéristique de sa
population : vieillissante. Ainsi, le vieillissement de la population corrélé au tourisme sont deux
processus indissociables menaçant profondément l’équilibre de ces territoires. Il est complexe de
repenser des secteurs géographiques dépendant directement de ce qui en constitue la menace, quand
bien même cette dernière s’auto-alimente. Le tourisme corrélé au vieillissement de la population pourrait
incarner le début d’une lente agonie des espaces littoraux, notamment par la fuite des jeunes, symbole
de l’avenir du territoire. Il faudra alors envisager des solutions de manière systémique et englobante
pour éviter les conflits liés aux interdépendances des enjeux avec le territoire.
-
 Participation à la fabrique urbaine et émancipation
Participation à la fabrique urbaine et émancipation La participation semble s’être invitée dans tous les domaines. Participation aux bénéfices des entreprises, budget participatif ou démocratie participative, il semble que l’enjeu soit une réappropriation des ressources et des pouvoirs. En ce qui concerne la participation à la fabrique urbaine, deux schémas d’analyse diamétralement opposés s’affrontent. D’un côté « l’injonction participative » qui consiste pour le politique à transformer les classes populaires en « public-cible » en les enjoignant à devenir des citoyens responsables apparaît comme un outil dont la fonction serait de fabriquer du consentement ou la paix sociale. De l’autre côté, on peut voir dans la participation la possibilité d’empowerment des classes dominées qui permet de s’appuyer sur une activation de la charge conflictuelle pour s’établir comme un contre-pouvoir. Entre ces deux extrêmes les pratiques participatives recouvrent une réalité très large et à géométrie variable, difficile à évaluer.
Il est important de comprendre que la participation s’inscrit dans un jeu d’acteurs complexe. Durant, ces quarante dernières années, la montée en puissance relative de la participation se fait en parallèle des politiques de décentralisation et de ce que Le Galès appelle le passage du gouvernement des villes à la gouvernance urbaine.
Seulement la participation est un objet insaisissable. Dans les discours politiques ou militants, elle n’a pas la même portée, ni la même fonction. Elle peut être la fin ou le moyen. Trouvant ses sources théoriques et pratiques notamment dans les luttes urbaines des années 1970, elle semble avoir perdu une partie de sa radicalité initiale. Cependant, des initiatives locales replacent le.la citoyen.ne. au coeur de la fabrique urbaine et font de la participation de toustes la base de leur mode d’action collective.
-
 L’intranquillité résidentielle : Quelles réponses pour les organismes HLM sur les quartiers de la Reynerie et de Bellefontaine ?
L’intranquillité résidentielle : Quelles réponses pour les organismes HLM sur les quartiers de la Reynerie et de Bellefontaine ? Les quartiers prioritaires de la politique de la ville de Reynerie et Bellefontaine sont sujets à des problèmes d’insécurité et d’incivilité liés au trafic de stupéfiants. L’ensemble du cadre de vie des habitants est de fait marqué par cette présence. Les organismes HLM subissent sur leur patrimoine des dégradations et des situations d’intranquillité résidentielle pour leurs locataires. Ils sont dans l’obligation de garantir un cadre de vie agréable et « normal ». Dans ce contexte, des outils sont mis en place afin de répondre à ces enjeux. Or, les bailleurs sociaux dépassent leur fonction initiale qui est de construire et gérer leur parc de logement afin de permettre de se loger à ceux qui en ont besoin. Cependant, la limite entre le cadre d’action des bailleurs sociaux et celui de l’Etat est floue ce qui amène à des dépassements de fonctions. Dans ce mémoire, est développé la mise en place de ces démarches de sécurisation et de lien social qui doivent offrir une réponse à ces questions. La situation sociale et l’insécurité dans les quartiers de Reynerie et Bellefontaine ont poussé les organismes HLM à mettre en place des rondes de gardiennage afin de faire partir les groupes des halls d’immeubles. Mais pas seulement, au sein de la démarche de renouvellement urbain, des opérations de résidentialisations doivent changer le cadre bâtis et fragmenter l’espace afin d’offrir un cadre de vie agréable et repousser les groupes hors des halls ou des pieds d’immeubles. En plus de cela, les trois organismes HLM présents sur les quartiers ont lancé la démarche COOP’IB, l’action associative proposée aux habitants doit leur permettre d’occuper l’espace ainsi que de créer du lien social afin de montrer le soutien des institutions aux habitants. L’ensemble de ces dispositifs doit aider à créer un quotidien plus sûr aux locataires en leur permettant de vivre « normalement » et de fait diminuer le sentiment de relégation en partie responsable de la situation dans les quartiers de Reynerie et Bellefontaine.
-
 La revitalisation des petites et moyennes villes, une problématique majeure au cœur des politiques publiques d’équilibre des territoires
La revitalisation des petites et moyennes villes, une problématique majeure au cœur des politiques publiques d’équilibre des territoires Dans le cadre d'un programme national Petites villes de demain et d'une Opération de Revitalisation du Territoire, une réflexion est menée sur la redynamisation des centres villes.
-
 Conception d'un outil cartographique pour mieux visualiser les bassins de recrutement de la Marine nationale dans le secteur Sud-Ouest
Conception d'un outil cartographique pour mieux visualiser les bassins de recrutement de la Marine nationale dans le secteur Sud-Ouest Le présent travail se propose de restituer l’avancement du stage de quatre mois, effectué au sein du Service de Recrutement de la Marine nationale, pour le secteur SudOuest. Ce stage poursuivait un triple objectif assez large, à savoir analyser le fonctionnement du service du point de vue de la géomatique, concevoir un prototype de système d’information et produire une cartographie complète de la région Sud-Ouest.
Il s’agissait d’abord de cerner la demande du personnel de ce service de pouvoir visualiser dans l’espace son activité de recrutement, afin de mettre en lumière des viviers de candidats potentiels et ainsi de guider leurs missions de prospection. Une phase d’observation et d’enquête auprès des futurs usagers du système d’information a été menée à ces fins. Puis il a fallu envisager des solutions cartographiques faisant état des spécificités très locales de ce secteur aux fortes disparités. Pour ce faire, le logiciel Qgis et l’outil en ligne Umap ont été privilégiés. Ce choix fut guidé par les contraintes logistiques et matérielles propres aux administrations du Ministère des Armées. Des bases de données compilant notamment de l’information sociodémographique sur les territoires, de l’information sur les lieux visités lors des précédentes campagnes d’information, ou de l’information sur l’origine géographique et scolaire des recrues des années précédentes ont été produites. La cartographie réalisée, du fait de contraintes techniques, n’aura pas vocation a être mise à jour à l’avenir.
A un mois de la fin du stage, il reste encore à produire plusieurs vues cartographiques du secteur, ainsi que les ressources pour permettre aux équipes d’utiliser et de comprendre les outils produits.
-
 L'évaluation des politiques publiques au travers des friches urbains. L'exemple du programme "Reconquête des friches en Occitanie".
L'évaluation des politiques publiques au travers des friches urbains. L'exemple du programme "Reconquête des friches en Occitanie". La Région Occitanie est la région la plus attractive de France avec plus de 50 000 nouveaux arrivants. Dans un contexte règlementaire qui demandent aux territoires de réduire de 50 % leurs rythmes d’artificialisation (ZAN), la Région Occitanie se doit de concilier l’accueille de nouvelles populations avec la préservation des ressources. Les friches et leurs reconversions apparaissent alors comme le levier adapté pour répondre à ces enjeux et notamment parvenir au Zéro Artificialisation Nette défini par le législateur. Néanmoins, faut-il encore donner la possibilité et la capacité aux territoires d’enclencher des projets de reconversion de friches long, techniques et couteux. C’est le défi que c’est donner la Région Occitanie avec l’appel à projet « Reconquête des friches en Occitanie » datant de 2018, qu’il convenait dorénavant d’évaluer. Cette politique publique a constitué le point de départ d’une réflexion touchant autant à la friche qu’à l’évaluation.
-
 Cartographie des actions de recrutement Grand Est
Cartographie des actions de recrutement Grand Est Du fait de sa position éloignée des côtes, la Région Grand-Est représente un défi majeur en ce qui concerne le recrutement de la Marine Nationale. Le Service de Recrutement de la Marine du secteur Grand-Est a donc créé un poste de stagiaire cartographe afin de faire un état des lieux des établissements intéressants, de compléter les bases de données existantes et enfin, créer plusieurs cartographies qui permettront à l’équipe du SRM d’avoir une meilleure vision de leurs champs d’action.
La problématique la plus importante de ce stage a été l’adaptation pratique. En effet, travailler au sein du ministère des Armées engendre une réflexion sur les moyens utilisés, les logiciels et les accès à internet étant limités. Plusieurs méthodes ont donc été testées puis abandonnées. Le produit final sera donc un jeu de données sous forme de tableurs Excel ainsi que des cartographies réalisées à l’aide du logiciel MyMaps de Google. Seront aussi fournies des fiches méthodologiques afin que les cartographies puissent être réalisées, modifiées selon les besoins, par l’équipe du SRM.
Ce stage a permis de mettre en évidence la nécessité d’adaptation du stagiaire. Le défi le plus important ici n’était pas de créer un outil très complexe mais bien de réaliser un outil répondant aux besoins des différents services du SRM Est, qui soit simple d’utilisation et pérenne afin de continuer à vivre et être mis à jour même après le départ du stagiaire.
-
 Etat des lieux pour la mise en place d'un WebSIG standard pour les communes
Etat des lieux pour la mise en place d'un WebSIG standard pour les communes Le rapport de stage est un élément cruciale du stage puisqu’il permet la synthétisation des différentes étapes de celui-ci en les décrivant et permettant une analyse critique.
Ce stage s’inscrit dans une démarche pédagogique afin d’apporter à la formation un aspect professionnalisant, en s’intégrant directement dans une entreprise et, par conséquent, dans le monde du travail. L’objectif est de mettre en application les connaissances apprises durant les premiers mois du master et de les compléter par des nouvelles.
Pour cela, j’ai effectué un stage de trois mois dans le but de m’instruire d’avantage sur les compétences à acquérir. J’ai donc effectué des démarches de recherches de structure de stage.
De plus, j’ai pu découvrir de nombreuses fonctionnalités en termes de recherches, de bases de données, de fonctionnalités sous le logiciel Open-Source QGIS mais également de rédaction de documentation pour la reprise de mes projets, par les membres de l’équipe. Effectivement, mes réalisations seront mises à jour régulièrement par Géomatika à la suite de mon stage.
Grâce à ces réalisations, j’ai obtenu, suite à la réalisation de différents projets, des résultats sur les tâches effectuées. Effectivement, à la fin du stage, nous obtenons un catalogue de métadonnées complets et conformes à la norme INSPIRE, ainsi que plusieurs projets QGIS sur la thématique du cadastre/urbanisme.
Pour leur réalisation, des recherches et de la méthodologie ont été indispensable pour aboutir à un travail rigoureux.
-
 L'inclusion des personnes en situation de handicap dans les sports de nature, un vecteur de développement territorial
L'inclusion des personnes en situation de handicap dans les sports de nature, un vecteur de développement territorial Ce mémoire propose d’étudier la question de l’inclusion des personnes en situation de handicap dans les sports de nature en tant que vecteur de développement territorial. Favoriser l’inclusion des personnes en situation de handicap dans les sports de nature peut constituer une porte d’entrée à une meilleure inclusion de ces personnes dans notre société de manière générale. En effet, bien qu’ayant fait l’objet d’évolutions législatives depuis le début des années 2000, la question du handicap est encore à travailler et un cheminement, non seulement en termes d’évolution des mentalités, mais aussi au niveau de l’inclusion de cette problématique dans les politiques publiques reste à faire.
 La valse des acteurs de la fabrique urbaine toulousaine - Le cas de l'urbanisme transitoire sur la ZAC Malepère La triplicité de l’espace, triple dimension entre le perçu, le vécu et le conçu, permet d’apprécier le processus de serendipity qu’offre l’urbanisme transitoire. Longtemps aux marges de l’urbanisme, il est aujourd’hui un élément clef de la fabrique urbaine. Son mode innovant de fabrique de la ville lui permet de s’adapter aux enjeux formulés par le renouvellement urbain ainsi que l’éclatement des temporalités. Les acteurs institutionnels, interpellés par l'ébullition autour de ce phénomène, s’en saisissent. Une valse des acteurs se met alors en route. Ainsi, quelle sera la place de l’urbanisme transitoire dans ces futures villes ? Va t-il révolutionner la planification institutionnelle ? Malgré les limites, les contraintes et le caractère instrumentalisé du dispositif, n’y a t-il pas là les germes d’un détournement de la conception par le vécu - fût-il temporaire ? Situé entre l’Hers et la Marcaissonne, à l’est du continuum urbain de la ville de Toulouse et à la limite de la commune de Saint Orens de Gameville, le secteur de Malepère est en passe d’entamer sa métamorphose. De par sa taille, la durée de concession (22 ans), un important morcellement parcellaire, le projet Malepère constitue un cas singulier des opérations d’aménagement de la SEM Oppidea. A ces particularités s’ajoute l’absence de maîtrise du foncier qui bouleverse le jeu des acteurs et fait de cette opération un cas pionnier. En quoi l’urbanisme transitoire peut-il être un outil pour faire passer la pilule de l’urbanisme (mal)négocié ? C’est à ces questionnements que nous allons tenter de répondre à travers le cas, certes particulier de Malepère, mais dont les propriétés intrinsèques ouvrent sur des réflexions plus générales que nous pourrions aisément transposer à d’autres opérations. Ce cas d’urbanisme “à la parcelle” avec une multiplicité de propriétaires et de fonctions, pourrait se multiplier dans les années à venir. Après le temps de l’étalement urbain, puis celui de la reconversion des friches urbaines, aussi bien industrielles que militaires ou ferroviaires, viendra sans doute celui de la transformation de ces territoires hybrides, fabriqués au coup par coup.
La valse des acteurs de la fabrique urbaine toulousaine - Le cas de l'urbanisme transitoire sur la ZAC Malepère La triplicité de l’espace, triple dimension entre le perçu, le vécu et le conçu, permet d’apprécier le processus de serendipity qu’offre l’urbanisme transitoire. Longtemps aux marges de l’urbanisme, il est aujourd’hui un élément clef de la fabrique urbaine. Son mode innovant de fabrique de la ville lui permet de s’adapter aux enjeux formulés par le renouvellement urbain ainsi que l’éclatement des temporalités. Les acteurs institutionnels, interpellés par l'ébullition autour de ce phénomène, s’en saisissent. Une valse des acteurs se met alors en route. Ainsi, quelle sera la place de l’urbanisme transitoire dans ces futures villes ? Va t-il révolutionner la planification institutionnelle ? Malgré les limites, les contraintes et le caractère instrumentalisé du dispositif, n’y a t-il pas là les germes d’un détournement de la conception par le vécu - fût-il temporaire ? Situé entre l’Hers et la Marcaissonne, à l’est du continuum urbain de la ville de Toulouse et à la limite de la commune de Saint Orens de Gameville, le secteur de Malepère est en passe d’entamer sa métamorphose. De par sa taille, la durée de concession (22 ans), un important morcellement parcellaire, le projet Malepère constitue un cas singulier des opérations d’aménagement de la SEM Oppidea. A ces particularités s’ajoute l’absence de maîtrise du foncier qui bouleverse le jeu des acteurs et fait de cette opération un cas pionnier. En quoi l’urbanisme transitoire peut-il être un outil pour faire passer la pilule de l’urbanisme (mal)négocié ? C’est à ces questionnements que nous allons tenter de répondre à travers le cas, certes particulier de Malepère, mais dont les propriétés intrinsèques ouvrent sur des réflexions plus générales que nous pourrions aisément transposer à d’autres opérations. Ce cas d’urbanisme “à la parcelle” avec une multiplicité de propriétaires et de fonctions, pourrait se multiplier dans les années à venir. Après le temps de l’étalement urbain, puis celui de la reconversion des friches urbaines, aussi bien industrielles que militaires ou ferroviaires, viendra sans doute celui de la transformation de ces territoires hybrides, fabriqués au coup par coup. Le stockage carbone, enjeux de mise en oeuvre et d'évaluation dans le cadre du Plan Climat du Pays du Mans Le stage réalisé au Syndicat Mixte du Pays du Mans a donnée l’occasion de se rendre compte du rôle et de l’importance de l’évaluation mi-parcours du Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET). La mise en évidence des difficultés que rencontrent les territoires quant à l’évaluation de leurs actions reflète une véritable problématique. Le champ de l’évaluation des politiques publiques françaises est sujet à un retard important au regard des pays nordiques notamment. L’évaluation mi-parcours est le moment pour le territoire de valoriser toutes les actions que celui-ci a mis en œuvre, avec tous les acteurs du territoire, dans le but de répondre aux objectifs qu’il s’est fixé. La valorisation de ces actions peut être quantitative ou qualitative mais toutes deux sont soumises à des obstacles. Ces difficultés peuvent venir freiner les territoires quant à l’atteinte de leurs objectifs de neutralité carbone d’ici 2050. L’atteinte de la neutralité carbone peut se faire seulement si nos modes de vie, de consommation et de production évoluent. Le stockage carbone apparaît sur le territoire du Pays du Mans, de même que de nombreux territoire en France, comme une solution importante à prendre en compte pour atteindre la neutralité carbone fixée. Favoriser des actions de stockage carbone nécessite un changement de nos pratiques et de nos politiques publiques. Une meilleure prise en compte de ces notions de stockage carbone, notamment dans les documents de planification est primordiale pour que celles-ci aient un véritable impact sur le territoire. Son évaluation est également un enjeu important dans la réussite d’action de stockage carbone. La mobilisation et la contribution des acteurs du territoire semble être un élément déterminant à la réussite à ces actions de stockage carbone. Mais mobiliser ces acteurs demande une appropriation du sujet, de son rôle et de son impact sur un territoire. L’action publique a un rôle important à jouer dans ce processus de stockage carbone. Les fonds carbones locaux semblent être un outil commun pouvant répondre à ces besoins.
Le stockage carbone, enjeux de mise en oeuvre et d'évaluation dans le cadre du Plan Climat du Pays du Mans Le stage réalisé au Syndicat Mixte du Pays du Mans a donnée l’occasion de se rendre compte du rôle et de l’importance de l’évaluation mi-parcours du Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET). La mise en évidence des difficultés que rencontrent les territoires quant à l’évaluation de leurs actions reflète une véritable problématique. Le champ de l’évaluation des politiques publiques françaises est sujet à un retard important au regard des pays nordiques notamment. L’évaluation mi-parcours est le moment pour le territoire de valoriser toutes les actions que celui-ci a mis en œuvre, avec tous les acteurs du territoire, dans le but de répondre aux objectifs qu’il s’est fixé. La valorisation de ces actions peut être quantitative ou qualitative mais toutes deux sont soumises à des obstacles. Ces difficultés peuvent venir freiner les territoires quant à l’atteinte de leurs objectifs de neutralité carbone d’ici 2050. L’atteinte de la neutralité carbone peut se faire seulement si nos modes de vie, de consommation et de production évoluent. Le stockage carbone apparaît sur le territoire du Pays du Mans, de même que de nombreux territoire en France, comme une solution importante à prendre en compte pour atteindre la neutralité carbone fixée. Favoriser des actions de stockage carbone nécessite un changement de nos pratiques et de nos politiques publiques. Une meilleure prise en compte de ces notions de stockage carbone, notamment dans les documents de planification est primordiale pour que celles-ci aient un véritable impact sur le territoire. Son évaluation est également un enjeu important dans la réussite d’action de stockage carbone. La mobilisation et la contribution des acteurs du territoire semble être un élément déterminant à la réussite à ces actions de stockage carbone. Mais mobiliser ces acteurs demande une appropriation du sujet, de son rôle et de son impact sur un territoire. L’action publique a un rôle important à jouer dans ce processus de stockage carbone. Les fonds carbones locaux semblent être un outil commun pouvant répondre à ces besoins. La diversité des outils en faveur de la revitalisation des centres-villes suffit-elle à accueillir tous les publics ? Dans le cadre de mon Master 1 Villes Habitat et Transition Écologique, j’ai effectué un stage de quatre mois au sein de la Communauté d’agglomération de la région de Château-Thierry. Ma mission de stage consistait à réaliser un observatoire de l’habitat sur la commune de Château-Thierry, ville Action Cœur de Ville d’environ 15 000 habitants. Cet observatoire tient compte des dynamiques résidentielles des ménages, des évolutions démographiques, des différentes types de parcs et typologies de logements, ainsi que toutes les spécificités de la ville. La vacance des logements étant très présente, notamment en cœur de ville, il semblait nécessaire de réaliser une veille active sur ces logements vacants. Ainsi, l’étude a été réalisée via divers outils, comme les données LOVAC par exemple. A cela s’ajoute des études de terrains et de nombreuses réunions avec une grande diversité d’acteurs du territoire. Dans un contexte où il faut proscrire l’étalement urbain et envisager l’utilisation des dents creuses ou des friches mais également densifier davantage, l’étude des logements vacants permet de savoir si ces logements sont re-mobilisables, afin d’éviter de nouvelles constructions. Ainsi, ce rapport présente le portrait de territoire de Château-Thierry et sa Communauté d’agglomération, la volonté d’améliorer le cadre de vie au travers de divers aménagements réalisés ou en cours de réflexion. Ma mission de stage sera détaillée avec les objectifs et enjeux du territoire, les actions menées lors de ces trois premiers mois de stage et une ébauche de résultats. Mais il sera aussi présenté les différents outils proposés aux habitants qui souhaitent rénover ou réhabiliter leur logement, et d’autres initiatives dans d’autres villes. Cette diversité d’outils mis en place nous a amené à nous poser la question suivante : La diversité des outils en faveur de la revitalisation des centres-villes suffit-elle à accueillir tous les publics ? Afin de répondre à cette problématique, nous développerons l’exemple de la ville de Château-Thierry.
La diversité des outils en faveur de la revitalisation des centres-villes suffit-elle à accueillir tous les publics ? Dans le cadre de mon Master 1 Villes Habitat et Transition Écologique, j’ai effectué un stage de quatre mois au sein de la Communauté d’agglomération de la région de Château-Thierry. Ma mission de stage consistait à réaliser un observatoire de l’habitat sur la commune de Château-Thierry, ville Action Cœur de Ville d’environ 15 000 habitants. Cet observatoire tient compte des dynamiques résidentielles des ménages, des évolutions démographiques, des différentes types de parcs et typologies de logements, ainsi que toutes les spécificités de la ville. La vacance des logements étant très présente, notamment en cœur de ville, il semblait nécessaire de réaliser une veille active sur ces logements vacants. Ainsi, l’étude a été réalisée via divers outils, comme les données LOVAC par exemple. A cela s’ajoute des études de terrains et de nombreuses réunions avec une grande diversité d’acteurs du territoire. Dans un contexte où il faut proscrire l’étalement urbain et envisager l’utilisation des dents creuses ou des friches mais également densifier davantage, l’étude des logements vacants permet de savoir si ces logements sont re-mobilisables, afin d’éviter de nouvelles constructions. Ainsi, ce rapport présente le portrait de territoire de Château-Thierry et sa Communauté d’agglomération, la volonté d’améliorer le cadre de vie au travers de divers aménagements réalisés ou en cours de réflexion. Ma mission de stage sera détaillée avec les objectifs et enjeux du territoire, les actions menées lors de ces trois premiers mois de stage et une ébauche de résultats. Mais il sera aussi présenté les différents outils proposés aux habitants qui souhaitent rénover ou réhabiliter leur logement, et d’autres initiatives dans d’autres villes. Cette diversité d’outils mis en place nous a amené à nous poser la question suivante : La diversité des outils en faveur de la revitalisation des centres-villes suffit-elle à accueillir tous les publics ? Afin de répondre à cette problématique, nous développerons l’exemple de la ville de Château-Thierry. L’action publique par la catégorisation des villes petites et moyennes : un choix favorable à leur accompagnement et à la mise en œuvre de projets de territoire ? Les notions de « ville moyenne » et de « petite ville » sont en usage dans beaucoup de systèmes statistiques et de représentation des villes mais il existe encore un flou qui entoure la définition de ces catégories. Les processus d’évolutions différenciées viennent réinterroger les places et rôles attribuées à ces catégories de ville. Entre affaiblissement, déclin, mutation ou métropolisation, c’est tout le système urbain qui évolue. Les pouvoirs publics ont renforcé leur action à travers un engagement auprès des centralités avec de nouvelles stratégies territoriales. Les opérations se sont multipliées ces dernières années avec des plans d’investissements massifs (Action Cœur de Ville, Petite Ville de Demain, etc.) supposant apporter des réponses pour réguler le développement des petites et moyennes villes. Notre questionnement porte sur la pertinence des actions et projets existants mais également sur la méthodologie engagée par l’Etat : est-ce que les solutions retenues à l’échelle nationale puis déclinées localement sont les plus adaptées pour réaliser des démarches d’aménagements aujourd’hui ? Est-ce que les catégories « petite ville », « moyenne ville » sont des périmètres pertinents pour les modalités d’intervention ? Sans oublier que les territoires évoluent à des vitesses fulgurantes et que la catégorisation peut sembler dépassée dans la complexité du système urbain actuel. Les acteurs de l’ingénierie privée occupent une place grandissante dans la mise en œuvre de l’action publique. Ces experts, accompagnent les collectivités locales sur les dimensions techniques et sont de véritables acteurs du changement. Les bureaux d’études, sont actifs et présents pour répondre aux nouveaux enjeux et défis des territoires.
L’action publique par la catégorisation des villes petites et moyennes : un choix favorable à leur accompagnement et à la mise en œuvre de projets de territoire ? Les notions de « ville moyenne » et de « petite ville » sont en usage dans beaucoup de systèmes statistiques et de représentation des villes mais il existe encore un flou qui entoure la définition de ces catégories. Les processus d’évolutions différenciées viennent réinterroger les places et rôles attribuées à ces catégories de ville. Entre affaiblissement, déclin, mutation ou métropolisation, c’est tout le système urbain qui évolue. Les pouvoirs publics ont renforcé leur action à travers un engagement auprès des centralités avec de nouvelles stratégies territoriales. Les opérations se sont multipliées ces dernières années avec des plans d’investissements massifs (Action Cœur de Ville, Petite Ville de Demain, etc.) supposant apporter des réponses pour réguler le développement des petites et moyennes villes. Notre questionnement porte sur la pertinence des actions et projets existants mais également sur la méthodologie engagée par l’Etat : est-ce que les solutions retenues à l’échelle nationale puis déclinées localement sont les plus adaptées pour réaliser des démarches d’aménagements aujourd’hui ? Est-ce que les catégories « petite ville », « moyenne ville » sont des périmètres pertinents pour les modalités d’intervention ? Sans oublier que les territoires évoluent à des vitesses fulgurantes et que la catégorisation peut sembler dépassée dans la complexité du système urbain actuel. Les acteurs de l’ingénierie privée occupent une place grandissante dans la mise en œuvre de l’action publique. Ces experts, accompagnent les collectivités locales sur les dimensions techniques et sont de véritables acteurs du changement. Les bureaux d’études, sont actifs et présents pour répondre aux nouveaux enjeux et défis des territoires. Mise en oeuvre d'un projet de rénovation et d'inscription du centre de vacances "le Relais du Bois Perché" dans son territoire. Le centre est un outil majeur de promotion des valeurs de la Ligue de l’Éducation Populaire et de la Ligue de l’Enseignement. Implanté dans le territoire depuis 1984, le centre est un réel moteur de développement local. Acteur du tourisme social et solidaire, le Bois Perché est un ambassadeur pour le rayonnement du Comminges. Néanmoins, ses actions sont compromises par de nombreuses rénovations impératives. Ces dernières apparaissent comme nécessaires à la poursuite des activités d’accueil de ce centre de vacances. Le projet de rénovation et de valorisation du centre s’articule de manière cohérente avec l’écosystème local et se positionne comme porteur pour le territoire. De plus, ce projet a été construit en collaboration étroite avec les acteurs locaux. Le développement du centre passe par des investissements à hauteur de ses besoins.
Mise en oeuvre d'un projet de rénovation et d'inscription du centre de vacances "le Relais du Bois Perché" dans son territoire. Le centre est un outil majeur de promotion des valeurs de la Ligue de l’Éducation Populaire et de la Ligue de l’Enseignement. Implanté dans le territoire depuis 1984, le centre est un réel moteur de développement local. Acteur du tourisme social et solidaire, le Bois Perché est un ambassadeur pour le rayonnement du Comminges. Néanmoins, ses actions sont compromises par de nombreuses rénovations impératives. Ces dernières apparaissent comme nécessaires à la poursuite des activités d’accueil de ce centre de vacances. Le projet de rénovation et de valorisation du centre s’articule de manière cohérente avec l’écosystème local et se positionne comme porteur pour le territoire. De plus, ce projet a été construit en collaboration étroite avec les acteurs locaux. Le développement du centre passe par des investissements à hauteur de ses besoins.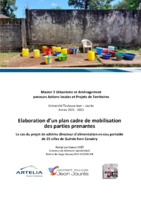 Élaboration d'un plan cadre de mobilisation des parties prenantes En 2017 l’Unicef estimait que 2,1 milliards de personnes n’avait pas accès à l’eau potable dans le monde. La Guinée Conakry entre dans la catégorie des pays ne disposant pas d’infrastructures modernes d’alimentation en eau au bénéfice de sa population. En 2020 dans les communes urbaines du pays, le taux d’accès à l’eau potable varie entre 14 et 59%. C’est pourquoi le Gouvernement de la Guinée appuyé par l’Agence Française de Développement a commandé une étude de schéma directeur nationale dans 25 des plus grandes villes de Guinée (hors Conakry), pour identifier les besoins et élaborer des solutions à l’horizon 2040. Cette première étape va permettre au gouvernement de posséder des documents de planification permettant une recherche de financement lui permettant de pouvoir développer ces infrastructures. Ce schéma directeur inclut des phases de diagnostics, de définitions des besoins et d’analyses des solutions prenant en considération les impacts du changement climatique. La bonne réussite de chaque projet passe par la mobilisation de l’ensemble des acteurs et parties prenantes de manière transparente et participative. Cette mobilisation permet d’approfondir le diagnostic, permet d’éviter les blocages, favorise l’implication de la population. L’ensemble de ces facteurs favorisent la réussite et la durabilité du projet. Dans ce mémoire, nous proposerons un travail d’élaboration d’un plan de mobilisation des parties prenantes prenant en compte l’ensemble des phases du projet. Il sera effectué un état des lieux primaire des initiatives de concertation et de pilotage territoriales réalisées sur les différentes communes bénéficiaires du projet. Nous ferons le point sur les activités déjà réalisées dans le cadre du schéma directeur et proposerons des recommandations et une proposition de planification d’activités pouvant être réalisés de manière participative et inclusive.
Élaboration d'un plan cadre de mobilisation des parties prenantes En 2017 l’Unicef estimait que 2,1 milliards de personnes n’avait pas accès à l’eau potable dans le monde. La Guinée Conakry entre dans la catégorie des pays ne disposant pas d’infrastructures modernes d’alimentation en eau au bénéfice de sa population. En 2020 dans les communes urbaines du pays, le taux d’accès à l’eau potable varie entre 14 et 59%. C’est pourquoi le Gouvernement de la Guinée appuyé par l’Agence Française de Développement a commandé une étude de schéma directeur nationale dans 25 des plus grandes villes de Guinée (hors Conakry), pour identifier les besoins et élaborer des solutions à l’horizon 2040. Cette première étape va permettre au gouvernement de posséder des documents de planification permettant une recherche de financement lui permettant de pouvoir développer ces infrastructures. Ce schéma directeur inclut des phases de diagnostics, de définitions des besoins et d’analyses des solutions prenant en considération les impacts du changement climatique. La bonne réussite de chaque projet passe par la mobilisation de l’ensemble des acteurs et parties prenantes de manière transparente et participative. Cette mobilisation permet d’approfondir le diagnostic, permet d’éviter les blocages, favorise l’implication de la population. L’ensemble de ces facteurs favorisent la réussite et la durabilité du projet. Dans ce mémoire, nous proposerons un travail d’élaboration d’un plan de mobilisation des parties prenantes prenant en compte l’ensemble des phases du projet. Il sera effectué un état des lieux primaire des initiatives de concertation et de pilotage territoriales réalisées sur les différentes communes bénéficiaires du projet. Nous ferons le point sur les activités déjà réalisées dans le cadre du schéma directeur et proposerons des recommandations et une proposition de planification d’activités pouvant être réalisés de manière participative et inclusive. Restreindre l’usage de la voiture dans le Parc National de la Vanoise : la confrontation de logiques incompatibles de protection environnementale et de marketing touristique dans un territoire montagnard. Le Parc National de la Vanoise cherche à se positionner comme aide à la décision aux élus des collectivités de son territoire sur des mesures de lutte contre la surfréquentation automobile touristique. Or, en Vanoise, la notion de restriction de la place de la voiture y est source de questionnements dans la mesure où elle semble faire s’affronter des questions de préservation de l’environnement et de marketing touristique. En effet, le territoire est fortement dépendant de la qualité de sa mise en tourisme pour garder son équilibre économique et donc son équilibre social. Or, l’automobile est le mode de déplacement dominant dans les dynamiques touristiques, faisant de sa réduction un risque pour le territoire. Néanmoins, réduire la place de la voiture dans les déplacements touristiques serait une action déterminante pour protéger l’environnement et aller dans le sens d’un territoire durable. Cependant, il semblerait que, bien exécutée, réduire la place de la voiture soit une action plus fédératrice que cause de désunion et qu’elle fusionne environnement et markéting touristique. Elle permettrait de préserver les composantes environnementales du territoire tout en lui donnant de multiples arguments pour mener une communication touristique axée sur le respect de l’environnement, fortement recherchée dans un contexte de prise de conscience environnementale généralisée. Ainsi, le recul de la voiture pourrait être une opportunité territoriale vectrice d’un renouveau de l’offre touristique.
Restreindre l’usage de la voiture dans le Parc National de la Vanoise : la confrontation de logiques incompatibles de protection environnementale et de marketing touristique dans un territoire montagnard. Le Parc National de la Vanoise cherche à se positionner comme aide à la décision aux élus des collectivités de son territoire sur des mesures de lutte contre la surfréquentation automobile touristique. Or, en Vanoise, la notion de restriction de la place de la voiture y est source de questionnements dans la mesure où elle semble faire s’affronter des questions de préservation de l’environnement et de marketing touristique. En effet, le territoire est fortement dépendant de la qualité de sa mise en tourisme pour garder son équilibre économique et donc son équilibre social. Or, l’automobile est le mode de déplacement dominant dans les dynamiques touristiques, faisant de sa réduction un risque pour le territoire. Néanmoins, réduire la place de la voiture dans les déplacements touristiques serait une action déterminante pour protéger l’environnement et aller dans le sens d’un territoire durable. Cependant, il semblerait que, bien exécutée, réduire la place de la voiture soit une action plus fédératrice que cause de désunion et qu’elle fusionne environnement et markéting touristique. Elle permettrait de préserver les composantes environnementales du territoire tout en lui donnant de multiples arguments pour mener une communication touristique axée sur le respect de l’environnement, fortement recherchée dans un contexte de prise de conscience environnementale généralisée. Ainsi, le recul de la voiture pourrait être une opportunité territoriale vectrice d’un renouveau de l’offre touristique. Les enjeux du recyclage urbain en matière d'habitat dans les villes petites et moyennes. Le rôle de l'Établissement Public Foncier d'Occitanie Dans un contexte de lutte contre l’artificialisation des sols et au regard des réglementations de plus en plus restrictives suite à la loi Climat et Résilience du 22 août 2021, la revalorisation des espaces en déshérence s’impose désormais aux aménageurs du territoire. Ce mémoire s’intéresse au processus de recyclage urbain en matière d’habitat dans les villes petites et moyennes en portant une attention particulière sur leur centre. Ces territoires hors des métropoles s’affirment de plus en plus comme une préoccupation de l’action publique au travers de programmes nationaux qui visent à les redynamiser. Aujourd’hui, il s’agit d’engager la phase opérationnelle du recyclage urbain, une tâche loin d’être facile en raison du manque d’ingénierie technique et financière dans les villes petites et moyennes. Les opérateurs, bailleurs sociaux, promoteurs et collectivités se confrontent à la difficile équation économique dans des marchés peu porteurs et affichent une certaine réticence pour produire des logements à partir de l’existant. Pour réaliser ces opérations, les Établissements Publics Fonciers deviennent indispensables et suscitent l’intérêt des acteurs de l’aménagement du territoire. À partir de l’exemple de l’EPF d’Occitanie, la première partie de ce travail vise à apporter des éléments de compréhension sur le rôle et le fonctionnement de ce type de structure. Il s’agira également de s’intéresser à l’objectif de capitalisation d’informations et de retours d’expérience comme moyen d’encourager le recyclage urbain dans un contexte de passage à l’opérationnel. La deuxième partie, elle, propose un cadrage théorique et une contextualisation sur les enjeux d’attractivité, d’habitabilité et de sobriété foncière dans les territoires fragilisés. Cette partie présente aussi les dispositifs d’interventions publiques et souligne les décalages existant parfois avec la réalité des situations et des territoires. Enfin, elle montre la naissance de nouveaux savoir-faire par le biais d’une identification d’acteurs dynamiques du recyclage urbain dans les territoires peu denses.
Les enjeux du recyclage urbain en matière d'habitat dans les villes petites et moyennes. Le rôle de l'Établissement Public Foncier d'Occitanie Dans un contexte de lutte contre l’artificialisation des sols et au regard des réglementations de plus en plus restrictives suite à la loi Climat et Résilience du 22 août 2021, la revalorisation des espaces en déshérence s’impose désormais aux aménageurs du territoire. Ce mémoire s’intéresse au processus de recyclage urbain en matière d’habitat dans les villes petites et moyennes en portant une attention particulière sur leur centre. Ces territoires hors des métropoles s’affirment de plus en plus comme une préoccupation de l’action publique au travers de programmes nationaux qui visent à les redynamiser. Aujourd’hui, il s’agit d’engager la phase opérationnelle du recyclage urbain, une tâche loin d’être facile en raison du manque d’ingénierie technique et financière dans les villes petites et moyennes. Les opérateurs, bailleurs sociaux, promoteurs et collectivités se confrontent à la difficile équation économique dans des marchés peu porteurs et affichent une certaine réticence pour produire des logements à partir de l’existant. Pour réaliser ces opérations, les Établissements Publics Fonciers deviennent indispensables et suscitent l’intérêt des acteurs de l’aménagement du territoire. À partir de l’exemple de l’EPF d’Occitanie, la première partie de ce travail vise à apporter des éléments de compréhension sur le rôle et le fonctionnement de ce type de structure. Il s’agira également de s’intéresser à l’objectif de capitalisation d’informations et de retours d’expérience comme moyen d’encourager le recyclage urbain dans un contexte de passage à l’opérationnel. La deuxième partie, elle, propose un cadrage théorique et une contextualisation sur les enjeux d’attractivité, d’habitabilité et de sobriété foncière dans les territoires fragilisés. Cette partie présente aussi les dispositifs d’interventions publiques et souligne les décalages existant parfois avec la réalité des situations et des territoires. Enfin, elle montre la naissance de nouveaux savoir-faire par le biais d’une identification d’acteurs dynamiques du recyclage urbain dans les territoires peu denses. Comment une association peut-elle se positionner comme moteur de l’action touristique sociale et solidaire dans un écosystème local rural ? L’exemple du Bois Perché à Aspet. Comment une association peut jouer un rôle dans le développement de l’action touristique, sociale et solidaire au sein d'un l’écosystème local, quels sont les enjeux de son intégration, comment sa raison d’être, ses missions, en un mot son identité, s’ancrent, se diffusent et desservent les territoires, en relation avec les enjeux touristiques, économiques, sociaux actuels, et dans une perspective de modernisation de sa structure.
Comment une association peut-elle se positionner comme moteur de l’action touristique sociale et solidaire dans un écosystème local rural ? L’exemple du Bois Perché à Aspet. Comment une association peut jouer un rôle dans le développement de l’action touristique, sociale et solidaire au sein d'un l’écosystème local, quels sont les enjeux de son intégration, comment sa raison d’être, ses missions, en un mot son identité, s’ancrent, se diffusent et desservent les territoires, en relation avec les enjeux touristiques, économiques, sociaux actuels, et dans une perspective de modernisation de sa structure. Le développement de la pratique cyclable dans l’aire urbaine d’une ville moyenne :
Le cas de Carcassonne Agglomération. Par les évènements hétéroclites que nous traversons, le vélo est en passe de devenir un moyen de déplacement incontournable des mobilités en France. En concordance avec les objectifs du plan vélo, les collectivités locales notamment les Autorités Organisatrices des Mobilités s’affairent avec pragmatisme à insuffler des politiques publiques destinées à cette dernière. Le présent mémoire nous plonge dans une Communauté d’Agglomération rurale du Sud de la France. Résultant d’un stage de Master 1 d’une durée de 3 mois, il témoigne des actions que mène une intercommunalité d’un point de vue technique. Il propose un regard sur les potentiels d’essor, les freins à la pratique, les pistes à envisager pour répondre à ce défi multidimensionnel.
Le développement de la pratique cyclable dans l’aire urbaine d’une ville moyenne :
Le cas de Carcassonne Agglomération. Par les évènements hétéroclites que nous traversons, le vélo est en passe de devenir un moyen de déplacement incontournable des mobilités en France. En concordance avec les objectifs du plan vélo, les collectivités locales notamment les Autorités Organisatrices des Mobilités s’affairent avec pragmatisme à insuffler des politiques publiques destinées à cette dernière. Le présent mémoire nous plonge dans une Communauté d’Agglomération rurale du Sud de la France. Résultant d’un stage de Master 1 d’une durée de 3 mois, il témoigne des actions que mène une intercommunalité d’un point de vue technique. Il propose un regard sur les potentiels d’essor, les freins à la pratique, les pistes à envisager pour répondre à ce défi multidimensionnel. La démocratie participative, maillon essentiel d'une conception renouvelée des projets de territoires La démocratie participative se développe particulièrement à l’échelle internationale depuis plusieurs années. Ce constat reflète une aspiration particulière des populations à se saisir de la chose publique afin de se faire entendre et de contribuer à l’évolution de leur territoire. Une certaine tendance à l’institutionnalisation de cette attente démocratique est observée de plusieurs années déjà, induisant le développement d’une certaine niche professionnelle. Mais alors que l’injonction institutionnelle française est de plus en plus forte en matière de participation citoyenne, à toutes les échelles de l’action publique, les acteurs locaux sont parfois frileux à l’idée de mettre en œuvre cette démocratie participative. Ce travail s’attache à montrer que la participation des citoyens à la construction des politiques publiques constitue aujourd’hui une réelle plus-value, en mobilisant les exemples de trois territoires différents (Agen, Villeneuve-sur-Lot, Saint-Sauveur) accompagnés par l’Agence Aurélie Corbineau. L’expertise d’usage des citoyens est un pilier indispensable pour construire des projets d’action locale pertinents, cohérents et efficients au regard des défis contemporains. Un enjeu fort de formation des acteurs locaux se pose alors afin de permettre à ces derniers, parfois réfractaires au déploiement du pouvoir d’agir des citoyens, de mesurer l’ampleur des bienfaits de la participation citoyenne dans les territoires. La formation puis l’approche méthodologique et stratégique de la construction des processus participatifs au profit des projets de territoire permettront le développement d’un travail partenarial de l’ensemble des acteurs des territoires : décideurs politiques, techniciens et citoyens. Dès lors il sera possible d’appréhender les territoires de façon beaucoup plus systémique et transversale, renforçant l’idée renouvelée des projets de territoires qui est actuellement à l’œuvre.
La démocratie participative, maillon essentiel d'une conception renouvelée des projets de territoires La démocratie participative se développe particulièrement à l’échelle internationale depuis plusieurs années. Ce constat reflète une aspiration particulière des populations à se saisir de la chose publique afin de se faire entendre et de contribuer à l’évolution de leur territoire. Une certaine tendance à l’institutionnalisation de cette attente démocratique est observée de plusieurs années déjà, induisant le développement d’une certaine niche professionnelle. Mais alors que l’injonction institutionnelle française est de plus en plus forte en matière de participation citoyenne, à toutes les échelles de l’action publique, les acteurs locaux sont parfois frileux à l’idée de mettre en œuvre cette démocratie participative. Ce travail s’attache à montrer que la participation des citoyens à la construction des politiques publiques constitue aujourd’hui une réelle plus-value, en mobilisant les exemples de trois territoires différents (Agen, Villeneuve-sur-Lot, Saint-Sauveur) accompagnés par l’Agence Aurélie Corbineau. L’expertise d’usage des citoyens est un pilier indispensable pour construire des projets d’action locale pertinents, cohérents et efficients au regard des défis contemporains. Un enjeu fort de formation des acteurs locaux se pose alors afin de permettre à ces derniers, parfois réfractaires au déploiement du pouvoir d’agir des citoyens, de mesurer l’ampleur des bienfaits de la participation citoyenne dans les territoires. La formation puis l’approche méthodologique et stratégique de la construction des processus participatifs au profit des projets de territoire permettront le développement d’un travail partenarial de l’ensemble des acteurs des territoires : décideurs politiques, techniciens et citoyens. Dès lors il sera possible d’appréhender les territoires de façon beaucoup plus systémique et transversale, renforçant l’idée renouvelée des projets de territoires qui est actuellement à l’œuvre. Les espaces littoraux français au cœur d'enjeux multiples Les territoires littoraux touristiques français sont au cœur de toutes les attentions, et notamment des inquiétudes. Actuellement considérés comme principaux espaces dynamiques français, ces derniers ne demeurent pas moins au cœur de la problématique de la crise du logement, au même titre que certaines grandes villes françaises. En dépit d’une volonté nationale de fléchage des personnes défavorisées dans le logement et de leur priorisation, la pénurie et la fragilisation des plus démunis se renforce dans ces espaces. En effet, un besoin accru en termes de logements sociaux se fait notamment sentir sur ces territoires, qui bien souvent leur font défaut. Principal facteur d’inquiétude, cette pénurie de logements sociaux enclenche un véritable signal de point de non-retour donné par des acteurs multiples et variés concernant la crainte de déclin, voire d’extinction, de leur commune. En réalité, il s’agit d’un territoire aux enjeux complexes menacé par l’essence même de son dynamisme : le tourisme de masse ; et impacté par la principale caractéristique de sa population : vieillissante. Ainsi, le vieillissement de la population corrélé au tourisme sont deux processus indissociables menaçant profondément l’équilibre de ces territoires. Il est complexe de repenser des secteurs géographiques dépendant directement de ce qui en constitue la menace, quand bien même cette dernière s’auto-alimente. Le tourisme corrélé au vieillissement de la population pourrait incarner le début d’une lente agonie des espaces littoraux, notamment par la fuite des jeunes, symbole de l’avenir du territoire. Il faudra alors envisager des solutions de manière systémique et englobante pour éviter les conflits liés aux interdépendances des enjeux avec le territoire.
Les espaces littoraux français au cœur d'enjeux multiples Les territoires littoraux touristiques français sont au cœur de toutes les attentions, et notamment des inquiétudes. Actuellement considérés comme principaux espaces dynamiques français, ces derniers ne demeurent pas moins au cœur de la problématique de la crise du logement, au même titre que certaines grandes villes françaises. En dépit d’une volonté nationale de fléchage des personnes défavorisées dans le logement et de leur priorisation, la pénurie et la fragilisation des plus démunis se renforce dans ces espaces. En effet, un besoin accru en termes de logements sociaux se fait notamment sentir sur ces territoires, qui bien souvent leur font défaut. Principal facteur d’inquiétude, cette pénurie de logements sociaux enclenche un véritable signal de point de non-retour donné par des acteurs multiples et variés concernant la crainte de déclin, voire d’extinction, de leur commune. En réalité, il s’agit d’un territoire aux enjeux complexes menacé par l’essence même de son dynamisme : le tourisme de masse ; et impacté par la principale caractéristique de sa population : vieillissante. Ainsi, le vieillissement de la population corrélé au tourisme sont deux processus indissociables menaçant profondément l’équilibre de ces territoires. Il est complexe de repenser des secteurs géographiques dépendant directement de ce qui en constitue la menace, quand bien même cette dernière s’auto-alimente. Le tourisme corrélé au vieillissement de la population pourrait incarner le début d’une lente agonie des espaces littoraux, notamment par la fuite des jeunes, symbole de l’avenir du territoire. Il faudra alors envisager des solutions de manière systémique et englobante pour éviter les conflits liés aux interdépendances des enjeux avec le territoire. Participation à la fabrique urbaine et émancipation La participation semble s’être invitée dans tous les domaines. Participation aux bénéfices des entreprises, budget participatif ou démocratie participative, il semble que l’enjeu soit une réappropriation des ressources et des pouvoirs. En ce qui concerne la participation à la fabrique urbaine, deux schémas d’analyse diamétralement opposés s’affrontent. D’un côté « l’injonction participative » qui consiste pour le politique à transformer les classes populaires en « public-cible » en les enjoignant à devenir des citoyens responsables apparaît comme un outil dont la fonction serait de fabriquer du consentement ou la paix sociale. De l’autre côté, on peut voir dans la participation la possibilité d’empowerment des classes dominées qui permet de s’appuyer sur une activation de la charge conflictuelle pour s’établir comme un contre-pouvoir. Entre ces deux extrêmes les pratiques participatives recouvrent une réalité très large et à géométrie variable, difficile à évaluer. Il est important de comprendre que la participation s’inscrit dans un jeu d’acteurs complexe. Durant, ces quarante dernières années, la montée en puissance relative de la participation se fait en parallèle des politiques de décentralisation et de ce que Le Galès appelle le passage du gouvernement des villes à la gouvernance urbaine. Seulement la participation est un objet insaisissable. Dans les discours politiques ou militants, elle n’a pas la même portée, ni la même fonction. Elle peut être la fin ou le moyen. Trouvant ses sources théoriques et pratiques notamment dans les luttes urbaines des années 1970, elle semble avoir perdu une partie de sa radicalité initiale. Cependant, des initiatives locales replacent le.la citoyen.ne. au coeur de la fabrique urbaine et font de la participation de toustes la base de leur mode d’action collective.
Participation à la fabrique urbaine et émancipation La participation semble s’être invitée dans tous les domaines. Participation aux bénéfices des entreprises, budget participatif ou démocratie participative, il semble que l’enjeu soit une réappropriation des ressources et des pouvoirs. En ce qui concerne la participation à la fabrique urbaine, deux schémas d’analyse diamétralement opposés s’affrontent. D’un côté « l’injonction participative » qui consiste pour le politique à transformer les classes populaires en « public-cible » en les enjoignant à devenir des citoyens responsables apparaît comme un outil dont la fonction serait de fabriquer du consentement ou la paix sociale. De l’autre côté, on peut voir dans la participation la possibilité d’empowerment des classes dominées qui permet de s’appuyer sur une activation de la charge conflictuelle pour s’établir comme un contre-pouvoir. Entre ces deux extrêmes les pratiques participatives recouvrent une réalité très large et à géométrie variable, difficile à évaluer. Il est important de comprendre que la participation s’inscrit dans un jeu d’acteurs complexe. Durant, ces quarante dernières années, la montée en puissance relative de la participation se fait en parallèle des politiques de décentralisation et de ce que Le Galès appelle le passage du gouvernement des villes à la gouvernance urbaine. Seulement la participation est un objet insaisissable. Dans les discours politiques ou militants, elle n’a pas la même portée, ni la même fonction. Elle peut être la fin ou le moyen. Trouvant ses sources théoriques et pratiques notamment dans les luttes urbaines des années 1970, elle semble avoir perdu une partie de sa radicalité initiale. Cependant, des initiatives locales replacent le.la citoyen.ne. au coeur de la fabrique urbaine et font de la participation de toustes la base de leur mode d’action collective. L’intranquillité résidentielle : Quelles réponses pour les organismes HLM sur les quartiers de la Reynerie et de Bellefontaine ? Les quartiers prioritaires de la politique de la ville de Reynerie et Bellefontaine sont sujets à des problèmes d’insécurité et d’incivilité liés au trafic de stupéfiants. L’ensemble du cadre de vie des habitants est de fait marqué par cette présence. Les organismes HLM subissent sur leur patrimoine des dégradations et des situations d’intranquillité résidentielle pour leurs locataires. Ils sont dans l’obligation de garantir un cadre de vie agréable et « normal ». Dans ce contexte, des outils sont mis en place afin de répondre à ces enjeux. Or, les bailleurs sociaux dépassent leur fonction initiale qui est de construire et gérer leur parc de logement afin de permettre de se loger à ceux qui en ont besoin. Cependant, la limite entre le cadre d’action des bailleurs sociaux et celui de l’Etat est floue ce qui amène à des dépassements de fonctions. Dans ce mémoire, est développé la mise en place de ces démarches de sécurisation et de lien social qui doivent offrir une réponse à ces questions. La situation sociale et l’insécurité dans les quartiers de Reynerie et Bellefontaine ont poussé les organismes HLM à mettre en place des rondes de gardiennage afin de faire partir les groupes des halls d’immeubles. Mais pas seulement, au sein de la démarche de renouvellement urbain, des opérations de résidentialisations doivent changer le cadre bâtis et fragmenter l’espace afin d’offrir un cadre de vie agréable et repousser les groupes hors des halls ou des pieds d’immeubles. En plus de cela, les trois organismes HLM présents sur les quartiers ont lancé la démarche COOP’IB, l’action associative proposée aux habitants doit leur permettre d’occuper l’espace ainsi que de créer du lien social afin de montrer le soutien des institutions aux habitants. L’ensemble de ces dispositifs doit aider à créer un quotidien plus sûr aux locataires en leur permettant de vivre « normalement » et de fait diminuer le sentiment de relégation en partie responsable de la situation dans les quartiers de Reynerie et Bellefontaine.
L’intranquillité résidentielle : Quelles réponses pour les organismes HLM sur les quartiers de la Reynerie et de Bellefontaine ? Les quartiers prioritaires de la politique de la ville de Reynerie et Bellefontaine sont sujets à des problèmes d’insécurité et d’incivilité liés au trafic de stupéfiants. L’ensemble du cadre de vie des habitants est de fait marqué par cette présence. Les organismes HLM subissent sur leur patrimoine des dégradations et des situations d’intranquillité résidentielle pour leurs locataires. Ils sont dans l’obligation de garantir un cadre de vie agréable et « normal ». Dans ce contexte, des outils sont mis en place afin de répondre à ces enjeux. Or, les bailleurs sociaux dépassent leur fonction initiale qui est de construire et gérer leur parc de logement afin de permettre de se loger à ceux qui en ont besoin. Cependant, la limite entre le cadre d’action des bailleurs sociaux et celui de l’Etat est floue ce qui amène à des dépassements de fonctions. Dans ce mémoire, est développé la mise en place de ces démarches de sécurisation et de lien social qui doivent offrir une réponse à ces questions. La situation sociale et l’insécurité dans les quartiers de Reynerie et Bellefontaine ont poussé les organismes HLM à mettre en place des rondes de gardiennage afin de faire partir les groupes des halls d’immeubles. Mais pas seulement, au sein de la démarche de renouvellement urbain, des opérations de résidentialisations doivent changer le cadre bâtis et fragmenter l’espace afin d’offrir un cadre de vie agréable et repousser les groupes hors des halls ou des pieds d’immeubles. En plus de cela, les trois organismes HLM présents sur les quartiers ont lancé la démarche COOP’IB, l’action associative proposée aux habitants doit leur permettre d’occuper l’espace ainsi que de créer du lien social afin de montrer le soutien des institutions aux habitants. L’ensemble de ces dispositifs doit aider à créer un quotidien plus sûr aux locataires en leur permettant de vivre « normalement » et de fait diminuer le sentiment de relégation en partie responsable de la situation dans les quartiers de Reynerie et Bellefontaine. La revitalisation des petites et moyennes villes, une problématique majeure au cœur des politiques publiques d’équilibre des territoires Dans le cadre d'un programme national Petites villes de demain et d'une Opération de Revitalisation du Territoire, une réflexion est menée sur la redynamisation des centres villes.
La revitalisation des petites et moyennes villes, une problématique majeure au cœur des politiques publiques d’équilibre des territoires Dans le cadre d'un programme national Petites villes de demain et d'une Opération de Revitalisation du Territoire, une réflexion est menée sur la redynamisation des centres villes. Conception d'un outil cartographique pour mieux visualiser les bassins de recrutement de la Marine nationale dans le secteur Sud-Ouest Le présent travail se propose de restituer l’avancement du stage de quatre mois, effectué au sein du Service de Recrutement de la Marine nationale, pour le secteur SudOuest. Ce stage poursuivait un triple objectif assez large, à savoir analyser le fonctionnement du service du point de vue de la géomatique, concevoir un prototype de système d’information et produire une cartographie complète de la région Sud-Ouest. Il s’agissait d’abord de cerner la demande du personnel de ce service de pouvoir visualiser dans l’espace son activité de recrutement, afin de mettre en lumière des viviers de candidats potentiels et ainsi de guider leurs missions de prospection. Une phase d’observation et d’enquête auprès des futurs usagers du système d’information a été menée à ces fins. Puis il a fallu envisager des solutions cartographiques faisant état des spécificités très locales de ce secteur aux fortes disparités. Pour ce faire, le logiciel Qgis et l’outil en ligne Umap ont été privilégiés. Ce choix fut guidé par les contraintes logistiques et matérielles propres aux administrations du Ministère des Armées. Des bases de données compilant notamment de l’information sociodémographique sur les territoires, de l’information sur les lieux visités lors des précédentes campagnes d’information, ou de l’information sur l’origine géographique et scolaire des recrues des années précédentes ont été produites. La cartographie réalisée, du fait de contraintes techniques, n’aura pas vocation a être mise à jour à l’avenir. A un mois de la fin du stage, il reste encore à produire plusieurs vues cartographiques du secteur, ainsi que les ressources pour permettre aux équipes d’utiliser et de comprendre les outils produits.
Conception d'un outil cartographique pour mieux visualiser les bassins de recrutement de la Marine nationale dans le secteur Sud-Ouest Le présent travail se propose de restituer l’avancement du stage de quatre mois, effectué au sein du Service de Recrutement de la Marine nationale, pour le secteur SudOuest. Ce stage poursuivait un triple objectif assez large, à savoir analyser le fonctionnement du service du point de vue de la géomatique, concevoir un prototype de système d’information et produire une cartographie complète de la région Sud-Ouest. Il s’agissait d’abord de cerner la demande du personnel de ce service de pouvoir visualiser dans l’espace son activité de recrutement, afin de mettre en lumière des viviers de candidats potentiels et ainsi de guider leurs missions de prospection. Une phase d’observation et d’enquête auprès des futurs usagers du système d’information a été menée à ces fins. Puis il a fallu envisager des solutions cartographiques faisant état des spécificités très locales de ce secteur aux fortes disparités. Pour ce faire, le logiciel Qgis et l’outil en ligne Umap ont été privilégiés. Ce choix fut guidé par les contraintes logistiques et matérielles propres aux administrations du Ministère des Armées. Des bases de données compilant notamment de l’information sociodémographique sur les territoires, de l’information sur les lieux visités lors des précédentes campagnes d’information, ou de l’information sur l’origine géographique et scolaire des recrues des années précédentes ont été produites. La cartographie réalisée, du fait de contraintes techniques, n’aura pas vocation a être mise à jour à l’avenir. A un mois de la fin du stage, il reste encore à produire plusieurs vues cartographiques du secteur, ainsi que les ressources pour permettre aux équipes d’utiliser et de comprendre les outils produits. L'évaluation des politiques publiques au travers des friches urbains. L'exemple du programme "Reconquête des friches en Occitanie". La Région Occitanie est la région la plus attractive de France avec plus de 50 000 nouveaux arrivants. Dans un contexte règlementaire qui demandent aux territoires de réduire de 50 % leurs rythmes d’artificialisation (ZAN), la Région Occitanie se doit de concilier l’accueille de nouvelles populations avec la préservation des ressources. Les friches et leurs reconversions apparaissent alors comme le levier adapté pour répondre à ces enjeux et notamment parvenir au Zéro Artificialisation Nette défini par le législateur. Néanmoins, faut-il encore donner la possibilité et la capacité aux territoires d’enclencher des projets de reconversion de friches long, techniques et couteux. C’est le défi que c’est donner la Région Occitanie avec l’appel à projet « Reconquête des friches en Occitanie » datant de 2018, qu’il convenait dorénavant d’évaluer. Cette politique publique a constitué le point de départ d’une réflexion touchant autant à la friche qu’à l’évaluation.
L'évaluation des politiques publiques au travers des friches urbains. L'exemple du programme "Reconquête des friches en Occitanie". La Région Occitanie est la région la plus attractive de France avec plus de 50 000 nouveaux arrivants. Dans un contexte règlementaire qui demandent aux territoires de réduire de 50 % leurs rythmes d’artificialisation (ZAN), la Région Occitanie se doit de concilier l’accueille de nouvelles populations avec la préservation des ressources. Les friches et leurs reconversions apparaissent alors comme le levier adapté pour répondre à ces enjeux et notamment parvenir au Zéro Artificialisation Nette défini par le législateur. Néanmoins, faut-il encore donner la possibilité et la capacité aux territoires d’enclencher des projets de reconversion de friches long, techniques et couteux. C’est le défi que c’est donner la Région Occitanie avec l’appel à projet « Reconquête des friches en Occitanie » datant de 2018, qu’il convenait dorénavant d’évaluer. Cette politique publique a constitué le point de départ d’une réflexion touchant autant à la friche qu’à l’évaluation. Cartographie des actions de recrutement Grand Est Du fait de sa position éloignée des côtes, la Région Grand-Est représente un défi majeur en ce qui concerne le recrutement de la Marine Nationale. Le Service de Recrutement de la Marine du secteur Grand-Est a donc créé un poste de stagiaire cartographe afin de faire un état des lieux des établissements intéressants, de compléter les bases de données existantes et enfin, créer plusieurs cartographies qui permettront à l’équipe du SRM d’avoir une meilleure vision de leurs champs d’action. La problématique la plus importante de ce stage a été l’adaptation pratique. En effet, travailler au sein du ministère des Armées engendre une réflexion sur les moyens utilisés, les logiciels et les accès à internet étant limités. Plusieurs méthodes ont donc été testées puis abandonnées. Le produit final sera donc un jeu de données sous forme de tableurs Excel ainsi que des cartographies réalisées à l’aide du logiciel MyMaps de Google. Seront aussi fournies des fiches méthodologiques afin que les cartographies puissent être réalisées, modifiées selon les besoins, par l’équipe du SRM. Ce stage a permis de mettre en évidence la nécessité d’adaptation du stagiaire. Le défi le plus important ici n’était pas de créer un outil très complexe mais bien de réaliser un outil répondant aux besoins des différents services du SRM Est, qui soit simple d’utilisation et pérenne afin de continuer à vivre et être mis à jour même après le départ du stagiaire.
Cartographie des actions de recrutement Grand Est Du fait de sa position éloignée des côtes, la Région Grand-Est représente un défi majeur en ce qui concerne le recrutement de la Marine Nationale. Le Service de Recrutement de la Marine du secteur Grand-Est a donc créé un poste de stagiaire cartographe afin de faire un état des lieux des établissements intéressants, de compléter les bases de données existantes et enfin, créer plusieurs cartographies qui permettront à l’équipe du SRM d’avoir une meilleure vision de leurs champs d’action. La problématique la plus importante de ce stage a été l’adaptation pratique. En effet, travailler au sein du ministère des Armées engendre une réflexion sur les moyens utilisés, les logiciels et les accès à internet étant limités. Plusieurs méthodes ont donc été testées puis abandonnées. Le produit final sera donc un jeu de données sous forme de tableurs Excel ainsi que des cartographies réalisées à l’aide du logiciel MyMaps de Google. Seront aussi fournies des fiches méthodologiques afin que les cartographies puissent être réalisées, modifiées selon les besoins, par l’équipe du SRM. Ce stage a permis de mettre en évidence la nécessité d’adaptation du stagiaire. Le défi le plus important ici n’était pas de créer un outil très complexe mais bien de réaliser un outil répondant aux besoins des différents services du SRM Est, qui soit simple d’utilisation et pérenne afin de continuer à vivre et être mis à jour même après le départ du stagiaire. Etat des lieux pour la mise en place d'un WebSIG standard pour les communes Le rapport de stage est un élément cruciale du stage puisqu’il permet la synthétisation des différentes étapes de celui-ci en les décrivant et permettant une analyse critique. Ce stage s’inscrit dans une démarche pédagogique afin d’apporter à la formation un aspect professionnalisant, en s’intégrant directement dans une entreprise et, par conséquent, dans le monde du travail. L’objectif est de mettre en application les connaissances apprises durant les premiers mois du master et de les compléter par des nouvelles. Pour cela, j’ai effectué un stage de trois mois dans le but de m’instruire d’avantage sur les compétences à acquérir. J’ai donc effectué des démarches de recherches de structure de stage. De plus, j’ai pu découvrir de nombreuses fonctionnalités en termes de recherches, de bases de données, de fonctionnalités sous le logiciel Open-Source QGIS mais également de rédaction de documentation pour la reprise de mes projets, par les membres de l’équipe. Effectivement, mes réalisations seront mises à jour régulièrement par Géomatika à la suite de mon stage. Grâce à ces réalisations, j’ai obtenu, suite à la réalisation de différents projets, des résultats sur les tâches effectuées. Effectivement, à la fin du stage, nous obtenons un catalogue de métadonnées complets et conformes à la norme INSPIRE, ainsi que plusieurs projets QGIS sur la thématique du cadastre/urbanisme. Pour leur réalisation, des recherches et de la méthodologie ont été indispensable pour aboutir à un travail rigoureux.
Etat des lieux pour la mise en place d'un WebSIG standard pour les communes Le rapport de stage est un élément cruciale du stage puisqu’il permet la synthétisation des différentes étapes de celui-ci en les décrivant et permettant une analyse critique. Ce stage s’inscrit dans une démarche pédagogique afin d’apporter à la formation un aspect professionnalisant, en s’intégrant directement dans une entreprise et, par conséquent, dans le monde du travail. L’objectif est de mettre en application les connaissances apprises durant les premiers mois du master et de les compléter par des nouvelles. Pour cela, j’ai effectué un stage de trois mois dans le but de m’instruire d’avantage sur les compétences à acquérir. J’ai donc effectué des démarches de recherches de structure de stage. De plus, j’ai pu découvrir de nombreuses fonctionnalités en termes de recherches, de bases de données, de fonctionnalités sous le logiciel Open-Source QGIS mais également de rédaction de documentation pour la reprise de mes projets, par les membres de l’équipe. Effectivement, mes réalisations seront mises à jour régulièrement par Géomatika à la suite de mon stage. Grâce à ces réalisations, j’ai obtenu, suite à la réalisation de différents projets, des résultats sur les tâches effectuées. Effectivement, à la fin du stage, nous obtenons un catalogue de métadonnées complets et conformes à la norme INSPIRE, ainsi que plusieurs projets QGIS sur la thématique du cadastre/urbanisme. Pour leur réalisation, des recherches et de la méthodologie ont été indispensable pour aboutir à un travail rigoureux. L'inclusion des personnes en situation de handicap dans les sports de nature, un vecteur de développement territorial Ce mémoire propose d’étudier la question de l’inclusion des personnes en situation de handicap dans les sports de nature en tant que vecteur de développement territorial. Favoriser l’inclusion des personnes en situation de handicap dans les sports de nature peut constituer une porte d’entrée à une meilleure inclusion de ces personnes dans notre société de manière générale. En effet, bien qu’ayant fait l’objet d’évolutions législatives depuis le début des années 2000, la question du handicap est encore à travailler et un cheminement, non seulement en termes d’évolution des mentalités, mais aussi au niveau de l’inclusion de cette problématique dans les politiques publiques reste à faire.
L'inclusion des personnes en situation de handicap dans les sports de nature, un vecteur de développement territorial Ce mémoire propose d’étudier la question de l’inclusion des personnes en situation de handicap dans les sports de nature en tant que vecteur de développement territorial. Favoriser l’inclusion des personnes en situation de handicap dans les sports de nature peut constituer une porte d’entrée à une meilleure inclusion de ces personnes dans notre société de manière générale. En effet, bien qu’ayant fait l’objet d’évolutions législatives depuis le début des années 2000, la question du handicap est encore à travailler et un cheminement, non seulement en termes d’évolution des mentalités, mais aussi au niveau de l’inclusion de cette problématique dans les politiques publiques reste à faire.