-
 Les différences biologiques entre le corps des femmes et celui des hommes dans la Collection Hippocratique.
Les différences biologiques entre le corps des femmes et celui des hommes dans la Collection Hippocratique. Ce mémoire a pour but d’étudier l’implication des représentations du corps féminin sur les hiérarchies sociales. C’est à partir des traités médicaux de la Collection Hippocratique que nous avons cherché des éléments de réponses. C’est dans une perspective du médicale et du genre que s’inscrit ce mémoire afin de comprendre si les différences biologiques évoquées par les médecins hippocratiques entrainent une hiérarchisation des corps féminins et masculins.
-
 Méthodologie de fouille, enregistrement et relevé des structures archéologiques en contexte préventif au travers des approches d’Archeodunum et de l’Inrap.
Méthodologie de fouille, enregistrement et relevé des structures archéologiques en contexte préventif au travers des approches d’Archeodunum et de l’Inrap. Ce mémoire de stage porte sur les méthodes de fouilles, de relevés et d'enregistrements utilisées lors d'une fouille en contexte protohistorique sur une opération préventive de l'opérateur Archeodunum ainsi que sur les méthodes d'enregistrement topographique sur les opérations préventives de l'Inrap.
-
 Le geste créateur au sein d'une œuvre - Lumière sur la beauté du geste
Le geste créateur au sein d'une œuvre - Lumière sur la beauté du geste Au cours de mes études en Master 2 Design de Produit, j’ai réalisé une thèse sur le thème du geste dans la création. A travers ce projet, j’ai voulu orienter ma recherche vers le domaine d’application de mon projet professionnel, la fonderie. J’ai matérialisé ma problématique au début de mes recherches : comment le designer peut-il exprimer son geste créateur dans la fonderie ?
J’ai choisi de développer ma recherche à travers plusieurs parties afin de séquencer mes remarques. Mon plan de recherche s’articule autour d’une première partie historique afin d’expliquer la fonderie en profondeur et son utilité. Dans cette partie, j’ai développé et défini le vocabulaire technique de la fonderie ainsi que celui du geste. Dans un second temps, j’ai approfondi le domaine de l’artisanat dans le monde moderne afin de recontextualiser le reste de mes recherches. Je me suis inspiré des écrits d’André Leroi-Gourhan, ethnologue, archéologue et historien français, spécialiste de la préhistoire. Enfin, j’ai délimité le domaine du geste créatif et du design de produit en définissant mon travail comme celui d’un artisan designer. J’ai également développé la notion de geste dans la création et défini son impact sur le créateur et son objet final.
Pour conclure, j’ai défini le geste créatif comme partie intégrante d’un projet, de sa naissance à sa mort, car il est inséparable de la conception, de la réalisation et de l’utilisation de l’objet.
-
 Merchandising Sensoriel, Expographie d’apprentissage de l’information
Merchandising Sensoriel, Expographie d’apprentissage de l’information Nous vivons dans un monde basé sur la consommation de masse et cela n'a souvent aucun sens. Nos points de vente sont impersonnels. Nous n' apprenons absolument aucune leçon ou expérience de notre acte d'achat. Alors, je me suis interrogé sur le rôle du design sensoriel et son influence directe sur le design de nos points de vente.
L'information est un droit et c'est pourquoi je souhaite la clarifier et la rendre accessible. L'information fonctionnelle et technique est une connaissance précieuse. Trop de gens sont détachés de ce qu'ils achètent et ne comprennent pas comment fonctionne ce qu'ils achètent. La conséquence directe est une surconsommation liée à leur méconnaissance.
J'ai donc besoin d'identifier le système puis de le développer et de l'exposer afin de comprendre son fonctionnement technique. La portée de mon projet est double. Je dois d'abord expliquer les principes de conception et ensuite utiliser le sens comme une démarche pédagogique.
L'objectif est de démontrer le rôle de la pédagogie dans la création du point de vente. Il s'agit donc d'extraire les enjeux du point de vente d'une part et de les exploiter d'autre part pour qu'ils s'intègrent et deviennent force de proposition dans le système établi. Et ainsi démontrer que le point de vente repose sur un système d'échange proposant une expérience empirique à portée pédagogique.
-
 Leurs images, nos histoires …
Leurs images, nos histoires … Ma recherche s’intéresse, aux artistes des années 2000 s’appropriant des images existantes, pour la plupart, elles sont d'amateurs, restreintes au cercle familial. Charbert Garance et Mole Aurélien définissent ces artistes comme étant des artistes iconographes. La démarche créative de ces artistes consiste à nourrir un fonds iconographique, assembler et rediffuser les images sans les modifier.
Pour appuyer mon propos, je m’appuierais sur Les artistes iconographes de Chabert Garance et Mole Aurélien et sur la thèse de Détré Natacha « Les relecteurs d’images » : une pratique contemporaine de collectes, d’association et de rediffusion d’images photographiques.
Il sera donc question ici d’analyser les dispositifs plastiques mis en œuvre afin de revaloriser les images, réactiver les souvenirs. Pour cela, j’ai décidé d’analyser trois objets éditoriaux, Après, on oublie de Bruno Dubreuil (I), Revue en 4 images de Céline Duval (II) et Rachel, Monique... de Sophie Calle (III). Je décrirai dans un premier temps les objets dans leur ensemble. Ensuite, leur processus de création jusqu’au choix du dispositif de rediffusion afin de déterminer en comment les relations entretenues par les artistes avec ces images influencent le dispositif de rediffusion final quant à la réactivation des souvenirs.
-
 Altérer la lisibilité
Altérer la lisibilité À partir d’un travail photographique expérimentant les limites de la lisibilité d’une typographie, je me suis questionnée sur le rapport entre la plasticité et l’altération de la lisibilité. L’enjeu de cette réflexion est de comprendre pourquoi et comment l’altération de la lisibilité crée différentes formes de plasticité, c’est à dire différentes esthétiques formelles. La première partie vise à expliquer la différence entre lecture et regard grâce à divers articles scientifiques. En effet, lire, c’est décoder le langage écrit, tandis que regarder, c’est préter une attention particulière à la forme. Nous chercherons à comprendre les mécanismes physiologiques de ces deux actions. La seconde partie constitue une analyse du travail de différents designers dont Herbert Lubalin, Ruslan Khazanov et David Carson, qui jouent avec les limites de la lisibilité dans leurs créations à l’échelle de la lettre, du mot ou du texte dans son entièreté. Nous chercherons à définir comment divers procédés d’altération de la lisibilité créent différentes formes de plasticités.
-
 Numérique entre continuité et rupture
Numérique entre continuité et rupture Dans ma pratique personnelle, je travaille principalement sur l’outil du numérique mais j’aime l’appliquer sur différents supports, comme le papier, le tissu par exemple. Je me suis alors demandée quel est le rôle du numérique dans la création graphique. J’ai pu observer dans un premier temps que le numérique marque une rupture dans la perception de la représentation de la nature, par l’apparition de la photographie et du cinéma, mais aussi dans le processus de création graphique. Dans un second temps, je questionne le fait que celui-ci soit
une continuité de plusieurs techniques et outils, regroupés dans un seul outil. En effet, on remarque que le numérique reprend les codes d’anciennes techniques et les modifie pour permettre un processus de création plus rapide et les synthétise pour qu’elles puissent être utilisées numériquement ; exemple : nous pouvons dessiner numériquement avec des outils comme de la peinture.
Nous pouvons donc dire que le numérique, malgré une rupture dans la perception de l’art, reste une continuité dans le processus de création.
-
 Pratiques digitales - Les formes de publication contemporaine
Pratiques digitales - Les formes de publication contemporaine Pour la réalisation de ce mémoire, je me suis intéressé à l’évolution dans notre manière de publier un contenu. Mes recherches m’ont menée à plusieurs formes de publications : du fanzine jusqu’aux réseaux sociaux, comme Instagram. J’ai alors remarqué que le fanzine, publication expérimentale, libre et autonome. Fabriqué pour et par des passionnés, c’est un laboratoire qui montre une grande impulsion artistique. Il existe pour libérer et exprimer les désirs artistiques et graphiques à travers le dessin, la récolte d’image, l’écriture, le collage...
Mais... aujourd’hui ? Comment partageons-nous nos derniers sujets passionnants ?
J’ai pu analyser, avec l’arrivée des nouvelles technologies et des réseaux sociaux, qu’une incontestable numérisation est apportée dans la conception d’un contenu. Instagram en est un exemple. En effet, l’application engage la publication en ligne pour partager son contenu avec des photos et des images. Ainsi, j’ai mis en avant la création d’une polarité entre la pratique manuelle et numérique. J’ai investi l’espace entre ces deux pôles par la réflexion et la conception du fanzine.
Le métissage a donné une mise en parallèle et non une opposition des techniques. Grâce à cet assemblage d’outils et cette manière de faire, j’ai pu imaginé l’apparition d’une nouvelle esthétique.
-
 La sémantique du pli
La sémantique du pli Tout a commencé avec ma collection de nombreux flyers et dépliants graphiques rapportés de magasins locaux. À partir de cette collecte, je me suis interrogée sur la relation entre une identité visuelle et le pli éditorial. Pour cela, je me suis appropriée la pratique du pli par une approche sémantique. La sémantique du pli, est l'intérêt que je porte à cette étude et sur lequel je vais approfondir à travers des lectures sémiologiques et philosophiques. Comment développer du sens à travers la pratique du pli dans le design graphique ? Selon ma démarche, l'acte de plier, c’est reconfigurer, mettre en relation des éléments et en faire apparaître de nouveaux. Nous allons analyser les formes du pli parmi une sélection pertinente de projets en design, qui vont permettre d'appuyer les idées. Ainsi, nous allons démontrer que le pli peut être porteur de sens et qu'il peut apporter une valeur ajoutée à une identité graphique. Afin de développer cette recherche, j’ai pratiqué le pliage à travers mes propres expérimentations, d'après celles-ci, j’ai élaboré des catégories plastiques, qui différencient chaque type de pliages selon leur usage. Les analyses entreprises sont de l'ordre de l'interprétation, elles abordent le besoin fonctionnel ou artistique de chaque projet.
-
 Graphiste collectionneuse - La pratique de la collection, une démarche pour la création graphique
Graphiste collectionneuse - La pratique de la collection, une démarche pour la création graphique Ce mémoire a pour sujet la pratique de la collection comme démarche pour la création graphique. En tant que graphiste collectionneuse, je me suis questionnée sur l’impact de la collection sur le travail de graphiste. Nous sommes tous les jours amené à créer et nous sommes constamment inondés d’informations au quotidien, ce qui est une immense source d’inspiration. Or, dans toutes ces informations, il faut savoir faire la part des choses et sélectionner les éléments nous correspondant et reflétant au mieux notre univers graphique. Pour cela, la pratique de la collection est un très bon outil. Étant collectionneuse avant d’être graphiste, j’ai pris conscience de la place de mes collections dans mon processus graphique. Ce sont elles qui influencent chacune de mes réalisations, par les formes, les couleurs, les aspects et les textures qui les composent. J’ai donc voulu comprendre comment la pratique de la collection influence la création graphique.
Tout au long de ces écrits, je vous présenterais l’analyse de la collection sous différentes formes : comment et quand est apparu le principe de collection et qui sont réellement les collection‐ neurs. Afin de faire le lien entre collection et création graphique, j’analyserais différents cas de personnes dont la pratique de la collection a un impact sur la création. Ainsi en découlera la méthode du Penser/Classer, faisant partie intégrante du processus de création. De ces expli‐ cations, je parlerais de mon approche personnelle de la collection, de ma pratique et de son impact sur mon processus créatif. Par la suite et pour conclure, je mettrais en avant ma posture et mes engagements de graphiste collectionneuse au sein de mon projet professionnel, en abordant la création d’un jeu de 7 familles sur les plantes aromatiques.
-
 Design couleur et matière : matériaux innovants et bien-être
Design couleur et matière : matériaux innovants et bien-être Dans cette société industrialisée, production de masse et standardisation ont transformé notre quotidien et nos espaces. En perte de sensibilité face aux matériaux lisses et neutres, nous avons développé du stress et de l’anxiété. Les textures, les couleurs, les ambiances chromatiques, tout ce qui se trouve dans notre environnement affecte notre comportement et notre santé mentale et physique. Alors, comment un matériau, élaboré au moyen du design couleur, pourrait-il traduire la notion de bien-être à travers la sensorialité ?
Le travail s’est orienté autour de l’étude des sensations d’apaisement et de confort par l’approche de différentes disciplines, de différents environnements et d’états émotionnels. L’objectif fixé était de créer une matérialisation sensible du bien-être par la relation entre la couleur et la matière issue de la nature.
Notre connexion innée avec la nature, fragilisée par l’industrie et la technologie nous a poussé à intégrer des éléments naturels dans notre quotidien. Synonyme de bien-être, le design biophilique nous apporte une réponse sur la manière de façonner nos espaces et nos textiles. Lenteur, complexité, aspérités, vivant, durabilité, le modèle de la nature nous donne à voir et à penser différemment.
-
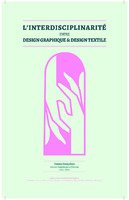 L'interdisciplinarité entre design graphique et design textile
L'interdisciplinarité entre design graphique et design textile Tiraillée entre le design graphique et le design textile depuis de nombreuses années, j’ai découvert par le biais d’un stage le métier de graphiste textile. Ce qui a particulièrement attiré mon attention, c’est son positionnement complexe, car ce nouveau corps de métier se situe à la frontière entre le design graphique, soit l’usage du signe et son interprétation, mais aussi de la mode, de l’univers textile. C’est grâce à cette approche interdisciplinaire qu’est né ce mémoire. De plus en plus de graphistes se tournent vers le monde du textile, de ce fait ma problématique visait à questionner cette nouvelle forme de graphismes, ses enjeux et ses questionnements. Ce mémoire a été réalisé grâce à une enquête par questionnaire proposée à des professionnels touchés par cette relation étroite qu’entretiennent ces deux champs du design (designer textile, designer graphique, designer textile de surface, graphiste textile).
Face à l’évolution constante de ce métier et notamment de son intégration dans une multitude d’entreprises, nous avons essayé à travers ce mémoire de mieux comprendre pourquoi ces deux domaines du design sont constamment dissociés alors que de nombreuses compétences les rapprochent. Et si le métier de designer graphique textile résultait d’un besoin par les graphistes de mettre en mouvement leurs créations, de les laisser entrer dans notre quotidien ?
L’approche par questionnaire a permis de soulever de nouvelles questions quant à l’adaptation à de nouveaux supports par les designers graphiques, mais encore l’usage du signe à travers cette interdisciplinarité ou la carence en formation textile qui limite l’accessibilité à ce métier. Mais la réelle constatation repose sur l’idée que le design se doit aujourd’hui d’être pluridisciplinaire a n de ne jamais cesser d’évoluer.
-
 L'atelier pédagogique de pratique graphique
L'atelier pédagogique de pratique graphique Cet écrit s’inscrit dans la lignée d’une réflexion autour d’expériences personnelles
dans le milieu de l’atelier pédagogique de pratique graphique. Motivée
par l’idée de construire des ateliers cohérents et impactant dans le temps
pour le participant, nous centrons notre réflexion sur l’importance de la remise
en question de la posture du médiateur. Premièrement nous cherchons à établir
dans quel contexte politique et social s’inscrit l’atelier. En quelques mots,
l’atelier pédagogique se compose de trois acteurs : l’enfant, le médiateur et
la pratique graphique. Notre démarche est d’examiner les liens qui existent
entre eux. À partir de cela, nous avons souligné le rapport de domination entre
l’adulte et l’enfant qui biaise la transmission dans l’atelier. Le médiateur, si
il déconstruit sa posture, peut être celui qui optimise la relation et l’atelier
comme espace collectif de transmission horizontale. Comment le graphiste
ou l’artiste en tant que médiateur peut apporter des méthodes de création et
de transmission pour l’enfant ? Ces recherches permettent de proposer de
nouveaux fondements pour le médiateur et l’atelier, visant à encourager une
mise en pratique d’atelier pédagogique engagé.
-
 Datavisualisation. Dépassez la didactique.
Datavisualisation. Dépassez la didactique. L'objet de ce mémoire est les nouvelles pratiques de datavisualisation, qui apparaissent au début des années 2008.
La datavisualisation est un outil qui permet de contextualiser et de comparer des données.
Initialement conçue comme un outil mnémonique et didactique, les dimensions esthétiques et heuristiques de la datavisualisation séduisent les data designers contemporains. Leur pratique singulière interroge : la datavisualisation doit-elle toujours être didactique ?
Dans un premier temps, j'ai analysé l'héritage pratique de la datavisualisation depuis l'Antiquité, et la façon dont elle a été utilisée comme outil didactique au cours de l'histoire. Ensuite, j'ai mis en évidence ses dimensions esthétiques et heuristiques à partir d'un corpus de datavisualisations contemporaines. J'ai montré que les dimensions esthétiques et heuristiques de la datavisualisation tendent aujourd'hui à passer au second plan par rapport à la dimension didactique. Cette analyse tend à montrer que les data designers encouragent une nouvelle pratique de la datavisualisation pour relever les défis du 21e siècle.
-
 Les arts graphiques à travers le modèle du vivant
Les arts graphiques à travers le modèle du vivant Je me plais à marcher dans la nature, particulièrement dans la montagne et découvrir toutes les faces cachées de cette vie surprenante.
C'est pour cette raison que mon premier souhait pour ce tout dernier projet d'études, était de mêler ma pratique de graphisme avec la nature.
Mais c'était un gros challenge, car cela inclut de nombreux éléments, c'est pour cela que j'ai décidé de me concentrer plus précisément sur les êtres vivants.
Je me suis ainsi questionnée sur les ressemblances entre les êtres vivants et le design graphique.
Ma méthode a donc consisté à rechercher les nombreux principes de la faune et de la flore parmi certains ouvrages biologiques, voire même scientifiques, afin de montrer les similitudes dans la création graphique.
Pour cela, j'ai utilisé mes connaissances dans l'histoire du graphisme et les ai mises en relation avec les différentes caractéristiques des créatures vivantes.
J'ai ainsi révélé de nombreux facteurs communs entre ces deux éléments, qui sont finalement assez proches. Les processus de création, de développement, d'organisation, d'adaptation, de renouvellement et de nombreux autres issus du vivant, sont des systèmes communs aux arts graphiques.
-
 Le Design, en mouvement ! : le motion design comme nouvelle forme de pratique artistique.
Le Design, en mouvement ! : le motion design comme nouvelle forme de pratique artistique. Lorsque j'ai choisi mon sujet de mémoire de fin d'études, je voulais pouvoir faire un lien entre mes deux parcours d'études, qui sont l'animation et le graphisme. Quand on pense à ces deux domaines, on en vient souvent à les réunir dans la technique du motion design. Le motion design est une technique d'animation que j'apprécie car elle me permet d'utiliser l'ensemble des compétences que j'ai acquises tout au long de mon parcours d'études, à la fois en animation et en design. En l'expérimentant, j'ai découvert tout ce que cette technique apportait à mon travail. J'ai aussi réalisé que cette technique était aussi souvent mal comprise. Faisant suite aux avancées techniques des logiciels informatiques, cette technique est devenue depuis peu un outil incontournable pour une communication graphique efficace au service d'un produit ; le motion design tend à se réduire à un outil de marketing, simple technique du design graphique.
Dans cette recherche, je voudrais démontrer que le motion-design est une forme d'art à part entière, et comment en s'intéressant à son histoire et en analysant ses caractéristiques, nous voyons apparaître des clés pour comprendre l'apparition de nouvelles formes artistiques. J'ai souhaité mon sujet de mémoire en phase avec les enjeux de notre génération actuelle, participant à contrer l'idée selon laquelle le développement des technologies irait à l'encontre de la création artistique. Selon moi, le motion design est une forme d'art qui a ouvert le monde des arts visuels à de nouvelles perspectives, riches, qui continueront à nous surprendre à l'avenir.
-
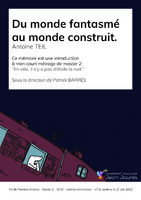 Du monde fantasmé au monde construit.
Du monde fantasmé au monde construit. Il s'agit d'identifier des méthodes de création pour la réalisation d'un court métrage.
Dans une première partie, nous allons déterminer la façon dont je présente l’histoire de ce
court métrage, et répondre à la question que je me suis posée , ‘‘comment raconter cette histoire ?’’
C’est la mise en place de déterminants : cadres et personnages (interactions, déclinaisons,
modulations), que nous analyserons dans une deuxième partie.
Enfin, je vous livrerai l’état d’esprit émotionnel, la vraie raison de ce sujet qui aboutit à ce court métrage. Il s’agit du film fantasmé que l’on peut rapprocher de la notion de ‘‘non film’’.
L’objectif de mon court métrage et de ce mémoire, met en exergue l’idée de ‘‘film fantasmé’’. C’est pour moi, créer sans être centré sur le ‘‘faire bien’’, pour rejoindre l’idée de ‘‘mal faire’’ comme un rêve incomplet et déconstruit mais qui compose un tout pour forger une identité.
-
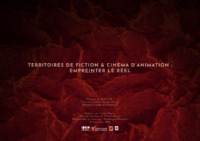 Territoires de fiction & cinéma d'animation : empreinter le réel
Territoires de fiction & cinéma d'animation : empreinter le réel Mon travail porte sur le lieu/le site et la façon dont nous l'habitons. Pour être plus précis, je fais référence à la grotte préhistorique et aux traces qui y sont laissées. J'avais personnellement besoin de renouer avec des points d'origine, en l'occurrence la naissance de la représentation et plus généralement des arts, et la naissance d'une conscience embryonnaire chez l'humain. C'est quelque chose qui fait écho, quand on s'y intéresse, aux recherches et hypothèses archéologiques actuelles : la naissance du cinéma ne remonte peut-être pas aux frères Lumières, mais à la préhistoire, après reconstitution d'objets semblables à des jouets optiques et observation de différentes décompositions de temps/mouvement dans les peintures rupestres, faisant de ces fresques de véritables récits graphiques. J'ai trouvé intéressant de penser que cet homme (préhistorique) en était déjà là dans son développement et sa pratique, imprimant sa part d'humanité sur le mur.
J'ai travaillé et étudié la matériologie de la paroi, ses reliefs, ses aspérités, comment elle formait une toile. De plus, j'ai opté pour une mise en scène par ombres, c'est-à-dire qu'on ne voit aucun personnage, tout se passe au mur, par jeu d'ombres. Ce qui est intéressant, c'est toute cette méthodologie de travail que j'ai dû inventer, me réapproprier. Inventer un système de projection pour animer la matière originelle (l'argile) sur une plaque de verre, récupérer (ou capter) les ombres, s'abandonner à ce qu'elle nous offre et nous montre. Ce fut une expérience de créateur mais aussi de spectateur, de conteur.
-
 Judas One Anecdote Show
Ciné-graphisme et character design dans un film à sketch.
Judas One Anecdote Show
Ciné-graphisme et character design dans un film à sketch. Le cinéma d’animation est souvent perçu comme différent du cinéma en « prises
réelles » parce que les acteurs sont remplacés par des personnages dessinés ou
des marionnettes. Mais en fait les grandes étapes sont les mêmes, et cela quelle
que soit la technique utilisée : le cinéma d’animation c’est du cinéma !
La question du dessin est au cœur du développement et du renouvellement des
conduites créatrices et des pratiques de recherches du cinéma d’animation. Le dessin
conjugue ce qui tient au domaine de l’esprit, au projet et à l’activité de conception
et ce qui se rapporte au mode d’expression, la proposition. L’animation est
constituée de 2 pôles : le dessin et la technologie. Le second donne vie au premier.
L’objectif de ce mémoire est de retranscrire les questionnements, pistes de travail
et techniques utilisées pour créer le pilote d’une série d’animation, basée sur
le dessin au trait, à destination de producteurs dans le domaine de l’animation.
La première partie théorise les questionnements et choix techniques faits pour ce
projet, la seconde partie présente le projet par ordre chronologique de réalisation
jusqu’au pilote final.
-
 Kino-Scénographie, une plasmaticité débridée
Kino-Scénographie, une plasmaticité débridée Durant mes deux années d'études à l'Institut Supérieur
Couleur Image Design, parcours cinéma d'animation, le projet de
création sur lequel je travaille s'intitule Le corbeau qui chercha sa
plume. Essayant de sortir le cinéma d'animation de son cadre classique,
je me penche sur une problématique qui est en deux parties.
La première concerne la manière dont je vais pouvoir mettre
en place une Kino-scénographie. La seconde partie se concentre
sur une pratique de plasmaticité débridée. L'intitulé "Kino-scénographie"
désigne la mise en oeuvre d'une installation polyptyque
sur laquelle est projeté une animation. Et la «plasmaticité» est un
concept inventé par Eisenstein, qui se définit par la mobilité des
formes plastiques. Formes que je vais alors adapter au dispositif.
L'objectif de ce travail est de proposer au public une expérience
nouvelle qui combine les notions du film et de l’œuvre d'art.
Ma recherche commence par une poïétique du chaos. À
travers une démarche qui met en exergue le geste spontané et
instinctif, j'instaure un nouveau processus qui rompt avec les codes
traditionnels du cinéma. C'est un sentiment de nécessité qui m'a
amené vers la recherche d'une autre méthode d'expression, impliquant
alors le geste, la texture et le hasard. Je travaille la peinture
animée avec de la peinture acrylique et j’étudie tous les états du
matériau. Par la suite, je tente de rationaliser ces actes plastiques en
classant les différents motifs. Afin d'appliquer mes images animées
à mon dispositif d'invention, j'exploite les notions du vidéo-mapping.
Au fil de ces expériences, je mets alors en place une scénographie
animée et expressive qui offre une expérience immersive.
 Les différences biologiques entre le corps des femmes et celui des hommes dans la Collection Hippocratique. Ce mémoire a pour but d’étudier l’implication des représentations du corps féminin sur les hiérarchies sociales. C’est à partir des traités médicaux de la Collection Hippocratique que nous avons cherché des éléments de réponses. C’est dans une perspective du médicale et du genre que s’inscrit ce mémoire afin de comprendre si les différences biologiques évoquées par les médecins hippocratiques entrainent une hiérarchisation des corps féminins et masculins.
Les différences biologiques entre le corps des femmes et celui des hommes dans la Collection Hippocratique. Ce mémoire a pour but d’étudier l’implication des représentations du corps féminin sur les hiérarchies sociales. C’est à partir des traités médicaux de la Collection Hippocratique que nous avons cherché des éléments de réponses. C’est dans une perspective du médicale et du genre que s’inscrit ce mémoire afin de comprendre si les différences biologiques évoquées par les médecins hippocratiques entrainent une hiérarchisation des corps féminins et masculins. Méthodologie de fouille, enregistrement et relevé des structures archéologiques en contexte préventif au travers des approches d’Archeodunum et de l’Inrap. Ce mémoire de stage porte sur les méthodes de fouilles, de relevés et d'enregistrements utilisées lors d'une fouille en contexte protohistorique sur une opération préventive de l'opérateur Archeodunum ainsi que sur les méthodes d'enregistrement topographique sur les opérations préventives de l'Inrap.
Méthodologie de fouille, enregistrement et relevé des structures archéologiques en contexte préventif au travers des approches d’Archeodunum et de l’Inrap. Ce mémoire de stage porte sur les méthodes de fouilles, de relevés et d'enregistrements utilisées lors d'une fouille en contexte protohistorique sur une opération préventive de l'opérateur Archeodunum ainsi que sur les méthodes d'enregistrement topographique sur les opérations préventives de l'Inrap. Le geste créateur au sein d'une œuvre - Lumière sur la beauté du geste Au cours de mes études en Master 2 Design de Produit, j’ai réalisé une thèse sur le thème du geste dans la création. A travers ce projet, j’ai voulu orienter ma recherche vers le domaine d’application de mon projet professionnel, la fonderie. J’ai matérialisé ma problématique au début de mes recherches : comment le designer peut-il exprimer son geste créateur dans la fonderie ? J’ai choisi de développer ma recherche à travers plusieurs parties afin de séquencer mes remarques. Mon plan de recherche s’articule autour d’une première partie historique afin d’expliquer la fonderie en profondeur et son utilité. Dans cette partie, j’ai développé et défini le vocabulaire technique de la fonderie ainsi que celui du geste. Dans un second temps, j’ai approfondi le domaine de l’artisanat dans le monde moderne afin de recontextualiser le reste de mes recherches. Je me suis inspiré des écrits d’André Leroi-Gourhan, ethnologue, archéologue et historien français, spécialiste de la préhistoire. Enfin, j’ai délimité le domaine du geste créatif et du design de produit en définissant mon travail comme celui d’un artisan designer. J’ai également développé la notion de geste dans la création et défini son impact sur le créateur et son objet final. Pour conclure, j’ai défini le geste créatif comme partie intégrante d’un projet, de sa naissance à sa mort, car il est inséparable de la conception, de la réalisation et de l’utilisation de l’objet.
Le geste créateur au sein d'une œuvre - Lumière sur la beauté du geste Au cours de mes études en Master 2 Design de Produit, j’ai réalisé une thèse sur le thème du geste dans la création. A travers ce projet, j’ai voulu orienter ma recherche vers le domaine d’application de mon projet professionnel, la fonderie. J’ai matérialisé ma problématique au début de mes recherches : comment le designer peut-il exprimer son geste créateur dans la fonderie ? J’ai choisi de développer ma recherche à travers plusieurs parties afin de séquencer mes remarques. Mon plan de recherche s’articule autour d’une première partie historique afin d’expliquer la fonderie en profondeur et son utilité. Dans cette partie, j’ai développé et défini le vocabulaire technique de la fonderie ainsi que celui du geste. Dans un second temps, j’ai approfondi le domaine de l’artisanat dans le monde moderne afin de recontextualiser le reste de mes recherches. Je me suis inspiré des écrits d’André Leroi-Gourhan, ethnologue, archéologue et historien français, spécialiste de la préhistoire. Enfin, j’ai délimité le domaine du geste créatif et du design de produit en définissant mon travail comme celui d’un artisan designer. J’ai également développé la notion de geste dans la création et défini son impact sur le créateur et son objet final. Pour conclure, j’ai défini le geste créatif comme partie intégrante d’un projet, de sa naissance à sa mort, car il est inséparable de la conception, de la réalisation et de l’utilisation de l’objet. Merchandising Sensoriel, Expographie d’apprentissage de l’information Nous vivons dans un monde basé sur la consommation de masse et cela n'a souvent aucun sens. Nos points de vente sont impersonnels. Nous n' apprenons absolument aucune leçon ou expérience de notre acte d'achat. Alors, je me suis interrogé sur le rôle du design sensoriel et son influence directe sur le design de nos points de vente. L'information est un droit et c'est pourquoi je souhaite la clarifier et la rendre accessible. L'information fonctionnelle et technique est une connaissance précieuse. Trop de gens sont détachés de ce qu'ils achètent et ne comprennent pas comment fonctionne ce qu'ils achètent. La conséquence directe est une surconsommation liée à leur méconnaissance. J'ai donc besoin d'identifier le système puis de le développer et de l'exposer afin de comprendre son fonctionnement technique. La portée de mon projet est double. Je dois d'abord expliquer les principes de conception et ensuite utiliser le sens comme une démarche pédagogique. L'objectif est de démontrer le rôle de la pédagogie dans la création du point de vente. Il s'agit donc d'extraire les enjeux du point de vente d'une part et de les exploiter d'autre part pour qu'ils s'intègrent et deviennent force de proposition dans le système établi. Et ainsi démontrer que le point de vente repose sur un système d'échange proposant une expérience empirique à portée pédagogique.
Merchandising Sensoriel, Expographie d’apprentissage de l’information Nous vivons dans un monde basé sur la consommation de masse et cela n'a souvent aucun sens. Nos points de vente sont impersonnels. Nous n' apprenons absolument aucune leçon ou expérience de notre acte d'achat. Alors, je me suis interrogé sur le rôle du design sensoriel et son influence directe sur le design de nos points de vente. L'information est un droit et c'est pourquoi je souhaite la clarifier et la rendre accessible. L'information fonctionnelle et technique est une connaissance précieuse. Trop de gens sont détachés de ce qu'ils achètent et ne comprennent pas comment fonctionne ce qu'ils achètent. La conséquence directe est une surconsommation liée à leur méconnaissance. J'ai donc besoin d'identifier le système puis de le développer et de l'exposer afin de comprendre son fonctionnement technique. La portée de mon projet est double. Je dois d'abord expliquer les principes de conception et ensuite utiliser le sens comme une démarche pédagogique. L'objectif est de démontrer le rôle de la pédagogie dans la création du point de vente. Il s'agit donc d'extraire les enjeux du point de vente d'une part et de les exploiter d'autre part pour qu'ils s'intègrent et deviennent force de proposition dans le système établi. Et ainsi démontrer que le point de vente repose sur un système d'échange proposant une expérience empirique à portée pédagogique. Leurs images, nos histoires … Ma recherche s’intéresse, aux artistes des années 2000 s’appropriant des images existantes, pour la plupart, elles sont d'amateurs, restreintes au cercle familial. Charbert Garance et Mole Aurélien définissent ces artistes comme étant des artistes iconographes. La démarche créative de ces artistes consiste à nourrir un fonds iconographique, assembler et rediffuser les images sans les modifier. Pour appuyer mon propos, je m’appuierais sur Les artistes iconographes de Chabert Garance et Mole Aurélien et sur la thèse de Détré Natacha « Les relecteurs d’images » : une pratique contemporaine de collectes, d’association et de rediffusion d’images photographiques. Il sera donc question ici d’analyser les dispositifs plastiques mis en œuvre afin de revaloriser les images, réactiver les souvenirs. Pour cela, j’ai décidé d’analyser trois objets éditoriaux, Après, on oublie de Bruno Dubreuil (I), Revue en 4 images de Céline Duval (II) et Rachel, Monique... de Sophie Calle (III). Je décrirai dans un premier temps les objets dans leur ensemble. Ensuite, leur processus de création jusqu’au choix du dispositif de rediffusion afin de déterminer en comment les relations entretenues par les artistes avec ces images influencent le dispositif de rediffusion final quant à la réactivation des souvenirs.
Leurs images, nos histoires … Ma recherche s’intéresse, aux artistes des années 2000 s’appropriant des images existantes, pour la plupart, elles sont d'amateurs, restreintes au cercle familial. Charbert Garance et Mole Aurélien définissent ces artistes comme étant des artistes iconographes. La démarche créative de ces artistes consiste à nourrir un fonds iconographique, assembler et rediffuser les images sans les modifier. Pour appuyer mon propos, je m’appuierais sur Les artistes iconographes de Chabert Garance et Mole Aurélien et sur la thèse de Détré Natacha « Les relecteurs d’images » : une pratique contemporaine de collectes, d’association et de rediffusion d’images photographiques. Il sera donc question ici d’analyser les dispositifs plastiques mis en œuvre afin de revaloriser les images, réactiver les souvenirs. Pour cela, j’ai décidé d’analyser trois objets éditoriaux, Après, on oublie de Bruno Dubreuil (I), Revue en 4 images de Céline Duval (II) et Rachel, Monique... de Sophie Calle (III). Je décrirai dans un premier temps les objets dans leur ensemble. Ensuite, leur processus de création jusqu’au choix du dispositif de rediffusion afin de déterminer en comment les relations entretenues par les artistes avec ces images influencent le dispositif de rediffusion final quant à la réactivation des souvenirs. Altérer la lisibilité À partir d’un travail photographique expérimentant les limites de la lisibilité d’une typographie, je me suis questionnée sur le rapport entre la plasticité et l’altération de la lisibilité. L’enjeu de cette réflexion est de comprendre pourquoi et comment l’altération de la lisibilité crée différentes formes de plasticité, c’est à dire différentes esthétiques formelles. La première partie vise à expliquer la différence entre lecture et regard grâce à divers articles scientifiques. En effet, lire, c’est décoder le langage écrit, tandis que regarder, c’est préter une attention particulière à la forme. Nous chercherons à comprendre les mécanismes physiologiques de ces deux actions. La seconde partie constitue une analyse du travail de différents designers dont Herbert Lubalin, Ruslan Khazanov et David Carson, qui jouent avec les limites de la lisibilité dans leurs créations à l’échelle de la lettre, du mot ou du texte dans son entièreté. Nous chercherons à définir comment divers procédés d’altération de la lisibilité créent différentes formes de plasticités.
Altérer la lisibilité À partir d’un travail photographique expérimentant les limites de la lisibilité d’une typographie, je me suis questionnée sur le rapport entre la plasticité et l’altération de la lisibilité. L’enjeu de cette réflexion est de comprendre pourquoi et comment l’altération de la lisibilité crée différentes formes de plasticité, c’est à dire différentes esthétiques formelles. La première partie vise à expliquer la différence entre lecture et regard grâce à divers articles scientifiques. En effet, lire, c’est décoder le langage écrit, tandis que regarder, c’est préter une attention particulière à la forme. Nous chercherons à comprendre les mécanismes physiologiques de ces deux actions. La seconde partie constitue une analyse du travail de différents designers dont Herbert Lubalin, Ruslan Khazanov et David Carson, qui jouent avec les limites de la lisibilité dans leurs créations à l’échelle de la lettre, du mot ou du texte dans son entièreté. Nous chercherons à définir comment divers procédés d’altération de la lisibilité créent différentes formes de plasticités. Numérique entre continuité et rupture Dans ma pratique personnelle, je travaille principalement sur l’outil du numérique mais j’aime l’appliquer sur différents supports, comme le papier, le tissu par exemple. Je me suis alors demandée quel est le rôle du numérique dans la création graphique. J’ai pu observer dans un premier temps que le numérique marque une rupture dans la perception de la représentation de la nature, par l’apparition de la photographie et du cinéma, mais aussi dans le processus de création graphique. Dans un second temps, je questionne le fait que celui-ci soit une continuité de plusieurs techniques et outils, regroupés dans un seul outil. En effet, on remarque que le numérique reprend les codes d’anciennes techniques et les modifie pour permettre un processus de création plus rapide et les synthétise pour qu’elles puissent être utilisées numériquement ; exemple : nous pouvons dessiner numériquement avec des outils comme de la peinture. Nous pouvons donc dire que le numérique, malgré une rupture dans la perception de l’art, reste une continuité dans le processus de création.
Numérique entre continuité et rupture Dans ma pratique personnelle, je travaille principalement sur l’outil du numérique mais j’aime l’appliquer sur différents supports, comme le papier, le tissu par exemple. Je me suis alors demandée quel est le rôle du numérique dans la création graphique. J’ai pu observer dans un premier temps que le numérique marque une rupture dans la perception de la représentation de la nature, par l’apparition de la photographie et du cinéma, mais aussi dans le processus de création graphique. Dans un second temps, je questionne le fait que celui-ci soit une continuité de plusieurs techniques et outils, regroupés dans un seul outil. En effet, on remarque que le numérique reprend les codes d’anciennes techniques et les modifie pour permettre un processus de création plus rapide et les synthétise pour qu’elles puissent être utilisées numériquement ; exemple : nous pouvons dessiner numériquement avec des outils comme de la peinture. Nous pouvons donc dire que le numérique, malgré une rupture dans la perception de l’art, reste une continuité dans le processus de création. Pratiques digitales - Les formes de publication contemporaine Pour la réalisation de ce mémoire, je me suis intéressé à l’évolution dans notre manière de publier un contenu. Mes recherches m’ont menée à plusieurs formes de publications : du fanzine jusqu’aux réseaux sociaux, comme Instagram. J’ai alors remarqué que le fanzine, publication expérimentale, libre et autonome. Fabriqué pour et par des passionnés, c’est un laboratoire qui montre une grande impulsion artistique. Il existe pour libérer et exprimer les désirs artistiques et graphiques à travers le dessin, la récolte d’image, l’écriture, le collage... Mais... aujourd’hui ? Comment partageons-nous nos derniers sujets passionnants ? J’ai pu analyser, avec l’arrivée des nouvelles technologies et des réseaux sociaux, qu’une incontestable numérisation est apportée dans la conception d’un contenu. Instagram en est un exemple. En effet, l’application engage la publication en ligne pour partager son contenu avec des photos et des images. Ainsi, j’ai mis en avant la création d’une polarité entre la pratique manuelle et numérique. J’ai investi l’espace entre ces deux pôles par la réflexion et la conception du fanzine. Le métissage a donné une mise en parallèle et non une opposition des techniques. Grâce à cet assemblage d’outils et cette manière de faire, j’ai pu imaginé l’apparition d’une nouvelle esthétique.
Pratiques digitales - Les formes de publication contemporaine Pour la réalisation de ce mémoire, je me suis intéressé à l’évolution dans notre manière de publier un contenu. Mes recherches m’ont menée à plusieurs formes de publications : du fanzine jusqu’aux réseaux sociaux, comme Instagram. J’ai alors remarqué que le fanzine, publication expérimentale, libre et autonome. Fabriqué pour et par des passionnés, c’est un laboratoire qui montre une grande impulsion artistique. Il existe pour libérer et exprimer les désirs artistiques et graphiques à travers le dessin, la récolte d’image, l’écriture, le collage... Mais... aujourd’hui ? Comment partageons-nous nos derniers sujets passionnants ? J’ai pu analyser, avec l’arrivée des nouvelles technologies et des réseaux sociaux, qu’une incontestable numérisation est apportée dans la conception d’un contenu. Instagram en est un exemple. En effet, l’application engage la publication en ligne pour partager son contenu avec des photos et des images. Ainsi, j’ai mis en avant la création d’une polarité entre la pratique manuelle et numérique. J’ai investi l’espace entre ces deux pôles par la réflexion et la conception du fanzine. Le métissage a donné une mise en parallèle et non une opposition des techniques. Grâce à cet assemblage d’outils et cette manière de faire, j’ai pu imaginé l’apparition d’une nouvelle esthétique. La sémantique du pli Tout a commencé avec ma collection de nombreux flyers et dépliants graphiques rapportés de magasins locaux. À partir de cette collecte, je me suis interrogée sur la relation entre une identité visuelle et le pli éditorial. Pour cela, je me suis appropriée la pratique du pli par une approche sémantique. La sémantique du pli, est l'intérêt que je porte à cette étude et sur lequel je vais approfondir à travers des lectures sémiologiques et philosophiques. Comment développer du sens à travers la pratique du pli dans le design graphique ? Selon ma démarche, l'acte de plier, c’est reconfigurer, mettre en relation des éléments et en faire apparaître de nouveaux. Nous allons analyser les formes du pli parmi une sélection pertinente de projets en design, qui vont permettre d'appuyer les idées. Ainsi, nous allons démontrer que le pli peut être porteur de sens et qu'il peut apporter une valeur ajoutée à une identité graphique. Afin de développer cette recherche, j’ai pratiqué le pliage à travers mes propres expérimentations, d'après celles-ci, j’ai élaboré des catégories plastiques, qui différencient chaque type de pliages selon leur usage. Les analyses entreprises sont de l'ordre de l'interprétation, elles abordent le besoin fonctionnel ou artistique de chaque projet.
La sémantique du pli Tout a commencé avec ma collection de nombreux flyers et dépliants graphiques rapportés de magasins locaux. À partir de cette collecte, je me suis interrogée sur la relation entre une identité visuelle et le pli éditorial. Pour cela, je me suis appropriée la pratique du pli par une approche sémantique. La sémantique du pli, est l'intérêt que je porte à cette étude et sur lequel je vais approfondir à travers des lectures sémiologiques et philosophiques. Comment développer du sens à travers la pratique du pli dans le design graphique ? Selon ma démarche, l'acte de plier, c’est reconfigurer, mettre en relation des éléments et en faire apparaître de nouveaux. Nous allons analyser les formes du pli parmi une sélection pertinente de projets en design, qui vont permettre d'appuyer les idées. Ainsi, nous allons démontrer que le pli peut être porteur de sens et qu'il peut apporter une valeur ajoutée à une identité graphique. Afin de développer cette recherche, j’ai pratiqué le pliage à travers mes propres expérimentations, d'après celles-ci, j’ai élaboré des catégories plastiques, qui différencient chaque type de pliages selon leur usage. Les analyses entreprises sont de l'ordre de l'interprétation, elles abordent le besoin fonctionnel ou artistique de chaque projet. Graphiste collectionneuse - La pratique de la collection, une démarche pour la création graphique Ce mémoire a pour sujet la pratique de la collection comme démarche pour la création graphique. En tant que graphiste collectionneuse, je me suis questionnée sur l’impact de la collection sur le travail de graphiste. Nous sommes tous les jours amené à créer et nous sommes constamment inondés d’informations au quotidien, ce qui est une immense source d’inspiration. Or, dans toutes ces informations, il faut savoir faire la part des choses et sélectionner les éléments nous correspondant et reflétant au mieux notre univers graphique. Pour cela, la pratique de la collection est un très bon outil. Étant collectionneuse avant d’être graphiste, j’ai pris conscience de la place de mes collections dans mon processus graphique. Ce sont elles qui influencent chacune de mes réalisations, par les formes, les couleurs, les aspects et les textures qui les composent. J’ai donc voulu comprendre comment la pratique de la collection influence la création graphique. Tout au long de ces écrits, je vous présenterais l’analyse de la collection sous différentes formes : comment et quand est apparu le principe de collection et qui sont réellement les collection‐ neurs. Afin de faire le lien entre collection et création graphique, j’analyserais différents cas de personnes dont la pratique de la collection a un impact sur la création. Ainsi en découlera la méthode du Penser/Classer, faisant partie intégrante du processus de création. De ces expli‐ cations, je parlerais de mon approche personnelle de la collection, de ma pratique et de son impact sur mon processus créatif. Par la suite et pour conclure, je mettrais en avant ma posture et mes engagements de graphiste collectionneuse au sein de mon projet professionnel, en abordant la création d’un jeu de 7 familles sur les plantes aromatiques.
Graphiste collectionneuse - La pratique de la collection, une démarche pour la création graphique Ce mémoire a pour sujet la pratique de la collection comme démarche pour la création graphique. En tant que graphiste collectionneuse, je me suis questionnée sur l’impact de la collection sur le travail de graphiste. Nous sommes tous les jours amené à créer et nous sommes constamment inondés d’informations au quotidien, ce qui est une immense source d’inspiration. Or, dans toutes ces informations, il faut savoir faire la part des choses et sélectionner les éléments nous correspondant et reflétant au mieux notre univers graphique. Pour cela, la pratique de la collection est un très bon outil. Étant collectionneuse avant d’être graphiste, j’ai pris conscience de la place de mes collections dans mon processus graphique. Ce sont elles qui influencent chacune de mes réalisations, par les formes, les couleurs, les aspects et les textures qui les composent. J’ai donc voulu comprendre comment la pratique de la collection influence la création graphique. Tout au long de ces écrits, je vous présenterais l’analyse de la collection sous différentes formes : comment et quand est apparu le principe de collection et qui sont réellement les collection‐ neurs. Afin de faire le lien entre collection et création graphique, j’analyserais différents cas de personnes dont la pratique de la collection a un impact sur la création. Ainsi en découlera la méthode du Penser/Classer, faisant partie intégrante du processus de création. De ces expli‐ cations, je parlerais de mon approche personnelle de la collection, de ma pratique et de son impact sur mon processus créatif. Par la suite et pour conclure, je mettrais en avant ma posture et mes engagements de graphiste collectionneuse au sein de mon projet professionnel, en abordant la création d’un jeu de 7 familles sur les plantes aromatiques. Design couleur et matière : matériaux innovants et bien-être Dans cette société industrialisée, production de masse et standardisation ont transformé notre quotidien et nos espaces. En perte de sensibilité face aux matériaux lisses et neutres, nous avons développé du stress et de l’anxiété. Les textures, les couleurs, les ambiances chromatiques, tout ce qui se trouve dans notre environnement affecte notre comportement et notre santé mentale et physique. Alors, comment un matériau, élaboré au moyen du design couleur, pourrait-il traduire la notion de bien-être à travers la sensorialité ? Le travail s’est orienté autour de l’étude des sensations d’apaisement et de confort par l’approche de différentes disciplines, de différents environnements et d’états émotionnels. L’objectif fixé était de créer une matérialisation sensible du bien-être par la relation entre la couleur et la matière issue de la nature. Notre connexion innée avec la nature, fragilisée par l’industrie et la technologie nous a poussé à intégrer des éléments naturels dans notre quotidien. Synonyme de bien-être, le design biophilique nous apporte une réponse sur la manière de façonner nos espaces et nos textiles. Lenteur, complexité, aspérités, vivant, durabilité, le modèle de la nature nous donne à voir et à penser différemment.
Design couleur et matière : matériaux innovants et bien-être Dans cette société industrialisée, production de masse et standardisation ont transformé notre quotidien et nos espaces. En perte de sensibilité face aux matériaux lisses et neutres, nous avons développé du stress et de l’anxiété. Les textures, les couleurs, les ambiances chromatiques, tout ce qui se trouve dans notre environnement affecte notre comportement et notre santé mentale et physique. Alors, comment un matériau, élaboré au moyen du design couleur, pourrait-il traduire la notion de bien-être à travers la sensorialité ? Le travail s’est orienté autour de l’étude des sensations d’apaisement et de confort par l’approche de différentes disciplines, de différents environnements et d’états émotionnels. L’objectif fixé était de créer une matérialisation sensible du bien-être par la relation entre la couleur et la matière issue de la nature. Notre connexion innée avec la nature, fragilisée par l’industrie et la technologie nous a poussé à intégrer des éléments naturels dans notre quotidien. Synonyme de bien-être, le design biophilique nous apporte une réponse sur la manière de façonner nos espaces et nos textiles. Lenteur, complexité, aspérités, vivant, durabilité, le modèle de la nature nous donne à voir et à penser différemment.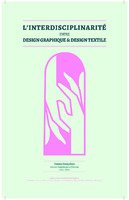 L'interdisciplinarité entre design graphique et design textile Tiraillée entre le design graphique et le design textile depuis de nombreuses années, j’ai découvert par le biais d’un stage le métier de graphiste textile. Ce qui a particulièrement attiré mon attention, c’est son positionnement complexe, car ce nouveau corps de métier se situe à la frontière entre le design graphique, soit l’usage du signe et son interprétation, mais aussi de la mode, de l’univers textile. C’est grâce à cette approche interdisciplinaire qu’est né ce mémoire. De plus en plus de graphistes se tournent vers le monde du textile, de ce fait ma problématique visait à questionner cette nouvelle forme de graphismes, ses enjeux et ses questionnements. Ce mémoire a été réalisé grâce à une enquête par questionnaire proposée à des professionnels touchés par cette relation étroite qu’entretiennent ces deux champs du design (designer textile, designer graphique, designer textile de surface, graphiste textile). Face à l’évolution constante de ce métier et notamment de son intégration dans une multitude d’entreprises, nous avons essayé à travers ce mémoire de mieux comprendre pourquoi ces deux domaines du design sont constamment dissociés alors que de nombreuses compétences les rapprochent. Et si le métier de designer graphique textile résultait d’un besoin par les graphistes de mettre en mouvement leurs créations, de les laisser entrer dans notre quotidien ? L’approche par questionnaire a permis de soulever de nouvelles questions quant à l’adaptation à de nouveaux supports par les designers graphiques, mais encore l’usage du signe à travers cette interdisciplinarité ou la carence en formation textile qui limite l’accessibilité à ce métier. Mais la réelle constatation repose sur l’idée que le design se doit aujourd’hui d’être pluridisciplinaire a n de ne jamais cesser d’évoluer.
L'interdisciplinarité entre design graphique et design textile Tiraillée entre le design graphique et le design textile depuis de nombreuses années, j’ai découvert par le biais d’un stage le métier de graphiste textile. Ce qui a particulièrement attiré mon attention, c’est son positionnement complexe, car ce nouveau corps de métier se situe à la frontière entre le design graphique, soit l’usage du signe et son interprétation, mais aussi de la mode, de l’univers textile. C’est grâce à cette approche interdisciplinaire qu’est né ce mémoire. De plus en plus de graphistes se tournent vers le monde du textile, de ce fait ma problématique visait à questionner cette nouvelle forme de graphismes, ses enjeux et ses questionnements. Ce mémoire a été réalisé grâce à une enquête par questionnaire proposée à des professionnels touchés par cette relation étroite qu’entretiennent ces deux champs du design (designer textile, designer graphique, designer textile de surface, graphiste textile). Face à l’évolution constante de ce métier et notamment de son intégration dans une multitude d’entreprises, nous avons essayé à travers ce mémoire de mieux comprendre pourquoi ces deux domaines du design sont constamment dissociés alors que de nombreuses compétences les rapprochent. Et si le métier de designer graphique textile résultait d’un besoin par les graphistes de mettre en mouvement leurs créations, de les laisser entrer dans notre quotidien ? L’approche par questionnaire a permis de soulever de nouvelles questions quant à l’adaptation à de nouveaux supports par les designers graphiques, mais encore l’usage du signe à travers cette interdisciplinarité ou la carence en formation textile qui limite l’accessibilité à ce métier. Mais la réelle constatation repose sur l’idée que le design se doit aujourd’hui d’être pluridisciplinaire a n de ne jamais cesser d’évoluer. L'atelier pédagogique de pratique graphique Cet écrit s’inscrit dans la lignée d’une réflexion autour d’expériences personnelles dans le milieu de l’atelier pédagogique de pratique graphique. Motivée par l’idée de construire des ateliers cohérents et impactant dans le temps pour le participant, nous centrons notre réflexion sur l’importance de la remise en question de la posture du médiateur. Premièrement nous cherchons à établir dans quel contexte politique et social s’inscrit l’atelier. En quelques mots, l’atelier pédagogique se compose de trois acteurs : l’enfant, le médiateur et la pratique graphique. Notre démarche est d’examiner les liens qui existent entre eux. À partir de cela, nous avons souligné le rapport de domination entre l’adulte et l’enfant qui biaise la transmission dans l’atelier. Le médiateur, si il déconstruit sa posture, peut être celui qui optimise la relation et l’atelier comme espace collectif de transmission horizontale. Comment le graphiste ou l’artiste en tant que médiateur peut apporter des méthodes de création et de transmission pour l’enfant ? Ces recherches permettent de proposer de nouveaux fondements pour le médiateur et l’atelier, visant à encourager une mise en pratique d’atelier pédagogique engagé.
L'atelier pédagogique de pratique graphique Cet écrit s’inscrit dans la lignée d’une réflexion autour d’expériences personnelles dans le milieu de l’atelier pédagogique de pratique graphique. Motivée par l’idée de construire des ateliers cohérents et impactant dans le temps pour le participant, nous centrons notre réflexion sur l’importance de la remise en question de la posture du médiateur. Premièrement nous cherchons à établir dans quel contexte politique et social s’inscrit l’atelier. En quelques mots, l’atelier pédagogique se compose de trois acteurs : l’enfant, le médiateur et la pratique graphique. Notre démarche est d’examiner les liens qui existent entre eux. À partir de cela, nous avons souligné le rapport de domination entre l’adulte et l’enfant qui biaise la transmission dans l’atelier. Le médiateur, si il déconstruit sa posture, peut être celui qui optimise la relation et l’atelier comme espace collectif de transmission horizontale. Comment le graphiste ou l’artiste en tant que médiateur peut apporter des méthodes de création et de transmission pour l’enfant ? Ces recherches permettent de proposer de nouveaux fondements pour le médiateur et l’atelier, visant à encourager une mise en pratique d’atelier pédagogique engagé. Datavisualisation. Dépassez la didactique. L'objet de ce mémoire est les nouvelles pratiques de datavisualisation, qui apparaissent au début des années 2008. La datavisualisation est un outil qui permet de contextualiser et de comparer des données. Initialement conçue comme un outil mnémonique et didactique, les dimensions esthétiques et heuristiques de la datavisualisation séduisent les data designers contemporains. Leur pratique singulière interroge : la datavisualisation doit-elle toujours être didactique ? Dans un premier temps, j'ai analysé l'héritage pratique de la datavisualisation depuis l'Antiquité, et la façon dont elle a été utilisée comme outil didactique au cours de l'histoire. Ensuite, j'ai mis en évidence ses dimensions esthétiques et heuristiques à partir d'un corpus de datavisualisations contemporaines. J'ai montré que les dimensions esthétiques et heuristiques de la datavisualisation tendent aujourd'hui à passer au second plan par rapport à la dimension didactique. Cette analyse tend à montrer que les data designers encouragent une nouvelle pratique de la datavisualisation pour relever les défis du 21e siècle.
Datavisualisation. Dépassez la didactique. L'objet de ce mémoire est les nouvelles pratiques de datavisualisation, qui apparaissent au début des années 2008. La datavisualisation est un outil qui permet de contextualiser et de comparer des données. Initialement conçue comme un outil mnémonique et didactique, les dimensions esthétiques et heuristiques de la datavisualisation séduisent les data designers contemporains. Leur pratique singulière interroge : la datavisualisation doit-elle toujours être didactique ? Dans un premier temps, j'ai analysé l'héritage pratique de la datavisualisation depuis l'Antiquité, et la façon dont elle a été utilisée comme outil didactique au cours de l'histoire. Ensuite, j'ai mis en évidence ses dimensions esthétiques et heuristiques à partir d'un corpus de datavisualisations contemporaines. J'ai montré que les dimensions esthétiques et heuristiques de la datavisualisation tendent aujourd'hui à passer au second plan par rapport à la dimension didactique. Cette analyse tend à montrer que les data designers encouragent une nouvelle pratique de la datavisualisation pour relever les défis du 21e siècle. Les arts graphiques à travers le modèle du vivant Je me plais à marcher dans la nature, particulièrement dans la montagne et découvrir toutes les faces cachées de cette vie surprenante. C'est pour cette raison que mon premier souhait pour ce tout dernier projet d'études, était de mêler ma pratique de graphisme avec la nature. Mais c'était un gros challenge, car cela inclut de nombreux éléments, c'est pour cela que j'ai décidé de me concentrer plus précisément sur les êtres vivants. Je me suis ainsi questionnée sur les ressemblances entre les êtres vivants et le design graphique. Ma méthode a donc consisté à rechercher les nombreux principes de la faune et de la flore parmi certains ouvrages biologiques, voire même scientifiques, afin de montrer les similitudes dans la création graphique. Pour cela, j'ai utilisé mes connaissances dans l'histoire du graphisme et les ai mises en relation avec les différentes caractéristiques des créatures vivantes. J'ai ainsi révélé de nombreux facteurs communs entre ces deux éléments, qui sont finalement assez proches. Les processus de création, de développement, d'organisation, d'adaptation, de renouvellement et de nombreux autres issus du vivant, sont des systèmes communs aux arts graphiques.
Les arts graphiques à travers le modèle du vivant Je me plais à marcher dans la nature, particulièrement dans la montagne et découvrir toutes les faces cachées de cette vie surprenante. C'est pour cette raison que mon premier souhait pour ce tout dernier projet d'études, était de mêler ma pratique de graphisme avec la nature. Mais c'était un gros challenge, car cela inclut de nombreux éléments, c'est pour cela que j'ai décidé de me concentrer plus précisément sur les êtres vivants. Je me suis ainsi questionnée sur les ressemblances entre les êtres vivants et le design graphique. Ma méthode a donc consisté à rechercher les nombreux principes de la faune et de la flore parmi certains ouvrages biologiques, voire même scientifiques, afin de montrer les similitudes dans la création graphique. Pour cela, j'ai utilisé mes connaissances dans l'histoire du graphisme et les ai mises en relation avec les différentes caractéristiques des créatures vivantes. J'ai ainsi révélé de nombreux facteurs communs entre ces deux éléments, qui sont finalement assez proches. Les processus de création, de développement, d'organisation, d'adaptation, de renouvellement et de nombreux autres issus du vivant, sont des systèmes communs aux arts graphiques. Le Design, en mouvement ! : le motion design comme nouvelle forme de pratique artistique. Lorsque j'ai choisi mon sujet de mémoire de fin d'études, je voulais pouvoir faire un lien entre mes deux parcours d'études, qui sont l'animation et le graphisme. Quand on pense à ces deux domaines, on en vient souvent à les réunir dans la technique du motion design. Le motion design est une technique d'animation que j'apprécie car elle me permet d'utiliser l'ensemble des compétences que j'ai acquises tout au long de mon parcours d'études, à la fois en animation et en design. En l'expérimentant, j'ai découvert tout ce que cette technique apportait à mon travail. J'ai aussi réalisé que cette technique était aussi souvent mal comprise. Faisant suite aux avancées techniques des logiciels informatiques, cette technique est devenue depuis peu un outil incontournable pour une communication graphique efficace au service d'un produit ; le motion design tend à se réduire à un outil de marketing, simple technique du design graphique. Dans cette recherche, je voudrais démontrer que le motion-design est une forme d'art à part entière, et comment en s'intéressant à son histoire et en analysant ses caractéristiques, nous voyons apparaître des clés pour comprendre l'apparition de nouvelles formes artistiques. J'ai souhaité mon sujet de mémoire en phase avec les enjeux de notre génération actuelle, participant à contrer l'idée selon laquelle le développement des technologies irait à l'encontre de la création artistique. Selon moi, le motion design est une forme d'art qui a ouvert le monde des arts visuels à de nouvelles perspectives, riches, qui continueront à nous surprendre à l'avenir.
Le Design, en mouvement ! : le motion design comme nouvelle forme de pratique artistique. Lorsque j'ai choisi mon sujet de mémoire de fin d'études, je voulais pouvoir faire un lien entre mes deux parcours d'études, qui sont l'animation et le graphisme. Quand on pense à ces deux domaines, on en vient souvent à les réunir dans la technique du motion design. Le motion design est une technique d'animation que j'apprécie car elle me permet d'utiliser l'ensemble des compétences que j'ai acquises tout au long de mon parcours d'études, à la fois en animation et en design. En l'expérimentant, j'ai découvert tout ce que cette technique apportait à mon travail. J'ai aussi réalisé que cette technique était aussi souvent mal comprise. Faisant suite aux avancées techniques des logiciels informatiques, cette technique est devenue depuis peu un outil incontournable pour une communication graphique efficace au service d'un produit ; le motion design tend à se réduire à un outil de marketing, simple technique du design graphique. Dans cette recherche, je voudrais démontrer que le motion-design est une forme d'art à part entière, et comment en s'intéressant à son histoire et en analysant ses caractéristiques, nous voyons apparaître des clés pour comprendre l'apparition de nouvelles formes artistiques. J'ai souhaité mon sujet de mémoire en phase avec les enjeux de notre génération actuelle, participant à contrer l'idée selon laquelle le développement des technologies irait à l'encontre de la création artistique. Selon moi, le motion design est une forme d'art qui a ouvert le monde des arts visuels à de nouvelles perspectives, riches, qui continueront à nous surprendre à l'avenir.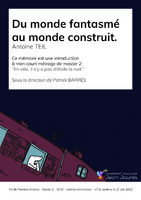 Du monde fantasmé au monde construit. Il s'agit d'identifier des méthodes de création pour la réalisation d'un court métrage. Dans une première partie, nous allons déterminer la façon dont je présente l’histoire de ce court métrage, et répondre à la question que je me suis posée , ‘‘comment raconter cette histoire ?’’ C’est la mise en place de déterminants : cadres et personnages (interactions, déclinaisons, modulations), que nous analyserons dans une deuxième partie. Enfin, je vous livrerai l’état d’esprit émotionnel, la vraie raison de ce sujet qui aboutit à ce court métrage. Il s’agit du film fantasmé que l’on peut rapprocher de la notion de ‘‘non film’’. L’objectif de mon court métrage et de ce mémoire, met en exergue l’idée de ‘‘film fantasmé’’. C’est pour moi, créer sans être centré sur le ‘‘faire bien’’, pour rejoindre l’idée de ‘‘mal faire’’ comme un rêve incomplet et déconstruit mais qui compose un tout pour forger une identité.
Du monde fantasmé au monde construit. Il s'agit d'identifier des méthodes de création pour la réalisation d'un court métrage. Dans une première partie, nous allons déterminer la façon dont je présente l’histoire de ce court métrage, et répondre à la question que je me suis posée , ‘‘comment raconter cette histoire ?’’ C’est la mise en place de déterminants : cadres et personnages (interactions, déclinaisons, modulations), que nous analyserons dans une deuxième partie. Enfin, je vous livrerai l’état d’esprit émotionnel, la vraie raison de ce sujet qui aboutit à ce court métrage. Il s’agit du film fantasmé que l’on peut rapprocher de la notion de ‘‘non film’’. L’objectif de mon court métrage et de ce mémoire, met en exergue l’idée de ‘‘film fantasmé’’. C’est pour moi, créer sans être centré sur le ‘‘faire bien’’, pour rejoindre l’idée de ‘‘mal faire’’ comme un rêve incomplet et déconstruit mais qui compose un tout pour forger une identité.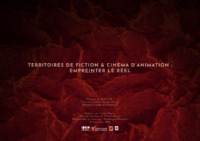 Territoires de fiction & cinéma d'animation : empreinter le réel Mon travail porte sur le lieu/le site et la façon dont nous l'habitons. Pour être plus précis, je fais référence à la grotte préhistorique et aux traces qui y sont laissées. J'avais personnellement besoin de renouer avec des points d'origine, en l'occurrence la naissance de la représentation et plus généralement des arts, et la naissance d'une conscience embryonnaire chez l'humain. C'est quelque chose qui fait écho, quand on s'y intéresse, aux recherches et hypothèses archéologiques actuelles : la naissance du cinéma ne remonte peut-être pas aux frères Lumières, mais à la préhistoire, après reconstitution d'objets semblables à des jouets optiques et observation de différentes décompositions de temps/mouvement dans les peintures rupestres, faisant de ces fresques de véritables récits graphiques. J'ai trouvé intéressant de penser que cet homme (préhistorique) en était déjà là dans son développement et sa pratique, imprimant sa part d'humanité sur le mur. J'ai travaillé et étudié la matériologie de la paroi, ses reliefs, ses aspérités, comment elle formait une toile. De plus, j'ai opté pour une mise en scène par ombres, c'est-à-dire qu'on ne voit aucun personnage, tout se passe au mur, par jeu d'ombres. Ce qui est intéressant, c'est toute cette méthodologie de travail que j'ai dû inventer, me réapproprier. Inventer un système de projection pour animer la matière originelle (l'argile) sur une plaque de verre, récupérer (ou capter) les ombres, s'abandonner à ce qu'elle nous offre et nous montre. Ce fut une expérience de créateur mais aussi de spectateur, de conteur.
Territoires de fiction & cinéma d'animation : empreinter le réel Mon travail porte sur le lieu/le site et la façon dont nous l'habitons. Pour être plus précis, je fais référence à la grotte préhistorique et aux traces qui y sont laissées. J'avais personnellement besoin de renouer avec des points d'origine, en l'occurrence la naissance de la représentation et plus généralement des arts, et la naissance d'une conscience embryonnaire chez l'humain. C'est quelque chose qui fait écho, quand on s'y intéresse, aux recherches et hypothèses archéologiques actuelles : la naissance du cinéma ne remonte peut-être pas aux frères Lumières, mais à la préhistoire, après reconstitution d'objets semblables à des jouets optiques et observation de différentes décompositions de temps/mouvement dans les peintures rupestres, faisant de ces fresques de véritables récits graphiques. J'ai trouvé intéressant de penser que cet homme (préhistorique) en était déjà là dans son développement et sa pratique, imprimant sa part d'humanité sur le mur. J'ai travaillé et étudié la matériologie de la paroi, ses reliefs, ses aspérités, comment elle formait une toile. De plus, j'ai opté pour une mise en scène par ombres, c'est-à-dire qu'on ne voit aucun personnage, tout se passe au mur, par jeu d'ombres. Ce qui est intéressant, c'est toute cette méthodologie de travail que j'ai dû inventer, me réapproprier. Inventer un système de projection pour animer la matière originelle (l'argile) sur une plaque de verre, récupérer (ou capter) les ombres, s'abandonner à ce qu'elle nous offre et nous montre. Ce fut une expérience de créateur mais aussi de spectateur, de conteur. Judas One Anecdote Show
Ciné-graphisme et character design dans un film à sketch. Le cinéma d’animation est souvent perçu comme différent du cinéma en « prises réelles » parce que les acteurs sont remplacés par des personnages dessinés ou des marionnettes. Mais en fait les grandes étapes sont les mêmes, et cela quelle que soit la technique utilisée : le cinéma d’animation c’est du cinéma ! La question du dessin est au cœur du développement et du renouvellement des conduites créatrices et des pratiques de recherches du cinéma d’animation. Le dessin conjugue ce qui tient au domaine de l’esprit, au projet et à l’activité de conception et ce qui se rapporte au mode d’expression, la proposition. L’animation est constituée de 2 pôles : le dessin et la technologie. Le second donne vie au premier. L’objectif de ce mémoire est de retranscrire les questionnements, pistes de travail et techniques utilisées pour créer le pilote d’une série d’animation, basée sur le dessin au trait, à destination de producteurs dans le domaine de l’animation. La première partie théorise les questionnements et choix techniques faits pour ce projet, la seconde partie présente le projet par ordre chronologique de réalisation jusqu’au pilote final.
Judas One Anecdote Show
Ciné-graphisme et character design dans un film à sketch. Le cinéma d’animation est souvent perçu comme différent du cinéma en « prises réelles » parce que les acteurs sont remplacés par des personnages dessinés ou des marionnettes. Mais en fait les grandes étapes sont les mêmes, et cela quelle que soit la technique utilisée : le cinéma d’animation c’est du cinéma ! La question du dessin est au cœur du développement et du renouvellement des conduites créatrices et des pratiques de recherches du cinéma d’animation. Le dessin conjugue ce qui tient au domaine de l’esprit, au projet et à l’activité de conception et ce qui se rapporte au mode d’expression, la proposition. L’animation est constituée de 2 pôles : le dessin et la technologie. Le second donne vie au premier. L’objectif de ce mémoire est de retranscrire les questionnements, pistes de travail et techniques utilisées pour créer le pilote d’une série d’animation, basée sur le dessin au trait, à destination de producteurs dans le domaine de l’animation. La première partie théorise les questionnements et choix techniques faits pour ce projet, la seconde partie présente le projet par ordre chronologique de réalisation jusqu’au pilote final. Kino-Scénographie, une plasmaticité débridée Durant mes deux années d'études à l'Institut Supérieur Couleur Image Design, parcours cinéma d'animation, le projet de création sur lequel je travaille s'intitule Le corbeau qui chercha sa plume. Essayant de sortir le cinéma d'animation de son cadre classique, je me penche sur une problématique qui est en deux parties. La première concerne la manière dont je vais pouvoir mettre en place une Kino-scénographie. La seconde partie se concentre sur une pratique de plasmaticité débridée. L'intitulé "Kino-scénographie" désigne la mise en oeuvre d'une installation polyptyque sur laquelle est projeté une animation. Et la «plasmaticité» est un concept inventé par Eisenstein, qui se définit par la mobilité des formes plastiques. Formes que je vais alors adapter au dispositif. L'objectif de ce travail est de proposer au public une expérience nouvelle qui combine les notions du film et de l’œuvre d'art. Ma recherche commence par une poïétique du chaos. À travers une démarche qui met en exergue le geste spontané et instinctif, j'instaure un nouveau processus qui rompt avec les codes traditionnels du cinéma. C'est un sentiment de nécessité qui m'a amené vers la recherche d'une autre méthode d'expression, impliquant alors le geste, la texture et le hasard. Je travaille la peinture animée avec de la peinture acrylique et j’étudie tous les états du matériau. Par la suite, je tente de rationaliser ces actes plastiques en classant les différents motifs. Afin d'appliquer mes images animées à mon dispositif d'invention, j'exploite les notions du vidéo-mapping. Au fil de ces expériences, je mets alors en place une scénographie animée et expressive qui offre une expérience immersive.
Kino-Scénographie, une plasmaticité débridée Durant mes deux années d'études à l'Institut Supérieur Couleur Image Design, parcours cinéma d'animation, le projet de création sur lequel je travaille s'intitule Le corbeau qui chercha sa plume. Essayant de sortir le cinéma d'animation de son cadre classique, je me penche sur une problématique qui est en deux parties. La première concerne la manière dont je vais pouvoir mettre en place une Kino-scénographie. La seconde partie se concentre sur une pratique de plasmaticité débridée. L'intitulé "Kino-scénographie" désigne la mise en oeuvre d'une installation polyptyque sur laquelle est projeté une animation. Et la «plasmaticité» est un concept inventé par Eisenstein, qui se définit par la mobilité des formes plastiques. Formes que je vais alors adapter au dispositif. L'objectif de ce travail est de proposer au public une expérience nouvelle qui combine les notions du film et de l’œuvre d'art. Ma recherche commence par une poïétique du chaos. À travers une démarche qui met en exergue le geste spontané et instinctif, j'instaure un nouveau processus qui rompt avec les codes traditionnels du cinéma. C'est un sentiment de nécessité qui m'a amené vers la recherche d'une autre méthode d'expression, impliquant alors le geste, la texture et le hasard. Je travaille la peinture animée avec de la peinture acrylique et j’étudie tous les états du matériau. Par la suite, je tente de rationaliser ces actes plastiques en classant les différents motifs. Afin d'appliquer mes images animées à mon dispositif d'invention, j'exploite les notions du vidéo-mapping. Au fil de ces expériences, je mets alors en place une scénographie animée et expressive qui offre une expérience immersive.