-
 Dessin d’animation, textures et traits de mémoire
Dessin d’animation, textures et traits de mémoire Exploration du potentiel graphique et narratif de la texture afin d'appuyer des émotions, sensations et de caractériser des lieux et des personnages dans un film d'animation.
-
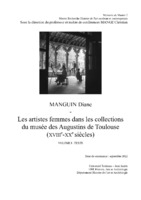 Les artistes femmes dans les collections du musée des Augustins de Toulouse (XVIIIe-XXe siècles)
Les artistes femmes dans les collections du musée des Augustins de Toulouse (XVIIIe-XXe siècles) Au sein des collections du musée, seules 4,7 % des œuvres ont été réalisées par des femmes. Quelles sont les raisons d'un tel écart ? Existe-t-il des moyens de rééquilibrer ces lacunes ? Quelles sont les initiatives portées par les musées ? Loin d'être un cas isolé, plusieurs institutions se sont engagées pour donner davantage de visibilité aux créatrices. Leur faible représentation s'explique par un contexte socio-historique où la formation et la reconnaissance institutionnelle n'allaient pas de soi jusqu'au XXe siècle. Les études de genre et le féminisme ont contribué à remettre en question l'histoire de l'art pour penser différemment les collections des musées. Ainsi, le musée des Augustins conserve une centaine d’œuvres d'artistes femmes. Grâce à la rédaction de biographies et de commentaires d’œuvres, il s'agit de valoriser leurs productions, majoritairement conservées dans les réserves. Des statistiques sur leur représentation dans les collections permanentes et temporaires ont été réalisées. Elles sont mises en regard avec un entretien mené auprès du conservateur du musée. Ces différents outils permettent d'établir une méthodologie pour mener un état des lieux et une analyse de la situation à l'instant T. Cette étude est confrontée aux initiatives portées par d'autres musées, notamment dans le domaine de l'acquisition, de l'exposition ou encore de la médiation. Ce travail se pense aussi comme un outil de réflexion pour demain. Lutter contre l'invisibilité ne peut se faire sans engager une réflexion sur l'ensemble de la politique muséale. Si les événements ponctuels sont pertinents, ce sont les initiatives répétées et qui s'inscrivent sur le long terme qui permettront de ne plus avoir à distinguer les artistes femmes, pour s'inscrire un jour dans une égalité qui n'a pas de sexe.
-
La figure du mal dans le cinéma de Griffith, Eisenstein et Lang
Etude sur le traitement de la figure du mal dans le cinéma de trois pionniers du cinéma.
-
Contemporanéités de la pensée de Walter Benjamin dans "L'Œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique"
Il s'agit ici d'entrevoir les diverses réceptions dans le champ du politique, du théorique et de la pratique artistique contemporaine du texte majeur de Walter Benjamin "L'Œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique" dans sa version de 1939.
-
 Nostalgie, apathie et motivation intrinsèque dans le vieillissement : un regard croisé
Nostalgie, apathie et motivation intrinsèque dans le vieillissement : un regard croisé Cette thèse explore les relations croisées entre la nostalgie, l’apathie et la motivation intrinsèque chez les personnes âgées. Pour réaliser ce travail, 4 études ont été conduites. L’étude 1 a pour objectif de valider une échelle d’évaluation de la nostalgie dédiée à la personne âgée. L’analyse de la validité convergente et divergente nous a permis de disposer d’un outil d’évaluation adapté. Des analyses corrélationnelles ont montré que la nostalgie serait une stratégie adaptative, à condition de percevoir le passé positivement. L’étude 2 explore la valeur causale des émotions négatives et de la conception de soi sur l’apparition du comportement apathique. Des analyses descriptives et de régression nous ont permis d’identifier le rôle causal de la conception de soi et évolutif des émotions négatives sur l’apathie. L’étude 3 a pour objectif d’étudier les relations entre la nostalgie, l’apathie, le bien-être et la motivation intrinsèque chez la personne âgée. Les résultats ont corroboré le caractère central de la perception positive du passé dans l’augmentation du bien-être. Contrairement à la nostalgie, l’apathie serait associée négativement à la motivation intrinsèque et ainsi diminuerait son intensité. Il n’a pas été observé de lien entre la nostalgie et l’apathie. L’étude 4 vise à déterminer les directions des relations entre l’apathie, les déficits cognitifs et l’altération de la conscience. Les résultats ont montré que la personne âgée avec des déficits cognitifs présenteraient une altération de la conscience vis-à-vis de son comportement apathique. Des analyses de médiation ont permis d’attribuer un rôle médiateur à l’apathie. A l’issue de ce travail de recherche, la nostalgie pourrait être envisagée comme une stratégie de régulation émotionnelle chez la personne âgée. L’apathie participerait à la diminution des comportements motivés intrinsèquement. Nous n’avons pas observé de lien entre la nostalgie et l’apathie chez la personne âgée. De futures recherches devraient explorer l’intérêt d’une thérapie centrée sur la nostalgie et l’analyse d’interventions pouvant permettre la réduction du symptôme apathique chez la personne âgée.
-
 Est-ce vraiment « juste une blague » ? Effet du groupe ciblé, des préjugés et de l’adhésion aux stéréotypes sur la perception de l’humour de dénigrement : une approche expérimentale
Est-ce vraiment « juste une blague » ? Effet du groupe ciblé, des préjugés et de l’adhésion aux stéréotypes sur la perception de l’humour de dénigrement : une approche expérimentale L’humour de dénigrement (e.g., humours raciste, sexiste) est une forme de communication destinée à faire rire ou sourire qui rabaisse, dénigre ou diffame une cible donnée (Ford & Ferguson, 2004) en se basant majoritairement sur les stéréotypes pour faire rire (Mallett et al., 2016). Naturellement ambivalente, cette forme d’humour communique un message de dénigrement explicite associé à un message implicite qui suggère que ce message doit être pris d’une manière légère (Ford et al., 2017). Si elle peut permettre de remettre en cause le statu quo ou de souligner l’absurdité des stéréotypes et préjugés (Miller et al., 2019), ses effets sont majoritairement négatifs. Elle véhicule et renforce les stéréotypes et favorise l’expression des préjugés (Ford & Ferguson, 2004), contribue à la tolérance envers la discrimination (Ford et al., 2014) et augmente les comportements discriminatoires (Thomae & Viki, 2013). Il semblerait que ces effets soient avérés uniquement sur des groupes envers lesquels l'acceptabilité sociale de l'expression des préjugés est ambivalente (i.e., appartenant à la fenêtre normative des préjugés ; Mendiburo-Seguel & Ford, 2019) et qu’ils diffèrent en fonction de la perception de cet humour (Saucier et al., 2019). Pourtant, les potentielles différences de perception de l’humour dénigrant des groupes en fonction de leur appartenance à la fenêtre normative n’ont jamais été investiguées. À travers sept expériences (Ntotal = 1437), cette thèse vise à étudier les effets de l’appartenance du groupe ciblé à la fenêtre normative des préjugés, des préjugés et de l'adhésion aux stéréotypes sur la perception de l'humour de dénigrement. Sa contribution est double : elle se situe à la fois sur le plan de l’amélioration méthodologique de l’étude de l’humour de dénigrement (nouveautés méthodologiques et statistiques afin de renforcer les validités interne et externe) et à l’exploration d’hypothèses nouvelles (effet de la cible de l’humour).
Dans la première partie empirique, nous avons comparé la perception de mêmes matériels humoristiques dénigrants sur le stéréotype commun de « malhonnêteté » partagés par deux groupes, l’un appartenant à la fenêtre normative des préjugés (personnes d’origine maghrébine) et le second n’y appartenant pas (hommes politiques). La seconde partie empirique reprend le même principe sur l’humour sexiste. Le recours au stéréotype de « stupidité » partagé à la fois par les hommes (en dehors de la fenêtre normative des préjugés) et les femmes (dans la fenêtre) permettait ainsi de reproduire le même paradigme pour deux autres groupes et, notamment, de tester l’effet de l’appartenance groupale. Une autre originalité de ce travail est le recours à des mesures indirectes (SC-IAT-P, Bardin et al., 2014, partie 1) et directes (i.e., questionnaires, parties 1 et 2) pour tester l’effet des préjugés sur la perception de l’humour de dénigrement.
Ce travail suggère que, plus que le matériel humoristique utilisé ou l’appartenance groupale, le groupe dénigré est un facteur prépondérant de la perception de l’humour de dénigrement. En amont, plus les individus ont des préjugés négatifs et adhèrent aux stéréotypes à l’égard de la cible, plus ils ont tendance à apprécier, à juger socialement acceptable et à évaluer comme moins offensante cette forme d’humour. Ce travail fournit ainsi une illustration supplémentaire que l’humour sexiste ou raciste n’est jamais « juste une blague ». Les résultats seront discutés en termes de perspectives visant, d'une part à établir dans quelle mesure le contexte et la source modulent l’effet et, d’autre part, dans des perspectives plus concrètes visant à avoir recours à l’humour de dénigrement afin de réduire les préjugés et stéréotypes. Ces éléments sont d’autant plus importants que cette forme d’humour est perçue aujourd’hui comme une manifestation des préjugés largement tolérée et répandue (Haut conseil de l’égalité entre les hommes et les femmes, 2019).
-
 Socialisation sportive de haut niveau et construction du genre féminin : le cas de la gymnastique rythmique
Socialisation sportive de haut niveau et construction du genre féminin : le cas de la gymnastique rythmique Au croisement de la sociologie des dispositions, de la carrière, du genre et l’interactionnisme de Goffman ce travail de thèse questionne les effets de la socialisation sportive de haut niveau sur la construction sociale du genre féminin en gymnastique rythmique. Il s’appuie sur une enquête de type ethnographique, qualitative, mobilisant des observations de gymnastes au sein de pôles sportifs en France ainsi que des entretiens semi-directifs auprès de gymnastes de haut niveau faisant ou ayant fait carrière.
Pratique sportive féminine par excellence, la socialisation gymnique favorise l’incorporation d’un habitus « GR », propice au développement de dispositions de genre « hybrides ». La précocité et sa dimension hypersexuée de la carrière œuvrent alors à une transformation de soi et de la féminité de ce jeune public. Ce faisant, les jeunes gymnastes qui choisissent de s’y engager entament durant leur jeunesse un profond processus de transformation et « d’optimisation » de soi (Dalgalarrondo, 2018, 2019) et de leur corps, outil de production de la performance. Par ailleurs, elle implique un processus d’esthétisation féminine des corps dans l’hyper ritualisation du corps (Goffman, 1977) sur la scène sportive, mais également dans la production d’un corps désirable (De Saint Pol, 2010). Le processus de gestion du poids et la transformation des pratiques alimentaires occupent ainsi un rôle central dans ce travail de soi qu’implique la fabrication d’un « corps de GR ». Les gymnastes peuvent aller jusqu’à entrer dans une carrière anorexique de performance (Darmon 2003) par vocation sportive.
Ce processus lent, irrégulier, invisible de construction d’une « hexis corporelle » GR se déroule au sein d’une institution sportive qui opère comme une instance de transformation des dispositions par son caractère enveloppant (Darmon, 2013) voire totalisant (Goffman, 1961). La fabrication d’un corps de GR optimisé est enfin une œuvre collective (Demazière et coll, 2015) au contact d’autruis significatifs (Berger, Kellner, Luckmann, 1988) charismatique que sont principalement les entraîneures, gymnastes et juges.
En fin de compte, ce travail de soi associe une « féminité accentuée » (Connell, 1987) visible renvoyant à un corps ultra féminisé reproduisant les stéréotypes d’une féminité légitime et d’autre part, une féminité « performative » invisible où la maîtrise de la grâce et du beau geste font écho à des exigences technico-esthétiques apprises par la sueur, la répétition et l’effort, la combativité, attributs socialement associés au masculin (Messner 1992 ; Guerandel 2016).
À ce propos, sortie de carrière, certaines dispositions antérieures vont résister à cette socialisation corporelle très forte en fonction des trajectoires sociales des gymnastes. De la même manière, les dispositions acquises au cours de la carrière vont conserver une certaine « force d’entraînement » et agir sur les différents domaines de l’existence, y compris professionnelle.
-
Les fanatiques, les aristocrates et les contre-révolutionnaires. Les rapports de genre dans la répression politique des femmes du Midi toulousain (17 septembre 1793- 12 vendémiaire an IV)
Ce mémoire s'intéresse à la question de la répression politique des femmes du Midi toulousain à l'époque révolutionnaire vu sous le prisme du genre.
-
Les actrices et les acteurs de théâtre dans la société toulousaine à travers les procédures criminelles des capitouls, 1731-1789
A travers les procédures criminelles des capitouls, il est question de saisir la vie des acteurs et des actrices de théâtre au XVIIIe siècle. Figures éphémères à la ville, qui sont-ils.elles? Comment s'intègrent-ils.elles? Et quelles les violences qu'ils.elles subissent ou exercent selon leurs genres?
-
 Modèles chromatiques et maquillage biologique : de l’immersion dans un laboratoire à façon à la création de portraits en design-couleur
Modèles chromatiques et maquillage biologique : de l’immersion dans un laboratoire à façon à la création de portraits en design-couleur Dans un contexte sociétal et économique favorable aux relations entre recherche publique et privée, le dispositif CIFRE (Conventions industrielles de formation par la recherche) a permis à ce travail de voir le jour grâce à l’articulation d’une recherche académique poursuivie à l’Université de Toulouse et d’une approche pratique mûrie au sein d’une entreprise montpelliéraine spécialisée dans la cosmétique de soin biologique.
L’entreprise cherchait à concevoir une gamme de maquillage différenciante, végane et certifiée biologique afin de compléter son offre. L’exercice de la recherche universitaire a permis de proposer une réponse pratique à la création de gamme et d’explorer par la réflexion académique la question de la naturalité dans le champ de la cosmétique. Ce travail s’appuie sur l’hypothèse suivante : les couleurs naturelles et les couleurs non naturelles ne représentent pas les mêmes espaces de modélisation chromatique. Par conséquent, intégrer un profil de coloriste designer au sein d’un laboratoire de Recherche & Développement permettrait de (re)penser/classer la couleur, d’apporter un regard nouveau sur les pratiques de ce lieu et de faire se rencontrer le chimiste et le designer.
Les idées et les approches ont divergé et se sont parfois même opposées. Cette situation complexe s’est transformée en opportunité pour créer de nouveaux procédés, méthodes et langages entre le domaine disciplinaire du design et de la chimie, entre le design et d’autres métiers. Cette opportunité a contribué à la facilitation de la conception de prototype de maquillage. Elle a par la suite été appliquée à une réflexion autour des concepts biologique/naturel/naturelle par le biais de la sociologie des usages et des représentations de la femme cosmétique et de l’histoire de la beauté.
Suite à l’observation de la polysémie du terme naturel, il convenait ensuite de s’intéresser au sens défendu par une marque comme positionnement et celui de la caractérisation d’un produit qui répond à un référentiel biologique. Devant la confusion et le nombre de produits sur le marché répondant à cette image, ou du moins à l’image que l’on se fait du produit biologique ou naturel, il était nécessaire de questionner les clichés et les stéréotypes qui l’entourent.
L’enjeu était alors de promouvoir une pensée industrielle différente, en dépassant les clichés et en misant sur l’innovation par le design chromatique et le faire français biologique par une approche poétique. Ce travail s’intéresse au fonctionnement de ce stéréotype, de l’image, dans le champ de la cosmétique et plus spécifiquement appliqué aux portraits de femmes. Cette thèse suggère de repenser les codes et d’envisager, finalement, un nouveau mode de consommation plus douce et responsable.
-
Les portraits privés en ronde-bosse du sud des Gaules.
Ce mémoire offre une analyse stylistique d'un corpus de portraits privés, produits dans le sud des Gaules et plus spécifiquement en Narbonnaise. L'objectif de ce travail est de proposer une datation de ces œuvres sculptés et de les replacer dans une chronologie en se basant notamment sur le phénomène de Zeitgesicht ou "visage d'époque", phénomène qui amène la population locale à se faire représenter à la manière des portraits officiels.
-
Une histoire des commerces nantais
Collecter, valoriser et diffuser le patrimoine historique et archivistique, XIXe-XXIe siècles
Etude réalisée dans le cadre d'un stage de 5 mois à la Direction du patrimoine et de l'archéologie de la ville de Nantes. Projet d'exposition photographiques sur l'histoire des commerces Nantais du 19e siècle au XXIe siècle. Accompagné d'une réflexion autour de la collecte des archives privées et des archives orales.
-
L'art immersif depuis 1920. Pour une remise en question de l'art et de la société.
Bernard Guelton définit l’art immersif comme un puissant sentiment d’absorption du sujet physique ou mental.
L’art immersif apparaît dans les années 1920 au moment où les artistes tentent d’extraire les peintures de leurs toiles et les sculptures de leurs socles afin de les faire entrer dans le monde réel.
Dans les années 1960, des groupes d’artistes souhaitent réinventer l’art qualifié de traditionnel. Ces artistes veulent créer un art que la « classe dominante » et « intellectuelle » ne pourra plus s’approprier. Pour cela, ils s’appuient sur l’expérience du public comme moteur de leur création pour rapprocher l’art de la vie et abolir les règles définies par le monde artistique. L’œuvre immersive devient ainsi le lieu d’expériences ludiques et interactives, requestionnant la définition de l’art avec des manifestes comme « Défense de ne pas participer. Défense de ne pas toucher. Défense de ne pas casser » (GRAV, 1963).
Les contestations de mai 1968 suivies des années 1970 créent une rupture au sein du mouvement immersif selon deux axes : un axe expérimental et un axe politique. Selon le premier, l’œuvre est façonnée à partir des stimuli des spectateurs pour leur faire vivre de nouvelles expériences psychologiques, visuelles, méditatives ou encore ludiques. En parallèle, certains artistes vont confronter les spectateurs à la réalité du monde, en les plongeant au cœur des problèmes sociaux et sociétaux. L’art immersif devient un outil politique au service de la lutte contre le racisme, le sexisme, les inégalités ou encore les violences. Plus récemment, l’art immersif s’enrichit de nouvelles luttes contemporaines liées à la protection de l’environnement. Ainsi, les artistes utilisent l’immersion pour plonger les visiteurs dans les problématiques sociétales pour les inciter à agir dans les œuvres et plus largement dans leur vie.
-
L'apport de l'acquisition aérienne de données : entre archéologie préventive urbaine et prospection Lidar en moyenne montagne.
Ce mémoire rend compte de deux stages effectués respectivement sur le chantier archéologique préventif de la Cité administrative de Toulouse sous la direction du responsable d'opération Xavier Lhermite et en traitement de données Lidar dans le cadre de l'étude de la forêt domaniale de Bareilles (65), sous l'encadrement de Carine Calastrenc et pour les laboratoires TRACES et FRAMESPA. En plus de décrire exhaustivement le travail effectué lors de ces stages, il s'agit également dans ce mémoire de formuler, toujours sous le prisme de ces deux expériences, une réflexion sur l'apport important des méthodes d'acquisition aériennes appliquées à l'archéologie.
-
L’influence de la miniature persane et moghole dans la peinture et l’illustration en Occident de la fin XIXe siècle au début du XXe siècle
Il s'agit de voir les apports de la miniature persane et indienne dans la peinture et l'illustration de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle, notamment chez les peintres symbolistes comme Moreau et les peintres nabis. Ces influences sont aussi remarquables dans l'illustration, particulièrement dans les illustrations d’Edmond Dulac.
-
Étude monumentale de l'église Notre Dame de la Dalbade
L'étude monumentale de l'église Notre-Dame de la Dalbade est une étude réalisé sur deux ans. Grâce aux archives, aux sources iconographiques, planimétriques, et textuelles, ainsi qu'à l'étude du bâti, une datation la plus fine possible a été proposée. Le but de ce mémoire a été de comparer l'église de la Dalbade avec d'autres édifices religieux, afin d'apporter un phasage et une datation des différentes parties de l'édifice. L'approche typologique et stylistique ainsi que le croisement des données déjà existantes et des données supplémentaires ajoutées au cours des deux années de recherche, ont permis d'apporter des éléments prouvant que l'église de la Dalbade est un édifice complexe et qui a subi plusieurs phases de modifications au fil de son histoire. Certaines de ces phases ont été redéfinies. Ainsi, cette étude met en avant l'église de la Dalbade d'un autre point de vue, qui est centré sur le bâti.
-
 Du paternalisme médical au partenariat en santé. Caractérisation et modélisation du processus d’émancipation par le croisement des savoirs dans la recherche-intervention
Du paternalisme médical au partenariat en santé. Caractérisation et modélisation du processus d’émancipation par le croisement des savoirs dans la recherche-intervention La démarche de Recherche-Intervention (R-I) en sciences de l’éducation et de la formation se présente comme un cadre privilégié pour accompagner le changement. Elle poursuit une triple visée - heuristique, praxéologique et émancipatrice - et affirme le principe d’une démarche participative. Par l’interdépendance de la recherche et de l’intervention, reliant les sphères académique et socio-professionnelle, elle positionne les acteurs sociaux comme coproducteurs de la recherche en légitimant leur compréhension du changement étudié, leur engagement à la production de savoirs utiles à l’action.
L’objectif de cette thèse est d’interroger l’effectivité des dynamiques individuelles et collectives d’émancipation dans le cadre d’une R-I commanditée par l’Agence Régionale de Santé Occitanie pour accompagner le changement que porte le partenariat en santé. Cette commande institutionnalise le projet de R-I et instaure le principe de la participation des acteurs — professionnels de santé, personnes en soin et usagers, chercheurs — au sein du tiers-espace socio-scientifique. Le partenariat en santé, changement paradigmatique et systémique, se présente comme le moyen et la finalité de la démarche.
Les orientations épistémologiques et théoriques, s’inscrivant dans la pensée du pédagogue brésilien Paulo Freire, conduisent à mettre en œuvre le croisement des savoirs au sein du tiers-espace socio-scientifique « partenariat en santé » comme stratégie d’alphabétisation sociale pour accompagner ce changement.
Une recherche qualitative phénoménologique à visée compréhensive est menée afin de comprendre les phénomènes, en saisir l’essence à partir du sens donné par les acteurs qui en font l’expérience. Un recueil longitudinal des éléments empiriques est opéré à partir de 56 entretiens d’explicitation ; le traitement et l’analyse de données par la méthode IPA (Interpretative Phenomenological Analysis) sont retenus.
Les résultats de cette thèse permettent d’objectiver et caractériser les processus collectifs (les transformations) et individuels (les déplacements) d’émancipation des acteurs dans le contexte de la R-I « partenariat en santé ». La mise à distance et la discussion de ces matériaux proposent de compléter la théorisation de la R-I, par une contribution à une modélisation de ses processus d’émancipation par le croisement des savoirs.
-
 Existences cloîtrées et dynamiques de la réclusion dans les œuvres de William Faulkner, Flannery O'Connor et Eudora Welty
Existences cloîtrées et dynamiques de la réclusion dans les œuvres de William Faulkner, Flannery O'Connor et Eudora Welty Le mythe, selon Jean-Jacques Lecercle, est une somme de contradictions qui assure sa pérennité. La cohabitation des notions contraires d’ouverture et de fermeture qui caractérise le personnage reclus a permis, au même titre que sa nature archétypale, de l’inscrire durablement dans la littérature européenne.
Cette thèse s’attache à démontrer qu’un transfert transatlantique s’est opéré au fil des siècles, transposant le reclus européen à la culture américaine et au Sud des États-Unis. L’ermite médiéval ou romantique s’y mue progressivement en personnage marginal et dissonant : la vieille fille, l’intellectuel incompris ou encore la jeune femme entravée peuplent les nouvelles et romans de William Faulkner, Flannery O’Connor et Eudora Welty. Ces trois auteurs du Sud remettent l’excentrique au centre en intégrant les personnages reclus dans les dynamiques sociales de leur environnement : les célibataires ne sont pas exclus du jeu amoureux, et le corps isolé est tout à la fois objet de désir et sujet de poésie érotique. Profondément déstabilisants, ces personnages utilisent l’expérience de la réclusion comme un écran de fumée qui leur permet de transgresser des tabous particulièrement vifs dans cette région conservatrice et ségrégationniste.
Ces figures de l’enfermement se retrouvent ainsi au beau milieu d’un entrelacs de relations. Cette analyse s’efforce de démontrer l’extrême ambiguïté d’une figure en apparence marquée par la pauvreté des relations sociales et le manque de mouvement. Circonscrite dans le Sud de Faulkner, O’Connor et Welty, la figure du reclus résonne finalement dans toute la nation américaine de ses nombreux échos intertextuels et culturels.
-
 Folklore sur les vampires dans la littérature et les arts européens entre le XVIIIe et le XXe siècle.
Folklore sur les vampires dans la littérature et les arts européens entre le XVIIIe et le XXe siècle. Il s'agit d'une étude sur le folklore à propos de la figure du vampire et de sa remobilisation dans les arts et la littérature entre le XVIIIe et le XXe siècle. Une large partie du mémoire est également dédiée aux enjeux de la remobilisation des légendes populaires dans la construction des identités nationales au XIXe siècle, en particulier en Grèce et en Europe de l'Est. Les ouvrages étudiés proviennent d'Angleterre, de Roumanie, d'Allemagne, de France, de Grèce et de Russie. Nous avons également étudié des œuvres cinématographiques et picturales et introduit une analyse genrée de la figure de la femme fatale dans le romantisme. Enfin, nous abordons le mouvement primitiviste du XXe siècle tel qu'il était pensé par les artistes balkaniques et slaves.
-
 Les dépôts métalliques du BFa 3 (950-800 av. J.-C.) en Gaule atlantique. Modalités de circulation, de manipulation et d'enfouissement du métal.
Les dépôts métalliques du BFa 3 (950-800 av. J.-C.) en Gaule atlantique. Modalités de circulation, de manipulation et d'enfouissement du métal. À la fin de l’âge du Bronze (950-800 av. J.-C.), la pratique consistant à enfouir hors de tout contexte funéraire des produits métalliques connaît un accroissement considérable en Gaule atlantique. Dans cet espace, s’étirant de la Charente aux Flandres, 255 dépôts sont signalés, livrant pas moins de 18 000 éléments métalliques. Malgré d’importantes avancées dans la compréhension de cette pratique, l’enchaînement précis des actions ayant conduit à la constitution des dépôts fait encore l’objet d’hypothèses variées et contradictoires. Les éléments qui sont le plus discutés concernent la place et le rôle de la fragmentation et des manipulations vis-à-vis des enfouissements, la réalité d’actes de sélection et d’exclusion, la durée de collecte du métal, le caractère définitif ou au contraire provisoire des dépôts, ainsi que l’intégration de cette pratique dans les systèmes économiques de la fin de l’âge du Bronze.
Notre objectif a été de rassembler et d’interroger cette documentation afin de restituer les principales modalités de constitutions des dépôts du BFa 3 et de contribuer à caractériser le paysage techno-économique et culturel de la fin de l’âge du Bronze.
Parmi les nombreuses questions intermédiaires que soulève ce sujet, les plus essentielles renvoient au statut du métal au moment de son enfouissement. Les restes métalliques sont-ils immobilisés pour leur valeur d’échange, d’usage ou pour leur éventuelle charge symbolique ? Ces lots sont-ils accumulés aléatoirement au gré des dynamiques de production et de circulation du métal ou bien témoignent-ils de phénomènes de sélection et de manipulation suffisamment puissants et normés pour ordonner la manière dont le métal est immobilisé ? Les différents traitements perceptibles sur les objets (fragmentation, manipulations diverses, choix des objets) interviennent-ils au moment et pour les besoins des immobilisations ou bien en sont-ils complètement déconnectés ?
D’après nos observations, les dépôts du BFa 3 peuvent être considérés comme des ensembles majoritairement constitués à partir d’éléments dont l’usage a pu être prémonétaire. Cependant, le rassemblement du métal n’est pour autant pas complètement aléatoire et certaines manipulations ne renvoient pas à de simples considérations techno-économiques. Des compositions types, correspondants à des traits culturels suffisamment marqués, ont par ailleurs été identifiées. Les variations d’un espace à un autre seraient expliquées par l’enchevêtrement de plusieurs facteurs. Certains dépendent de la structure des groupes pratiquant les dépôts : la taille des communautés impliquées, leur composition sociale et les choix effectués quant à la quantité de métal immobilisée. D’autres sont le fait de la manière dont le métal circule : accès au métal, intensité des échanges et nombre d’agents économiques impliqués, existence ou non d’objets prémonétaires plus favorablement employés que d’autres. D’autres variables encore renvoient à des considérations ayant trait à l’intentionnalité des dépôts, mais aussi aux systèmes symboliques imprégnant de manière variable les différents groupes culturels de la fin de l’âge du Bronze. En cela nous pensons qu’un objet ayant perdu sa valeur d’usage peut, indépendamment de sa valeur d’échange, conserver une charge symbolique mobilisable dans le cadre des dépôts (matérialisant un individu, un groupe culturel, un statut, une idée, le cycle de vie du métal), mais aussi une valeur historique ou mémorielle, notamment quand il s’agit d’objets anciens. La concomitance d’immobilisations définitives et d’autres, provisoires, est enfin suggérée, mais devra, à l’avenir, faire l’objet d’investigations contextuelles nombreuses et précises.
 Dessin d’animation, textures et traits de mémoire Exploration du potentiel graphique et narratif de la texture afin d'appuyer des émotions, sensations et de caractériser des lieux et des personnages dans un film d'animation.
Dessin d’animation, textures et traits de mémoire Exploration du potentiel graphique et narratif de la texture afin d'appuyer des émotions, sensations et de caractériser des lieux et des personnages dans un film d'animation.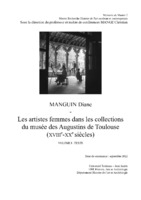 Les artistes femmes dans les collections du musée des Augustins de Toulouse (XVIIIe-XXe siècles) Au sein des collections du musée, seules 4,7 % des œuvres ont été réalisées par des femmes. Quelles sont les raisons d'un tel écart ? Existe-t-il des moyens de rééquilibrer ces lacunes ? Quelles sont les initiatives portées par les musées ? Loin d'être un cas isolé, plusieurs institutions se sont engagées pour donner davantage de visibilité aux créatrices. Leur faible représentation s'explique par un contexte socio-historique où la formation et la reconnaissance institutionnelle n'allaient pas de soi jusqu'au XXe siècle. Les études de genre et le féminisme ont contribué à remettre en question l'histoire de l'art pour penser différemment les collections des musées. Ainsi, le musée des Augustins conserve une centaine d’œuvres d'artistes femmes. Grâce à la rédaction de biographies et de commentaires d’œuvres, il s'agit de valoriser leurs productions, majoritairement conservées dans les réserves. Des statistiques sur leur représentation dans les collections permanentes et temporaires ont été réalisées. Elles sont mises en regard avec un entretien mené auprès du conservateur du musée. Ces différents outils permettent d'établir une méthodologie pour mener un état des lieux et une analyse de la situation à l'instant T. Cette étude est confrontée aux initiatives portées par d'autres musées, notamment dans le domaine de l'acquisition, de l'exposition ou encore de la médiation. Ce travail se pense aussi comme un outil de réflexion pour demain. Lutter contre l'invisibilité ne peut se faire sans engager une réflexion sur l'ensemble de la politique muséale. Si les événements ponctuels sont pertinents, ce sont les initiatives répétées et qui s'inscrivent sur le long terme qui permettront de ne plus avoir à distinguer les artistes femmes, pour s'inscrire un jour dans une égalité qui n'a pas de sexe.
Les artistes femmes dans les collections du musée des Augustins de Toulouse (XVIIIe-XXe siècles) Au sein des collections du musée, seules 4,7 % des œuvres ont été réalisées par des femmes. Quelles sont les raisons d'un tel écart ? Existe-t-il des moyens de rééquilibrer ces lacunes ? Quelles sont les initiatives portées par les musées ? Loin d'être un cas isolé, plusieurs institutions se sont engagées pour donner davantage de visibilité aux créatrices. Leur faible représentation s'explique par un contexte socio-historique où la formation et la reconnaissance institutionnelle n'allaient pas de soi jusqu'au XXe siècle. Les études de genre et le féminisme ont contribué à remettre en question l'histoire de l'art pour penser différemment les collections des musées. Ainsi, le musée des Augustins conserve une centaine d’œuvres d'artistes femmes. Grâce à la rédaction de biographies et de commentaires d’œuvres, il s'agit de valoriser leurs productions, majoritairement conservées dans les réserves. Des statistiques sur leur représentation dans les collections permanentes et temporaires ont été réalisées. Elles sont mises en regard avec un entretien mené auprès du conservateur du musée. Ces différents outils permettent d'établir une méthodologie pour mener un état des lieux et une analyse de la situation à l'instant T. Cette étude est confrontée aux initiatives portées par d'autres musées, notamment dans le domaine de l'acquisition, de l'exposition ou encore de la médiation. Ce travail se pense aussi comme un outil de réflexion pour demain. Lutter contre l'invisibilité ne peut se faire sans engager une réflexion sur l'ensemble de la politique muséale. Si les événements ponctuels sont pertinents, ce sont les initiatives répétées et qui s'inscrivent sur le long terme qui permettront de ne plus avoir à distinguer les artistes femmes, pour s'inscrire un jour dans une égalité qui n'a pas de sexe. Nostalgie, apathie et motivation intrinsèque dans le vieillissement : un regard croisé Cette thèse explore les relations croisées entre la nostalgie, l’apathie et la motivation intrinsèque chez les personnes âgées. Pour réaliser ce travail, 4 études ont été conduites. L’étude 1 a pour objectif de valider une échelle d’évaluation de la nostalgie dédiée à la personne âgée. L’analyse de la validité convergente et divergente nous a permis de disposer d’un outil d’évaluation adapté. Des analyses corrélationnelles ont montré que la nostalgie serait une stratégie adaptative, à condition de percevoir le passé positivement. L’étude 2 explore la valeur causale des émotions négatives et de la conception de soi sur l’apparition du comportement apathique. Des analyses descriptives et de régression nous ont permis d’identifier le rôle causal de la conception de soi et évolutif des émotions négatives sur l’apathie. L’étude 3 a pour objectif d’étudier les relations entre la nostalgie, l’apathie, le bien-être et la motivation intrinsèque chez la personne âgée. Les résultats ont corroboré le caractère central de la perception positive du passé dans l’augmentation du bien-être. Contrairement à la nostalgie, l’apathie serait associée négativement à la motivation intrinsèque et ainsi diminuerait son intensité. Il n’a pas été observé de lien entre la nostalgie et l’apathie. L’étude 4 vise à déterminer les directions des relations entre l’apathie, les déficits cognitifs et l’altération de la conscience. Les résultats ont montré que la personne âgée avec des déficits cognitifs présenteraient une altération de la conscience vis-à-vis de son comportement apathique. Des analyses de médiation ont permis d’attribuer un rôle médiateur à l’apathie. A l’issue de ce travail de recherche, la nostalgie pourrait être envisagée comme une stratégie de régulation émotionnelle chez la personne âgée. L’apathie participerait à la diminution des comportements motivés intrinsèquement. Nous n’avons pas observé de lien entre la nostalgie et l’apathie chez la personne âgée. De futures recherches devraient explorer l’intérêt d’une thérapie centrée sur la nostalgie et l’analyse d’interventions pouvant permettre la réduction du symptôme apathique chez la personne âgée.
Nostalgie, apathie et motivation intrinsèque dans le vieillissement : un regard croisé Cette thèse explore les relations croisées entre la nostalgie, l’apathie et la motivation intrinsèque chez les personnes âgées. Pour réaliser ce travail, 4 études ont été conduites. L’étude 1 a pour objectif de valider une échelle d’évaluation de la nostalgie dédiée à la personne âgée. L’analyse de la validité convergente et divergente nous a permis de disposer d’un outil d’évaluation adapté. Des analyses corrélationnelles ont montré que la nostalgie serait une stratégie adaptative, à condition de percevoir le passé positivement. L’étude 2 explore la valeur causale des émotions négatives et de la conception de soi sur l’apparition du comportement apathique. Des analyses descriptives et de régression nous ont permis d’identifier le rôle causal de la conception de soi et évolutif des émotions négatives sur l’apathie. L’étude 3 a pour objectif d’étudier les relations entre la nostalgie, l’apathie, le bien-être et la motivation intrinsèque chez la personne âgée. Les résultats ont corroboré le caractère central de la perception positive du passé dans l’augmentation du bien-être. Contrairement à la nostalgie, l’apathie serait associée négativement à la motivation intrinsèque et ainsi diminuerait son intensité. Il n’a pas été observé de lien entre la nostalgie et l’apathie. L’étude 4 vise à déterminer les directions des relations entre l’apathie, les déficits cognitifs et l’altération de la conscience. Les résultats ont montré que la personne âgée avec des déficits cognitifs présenteraient une altération de la conscience vis-à-vis de son comportement apathique. Des analyses de médiation ont permis d’attribuer un rôle médiateur à l’apathie. A l’issue de ce travail de recherche, la nostalgie pourrait être envisagée comme une stratégie de régulation émotionnelle chez la personne âgée. L’apathie participerait à la diminution des comportements motivés intrinsèquement. Nous n’avons pas observé de lien entre la nostalgie et l’apathie chez la personne âgée. De futures recherches devraient explorer l’intérêt d’une thérapie centrée sur la nostalgie et l’analyse d’interventions pouvant permettre la réduction du symptôme apathique chez la personne âgée. Est-ce vraiment « juste une blague » ? Effet du groupe ciblé, des préjugés et de l’adhésion aux stéréotypes sur la perception de l’humour de dénigrement : une approche expérimentale L’humour de dénigrement (e.g., humours raciste, sexiste) est une forme de communication destinée à faire rire ou sourire qui rabaisse, dénigre ou diffame une cible donnée (Ford & Ferguson, 2004) en se basant majoritairement sur les stéréotypes pour faire rire (Mallett et al., 2016). Naturellement ambivalente, cette forme d’humour communique un message de dénigrement explicite associé à un message implicite qui suggère que ce message doit être pris d’une manière légère (Ford et al., 2017). Si elle peut permettre de remettre en cause le statu quo ou de souligner l’absurdité des stéréotypes et préjugés (Miller et al., 2019), ses effets sont majoritairement négatifs. Elle véhicule et renforce les stéréotypes et favorise l’expression des préjugés (Ford & Ferguson, 2004), contribue à la tolérance envers la discrimination (Ford et al., 2014) et augmente les comportements discriminatoires (Thomae & Viki, 2013). Il semblerait que ces effets soient avérés uniquement sur des groupes envers lesquels l'acceptabilité sociale de l'expression des préjugés est ambivalente (i.e., appartenant à la fenêtre normative des préjugés ; Mendiburo-Seguel & Ford, 2019) et qu’ils diffèrent en fonction de la perception de cet humour (Saucier et al., 2019). Pourtant, les potentielles différences de perception de l’humour dénigrant des groupes en fonction de leur appartenance à la fenêtre normative n’ont jamais été investiguées. À travers sept expériences (Ntotal = 1437), cette thèse vise à étudier les effets de l’appartenance du groupe ciblé à la fenêtre normative des préjugés, des préjugés et de l'adhésion aux stéréotypes sur la perception de l'humour de dénigrement. Sa contribution est double : elle se situe à la fois sur le plan de l’amélioration méthodologique de l’étude de l’humour de dénigrement (nouveautés méthodologiques et statistiques afin de renforcer les validités interne et externe) et à l’exploration d’hypothèses nouvelles (effet de la cible de l’humour). Dans la première partie empirique, nous avons comparé la perception de mêmes matériels humoristiques dénigrants sur le stéréotype commun de « malhonnêteté » partagés par deux groupes, l’un appartenant à la fenêtre normative des préjugés (personnes d’origine maghrébine) et le second n’y appartenant pas (hommes politiques). La seconde partie empirique reprend le même principe sur l’humour sexiste. Le recours au stéréotype de « stupidité » partagé à la fois par les hommes (en dehors de la fenêtre normative des préjugés) et les femmes (dans la fenêtre) permettait ainsi de reproduire le même paradigme pour deux autres groupes et, notamment, de tester l’effet de l’appartenance groupale. Une autre originalité de ce travail est le recours à des mesures indirectes (SC-IAT-P, Bardin et al., 2014, partie 1) et directes (i.e., questionnaires, parties 1 et 2) pour tester l’effet des préjugés sur la perception de l’humour de dénigrement. Ce travail suggère que, plus que le matériel humoristique utilisé ou l’appartenance groupale, le groupe dénigré est un facteur prépondérant de la perception de l’humour de dénigrement. En amont, plus les individus ont des préjugés négatifs et adhèrent aux stéréotypes à l’égard de la cible, plus ils ont tendance à apprécier, à juger socialement acceptable et à évaluer comme moins offensante cette forme d’humour. Ce travail fournit ainsi une illustration supplémentaire que l’humour sexiste ou raciste n’est jamais « juste une blague ». Les résultats seront discutés en termes de perspectives visant, d'une part à établir dans quelle mesure le contexte et la source modulent l’effet et, d’autre part, dans des perspectives plus concrètes visant à avoir recours à l’humour de dénigrement afin de réduire les préjugés et stéréotypes. Ces éléments sont d’autant plus importants que cette forme d’humour est perçue aujourd’hui comme une manifestation des préjugés largement tolérée et répandue (Haut conseil de l’égalité entre les hommes et les femmes, 2019).
Est-ce vraiment « juste une blague » ? Effet du groupe ciblé, des préjugés et de l’adhésion aux stéréotypes sur la perception de l’humour de dénigrement : une approche expérimentale L’humour de dénigrement (e.g., humours raciste, sexiste) est une forme de communication destinée à faire rire ou sourire qui rabaisse, dénigre ou diffame une cible donnée (Ford & Ferguson, 2004) en se basant majoritairement sur les stéréotypes pour faire rire (Mallett et al., 2016). Naturellement ambivalente, cette forme d’humour communique un message de dénigrement explicite associé à un message implicite qui suggère que ce message doit être pris d’une manière légère (Ford et al., 2017). Si elle peut permettre de remettre en cause le statu quo ou de souligner l’absurdité des stéréotypes et préjugés (Miller et al., 2019), ses effets sont majoritairement négatifs. Elle véhicule et renforce les stéréotypes et favorise l’expression des préjugés (Ford & Ferguson, 2004), contribue à la tolérance envers la discrimination (Ford et al., 2014) et augmente les comportements discriminatoires (Thomae & Viki, 2013). Il semblerait que ces effets soient avérés uniquement sur des groupes envers lesquels l'acceptabilité sociale de l'expression des préjugés est ambivalente (i.e., appartenant à la fenêtre normative des préjugés ; Mendiburo-Seguel & Ford, 2019) et qu’ils diffèrent en fonction de la perception de cet humour (Saucier et al., 2019). Pourtant, les potentielles différences de perception de l’humour dénigrant des groupes en fonction de leur appartenance à la fenêtre normative n’ont jamais été investiguées. À travers sept expériences (Ntotal = 1437), cette thèse vise à étudier les effets de l’appartenance du groupe ciblé à la fenêtre normative des préjugés, des préjugés et de l'adhésion aux stéréotypes sur la perception de l'humour de dénigrement. Sa contribution est double : elle se situe à la fois sur le plan de l’amélioration méthodologique de l’étude de l’humour de dénigrement (nouveautés méthodologiques et statistiques afin de renforcer les validités interne et externe) et à l’exploration d’hypothèses nouvelles (effet de la cible de l’humour). Dans la première partie empirique, nous avons comparé la perception de mêmes matériels humoristiques dénigrants sur le stéréotype commun de « malhonnêteté » partagés par deux groupes, l’un appartenant à la fenêtre normative des préjugés (personnes d’origine maghrébine) et le second n’y appartenant pas (hommes politiques). La seconde partie empirique reprend le même principe sur l’humour sexiste. Le recours au stéréotype de « stupidité » partagé à la fois par les hommes (en dehors de la fenêtre normative des préjugés) et les femmes (dans la fenêtre) permettait ainsi de reproduire le même paradigme pour deux autres groupes et, notamment, de tester l’effet de l’appartenance groupale. Une autre originalité de ce travail est le recours à des mesures indirectes (SC-IAT-P, Bardin et al., 2014, partie 1) et directes (i.e., questionnaires, parties 1 et 2) pour tester l’effet des préjugés sur la perception de l’humour de dénigrement. Ce travail suggère que, plus que le matériel humoristique utilisé ou l’appartenance groupale, le groupe dénigré est un facteur prépondérant de la perception de l’humour de dénigrement. En amont, plus les individus ont des préjugés négatifs et adhèrent aux stéréotypes à l’égard de la cible, plus ils ont tendance à apprécier, à juger socialement acceptable et à évaluer comme moins offensante cette forme d’humour. Ce travail fournit ainsi une illustration supplémentaire que l’humour sexiste ou raciste n’est jamais « juste une blague ». Les résultats seront discutés en termes de perspectives visant, d'une part à établir dans quelle mesure le contexte et la source modulent l’effet et, d’autre part, dans des perspectives plus concrètes visant à avoir recours à l’humour de dénigrement afin de réduire les préjugés et stéréotypes. Ces éléments sont d’autant plus importants que cette forme d’humour est perçue aujourd’hui comme une manifestation des préjugés largement tolérée et répandue (Haut conseil de l’égalité entre les hommes et les femmes, 2019). Socialisation sportive de haut niveau et construction du genre féminin : le cas de la gymnastique rythmique Au croisement de la sociologie des dispositions, de la carrière, du genre et l’interactionnisme de Goffman ce travail de thèse questionne les effets de la socialisation sportive de haut niveau sur la construction sociale du genre féminin en gymnastique rythmique. Il s’appuie sur une enquête de type ethnographique, qualitative, mobilisant des observations de gymnastes au sein de pôles sportifs en France ainsi que des entretiens semi-directifs auprès de gymnastes de haut niveau faisant ou ayant fait carrière. Pratique sportive féminine par excellence, la socialisation gymnique favorise l’incorporation d’un habitus « GR », propice au développement de dispositions de genre « hybrides ». La précocité et sa dimension hypersexuée de la carrière œuvrent alors à une transformation de soi et de la féminité de ce jeune public. Ce faisant, les jeunes gymnastes qui choisissent de s’y engager entament durant leur jeunesse un profond processus de transformation et « d’optimisation » de soi (Dalgalarrondo, 2018, 2019) et de leur corps, outil de production de la performance. Par ailleurs, elle implique un processus d’esthétisation féminine des corps dans l’hyper ritualisation du corps (Goffman, 1977) sur la scène sportive, mais également dans la production d’un corps désirable (De Saint Pol, 2010). Le processus de gestion du poids et la transformation des pratiques alimentaires occupent ainsi un rôle central dans ce travail de soi qu’implique la fabrication d’un « corps de GR ». Les gymnastes peuvent aller jusqu’à entrer dans une carrière anorexique de performance (Darmon 2003) par vocation sportive. Ce processus lent, irrégulier, invisible de construction d’une « hexis corporelle » GR se déroule au sein d’une institution sportive qui opère comme une instance de transformation des dispositions par son caractère enveloppant (Darmon, 2013) voire totalisant (Goffman, 1961). La fabrication d’un corps de GR optimisé est enfin une œuvre collective (Demazière et coll, 2015) au contact d’autruis significatifs (Berger, Kellner, Luckmann, 1988) charismatique que sont principalement les entraîneures, gymnastes et juges. En fin de compte, ce travail de soi associe une « féminité accentuée » (Connell, 1987) visible renvoyant à un corps ultra féminisé reproduisant les stéréotypes d’une féminité légitime et d’autre part, une féminité « performative » invisible où la maîtrise de la grâce et du beau geste font écho à des exigences technico-esthétiques apprises par la sueur, la répétition et l’effort, la combativité, attributs socialement associés au masculin (Messner 1992 ; Guerandel 2016). À ce propos, sortie de carrière, certaines dispositions antérieures vont résister à cette socialisation corporelle très forte en fonction des trajectoires sociales des gymnastes. De la même manière, les dispositions acquises au cours de la carrière vont conserver une certaine « force d’entraînement » et agir sur les différents domaines de l’existence, y compris professionnelle.
Socialisation sportive de haut niveau et construction du genre féminin : le cas de la gymnastique rythmique Au croisement de la sociologie des dispositions, de la carrière, du genre et l’interactionnisme de Goffman ce travail de thèse questionne les effets de la socialisation sportive de haut niveau sur la construction sociale du genre féminin en gymnastique rythmique. Il s’appuie sur une enquête de type ethnographique, qualitative, mobilisant des observations de gymnastes au sein de pôles sportifs en France ainsi que des entretiens semi-directifs auprès de gymnastes de haut niveau faisant ou ayant fait carrière. Pratique sportive féminine par excellence, la socialisation gymnique favorise l’incorporation d’un habitus « GR », propice au développement de dispositions de genre « hybrides ». La précocité et sa dimension hypersexuée de la carrière œuvrent alors à une transformation de soi et de la féminité de ce jeune public. Ce faisant, les jeunes gymnastes qui choisissent de s’y engager entament durant leur jeunesse un profond processus de transformation et « d’optimisation » de soi (Dalgalarrondo, 2018, 2019) et de leur corps, outil de production de la performance. Par ailleurs, elle implique un processus d’esthétisation féminine des corps dans l’hyper ritualisation du corps (Goffman, 1977) sur la scène sportive, mais également dans la production d’un corps désirable (De Saint Pol, 2010). Le processus de gestion du poids et la transformation des pratiques alimentaires occupent ainsi un rôle central dans ce travail de soi qu’implique la fabrication d’un « corps de GR ». Les gymnastes peuvent aller jusqu’à entrer dans une carrière anorexique de performance (Darmon 2003) par vocation sportive. Ce processus lent, irrégulier, invisible de construction d’une « hexis corporelle » GR se déroule au sein d’une institution sportive qui opère comme une instance de transformation des dispositions par son caractère enveloppant (Darmon, 2013) voire totalisant (Goffman, 1961). La fabrication d’un corps de GR optimisé est enfin une œuvre collective (Demazière et coll, 2015) au contact d’autruis significatifs (Berger, Kellner, Luckmann, 1988) charismatique que sont principalement les entraîneures, gymnastes et juges. En fin de compte, ce travail de soi associe une « féminité accentuée » (Connell, 1987) visible renvoyant à un corps ultra féminisé reproduisant les stéréotypes d’une féminité légitime et d’autre part, une féminité « performative » invisible où la maîtrise de la grâce et du beau geste font écho à des exigences technico-esthétiques apprises par la sueur, la répétition et l’effort, la combativité, attributs socialement associés au masculin (Messner 1992 ; Guerandel 2016). À ce propos, sortie de carrière, certaines dispositions antérieures vont résister à cette socialisation corporelle très forte en fonction des trajectoires sociales des gymnastes. De la même manière, les dispositions acquises au cours de la carrière vont conserver une certaine « force d’entraînement » et agir sur les différents domaines de l’existence, y compris professionnelle. Modèles chromatiques et maquillage biologique : de l’immersion dans un laboratoire à façon à la création de portraits en design-couleur Dans un contexte sociétal et économique favorable aux relations entre recherche publique et privée, le dispositif CIFRE (Conventions industrielles de formation par la recherche) a permis à ce travail de voir le jour grâce à l’articulation d’une recherche académique poursuivie à l’Université de Toulouse et d’une approche pratique mûrie au sein d’une entreprise montpelliéraine spécialisée dans la cosmétique de soin biologique. L’entreprise cherchait à concevoir une gamme de maquillage différenciante, végane et certifiée biologique afin de compléter son offre. L’exercice de la recherche universitaire a permis de proposer une réponse pratique à la création de gamme et d’explorer par la réflexion académique la question de la naturalité dans le champ de la cosmétique. Ce travail s’appuie sur l’hypothèse suivante : les couleurs naturelles et les couleurs non naturelles ne représentent pas les mêmes espaces de modélisation chromatique. Par conséquent, intégrer un profil de coloriste designer au sein d’un laboratoire de Recherche & Développement permettrait de (re)penser/classer la couleur, d’apporter un regard nouveau sur les pratiques de ce lieu et de faire se rencontrer le chimiste et le designer. Les idées et les approches ont divergé et se sont parfois même opposées. Cette situation complexe s’est transformée en opportunité pour créer de nouveaux procédés, méthodes et langages entre le domaine disciplinaire du design et de la chimie, entre le design et d’autres métiers. Cette opportunité a contribué à la facilitation de la conception de prototype de maquillage. Elle a par la suite été appliquée à une réflexion autour des concepts biologique/naturel/naturelle par le biais de la sociologie des usages et des représentations de la femme cosmétique et de l’histoire de la beauté. Suite à l’observation de la polysémie du terme naturel, il convenait ensuite de s’intéresser au sens défendu par une marque comme positionnement et celui de la caractérisation d’un produit qui répond à un référentiel biologique. Devant la confusion et le nombre de produits sur le marché répondant à cette image, ou du moins à l’image que l’on se fait du produit biologique ou naturel, il était nécessaire de questionner les clichés et les stéréotypes qui l’entourent. L’enjeu était alors de promouvoir une pensée industrielle différente, en dépassant les clichés et en misant sur l’innovation par le design chromatique et le faire français biologique par une approche poétique. Ce travail s’intéresse au fonctionnement de ce stéréotype, de l’image, dans le champ de la cosmétique et plus spécifiquement appliqué aux portraits de femmes. Cette thèse suggère de repenser les codes et d’envisager, finalement, un nouveau mode de consommation plus douce et responsable.
Modèles chromatiques et maquillage biologique : de l’immersion dans un laboratoire à façon à la création de portraits en design-couleur Dans un contexte sociétal et économique favorable aux relations entre recherche publique et privée, le dispositif CIFRE (Conventions industrielles de formation par la recherche) a permis à ce travail de voir le jour grâce à l’articulation d’une recherche académique poursuivie à l’Université de Toulouse et d’une approche pratique mûrie au sein d’une entreprise montpelliéraine spécialisée dans la cosmétique de soin biologique. L’entreprise cherchait à concevoir une gamme de maquillage différenciante, végane et certifiée biologique afin de compléter son offre. L’exercice de la recherche universitaire a permis de proposer une réponse pratique à la création de gamme et d’explorer par la réflexion académique la question de la naturalité dans le champ de la cosmétique. Ce travail s’appuie sur l’hypothèse suivante : les couleurs naturelles et les couleurs non naturelles ne représentent pas les mêmes espaces de modélisation chromatique. Par conséquent, intégrer un profil de coloriste designer au sein d’un laboratoire de Recherche & Développement permettrait de (re)penser/classer la couleur, d’apporter un regard nouveau sur les pratiques de ce lieu et de faire se rencontrer le chimiste et le designer. Les idées et les approches ont divergé et se sont parfois même opposées. Cette situation complexe s’est transformée en opportunité pour créer de nouveaux procédés, méthodes et langages entre le domaine disciplinaire du design et de la chimie, entre le design et d’autres métiers. Cette opportunité a contribué à la facilitation de la conception de prototype de maquillage. Elle a par la suite été appliquée à une réflexion autour des concepts biologique/naturel/naturelle par le biais de la sociologie des usages et des représentations de la femme cosmétique et de l’histoire de la beauté. Suite à l’observation de la polysémie du terme naturel, il convenait ensuite de s’intéresser au sens défendu par une marque comme positionnement et celui de la caractérisation d’un produit qui répond à un référentiel biologique. Devant la confusion et le nombre de produits sur le marché répondant à cette image, ou du moins à l’image que l’on se fait du produit biologique ou naturel, il était nécessaire de questionner les clichés et les stéréotypes qui l’entourent. L’enjeu était alors de promouvoir une pensée industrielle différente, en dépassant les clichés et en misant sur l’innovation par le design chromatique et le faire français biologique par une approche poétique. Ce travail s’intéresse au fonctionnement de ce stéréotype, de l’image, dans le champ de la cosmétique et plus spécifiquement appliqué aux portraits de femmes. Cette thèse suggère de repenser les codes et d’envisager, finalement, un nouveau mode de consommation plus douce et responsable. Du paternalisme médical au partenariat en santé. Caractérisation et modélisation du processus d’émancipation par le croisement des savoirs dans la recherche-intervention La démarche de Recherche-Intervention (R-I) en sciences de l’éducation et de la formation se présente comme un cadre privilégié pour accompagner le changement. Elle poursuit une triple visée - heuristique, praxéologique et émancipatrice - et affirme le principe d’une démarche participative. Par l’interdépendance de la recherche et de l’intervention, reliant les sphères académique et socio-professionnelle, elle positionne les acteurs sociaux comme coproducteurs de la recherche en légitimant leur compréhension du changement étudié, leur engagement à la production de savoirs utiles à l’action. L’objectif de cette thèse est d’interroger l’effectivité des dynamiques individuelles et collectives d’émancipation dans le cadre d’une R-I commanditée par l’Agence Régionale de Santé Occitanie pour accompagner le changement que porte le partenariat en santé. Cette commande institutionnalise le projet de R-I et instaure le principe de la participation des acteurs — professionnels de santé, personnes en soin et usagers, chercheurs — au sein du tiers-espace socio-scientifique. Le partenariat en santé, changement paradigmatique et systémique, se présente comme le moyen et la finalité de la démarche. Les orientations épistémologiques et théoriques, s’inscrivant dans la pensée du pédagogue brésilien Paulo Freire, conduisent à mettre en œuvre le croisement des savoirs au sein du tiers-espace socio-scientifique « partenariat en santé » comme stratégie d’alphabétisation sociale pour accompagner ce changement. Une recherche qualitative phénoménologique à visée compréhensive est menée afin de comprendre les phénomènes, en saisir l’essence à partir du sens donné par les acteurs qui en font l’expérience. Un recueil longitudinal des éléments empiriques est opéré à partir de 56 entretiens d’explicitation ; le traitement et l’analyse de données par la méthode IPA (Interpretative Phenomenological Analysis) sont retenus. Les résultats de cette thèse permettent d’objectiver et caractériser les processus collectifs (les transformations) et individuels (les déplacements) d’émancipation des acteurs dans le contexte de la R-I « partenariat en santé ». La mise à distance et la discussion de ces matériaux proposent de compléter la théorisation de la R-I, par une contribution à une modélisation de ses processus d’émancipation par le croisement des savoirs.
Du paternalisme médical au partenariat en santé. Caractérisation et modélisation du processus d’émancipation par le croisement des savoirs dans la recherche-intervention La démarche de Recherche-Intervention (R-I) en sciences de l’éducation et de la formation se présente comme un cadre privilégié pour accompagner le changement. Elle poursuit une triple visée - heuristique, praxéologique et émancipatrice - et affirme le principe d’une démarche participative. Par l’interdépendance de la recherche et de l’intervention, reliant les sphères académique et socio-professionnelle, elle positionne les acteurs sociaux comme coproducteurs de la recherche en légitimant leur compréhension du changement étudié, leur engagement à la production de savoirs utiles à l’action. L’objectif de cette thèse est d’interroger l’effectivité des dynamiques individuelles et collectives d’émancipation dans le cadre d’une R-I commanditée par l’Agence Régionale de Santé Occitanie pour accompagner le changement que porte le partenariat en santé. Cette commande institutionnalise le projet de R-I et instaure le principe de la participation des acteurs — professionnels de santé, personnes en soin et usagers, chercheurs — au sein du tiers-espace socio-scientifique. Le partenariat en santé, changement paradigmatique et systémique, se présente comme le moyen et la finalité de la démarche. Les orientations épistémologiques et théoriques, s’inscrivant dans la pensée du pédagogue brésilien Paulo Freire, conduisent à mettre en œuvre le croisement des savoirs au sein du tiers-espace socio-scientifique « partenariat en santé » comme stratégie d’alphabétisation sociale pour accompagner ce changement. Une recherche qualitative phénoménologique à visée compréhensive est menée afin de comprendre les phénomènes, en saisir l’essence à partir du sens donné par les acteurs qui en font l’expérience. Un recueil longitudinal des éléments empiriques est opéré à partir de 56 entretiens d’explicitation ; le traitement et l’analyse de données par la méthode IPA (Interpretative Phenomenological Analysis) sont retenus. Les résultats de cette thèse permettent d’objectiver et caractériser les processus collectifs (les transformations) et individuels (les déplacements) d’émancipation des acteurs dans le contexte de la R-I « partenariat en santé ». La mise à distance et la discussion de ces matériaux proposent de compléter la théorisation de la R-I, par une contribution à une modélisation de ses processus d’émancipation par le croisement des savoirs. Existences cloîtrées et dynamiques de la réclusion dans les œuvres de William Faulkner, Flannery O'Connor et Eudora Welty Le mythe, selon Jean-Jacques Lecercle, est une somme de contradictions qui assure sa pérennité. La cohabitation des notions contraires d’ouverture et de fermeture qui caractérise le personnage reclus a permis, au même titre que sa nature archétypale, de l’inscrire durablement dans la littérature européenne. Cette thèse s’attache à démontrer qu’un transfert transatlantique s’est opéré au fil des siècles, transposant le reclus européen à la culture américaine et au Sud des États-Unis. L’ermite médiéval ou romantique s’y mue progressivement en personnage marginal et dissonant : la vieille fille, l’intellectuel incompris ou encore la jeune femme entravée peuplent les nouvelles et romans de William Faulkner, Flannery O’Connor et Eudora Welty. Ces trois auteurs du Sud remettent l’excentrique au centre en intégrant les personnages reclus dans les dynamiques sociales de leur environnement : les célibataires ne sont pas exclus du jeu amoureux, et le corps isolé est tout à la fois objet de désir et sujet de poésie érotique. Profondément déstabilisants, ces personnages utilisent l’expérience de la réclusion comme un écran de fumée qui leur permet de transgresser des tabous particulièrement vifs dans cette région conservatrice et ségrégationniste. Ces figures de l’enfermement se retrouvent ainsi au beau milieu d’un entrelacs de relations. Cette analyse s’efforce de démontrer l’extrême ambiguïté d’une figure en apparence marquée par la pauvreté des relations sociales et le manque de mouvement. Circonscrite dans le Sud de Faulkner, O’Connor et Welty, la figure du reclus résonne finalement dans toute la nation américaine de ses nombreux échos intertextuels et culturels.
Existences cloîtrées et dynamiques de la réclusion dans les œuvres de William Faulkner, Flannery O'Connor et Eudora Welty Le mythe, selon Jean-Jacques Lecercle, est une somme de contradictions qui assure sa pérennité. La cohabitation des notions contraires d’ouverture et de fermeture qui caractérise le personnage reclus a permis, au même titre que sa nature archétypale, de l’inscrire durablement dans la littérature européenne. Cette thèse s’attache à démontrer qu’un transfert transatlantique s’est opéré au fil des siècles, transposant le reclus européen à la culture américaine et au Sud des États-Unis. L’ermite médiéval ou romantique s’y mue progressivement en personnage marginal et dissonant : la vieille fille, l’intellectuel incompris ou encore la jeune femme entravée peuplent les nouvelles et romans de William Faulkner, Flannery O’Connor et Eudora Welty. Ces trois auteurs du Sud remettent l’excentrique au centre en intégrant les personnages reclus dans les dynamiques sociales de leur environnement : les célibataires ne sont pas exclus du jeu amoureux, et le corps isolé est tout à la fois objet de désir et sujet de poésie érotique. Profondément déstabilisants, ces personnages utilisent l’expérience de la réclusion comme un écran de fumée qui leur permet de transgresser des tabous particulièrement vifs dans cette région conservatrice et ségrégationniste. Ces figures de l’enfermement se retrouvent ainsi au beau milieu d’un entrelacs de relations. Cette analyse s’efforce de démontrer l’extrême ambiguïté d’une figure en apparence marquée par la pauvreté des relations sociales et le manque de mouvement. Circonscrite dans le Sud de Faulkner, O’Connor et Welty, la figure du reclus résonne finalement dans toute la nation américaine de ses nombreux échos intertextuels et culturels. Folklore sur les vampires dans la littérature et les arts européens entre le XVIIIe et le XXe siècle. Il s'agit d'une étude sur le folklore à propos de la figure du vampire et de sa remobilisation dans les arts et la littérature entre le XVIIIe et le XXe siècle. Une large partie du mémoire est également dédiée aux enjeux de la remobilisation des légendes populaires dans la construction des identités nationales au XIXe siècle, en particulier en Grèce et en Europe de l'Est. Les ouvrages étudiés proviennent d'Angleterre, de Roumanie, d'Allemagne, de France, de Grèce et de Russie. Nous avons également étudié des œuvres cinématographiques et picturales et introduit une analyse genrée de la figure de la femme fatale dans le romantisme. Enfin, nous abordons le mouvement primitiviste du XXe siècle tel qu'il était pensé par les artistes balkaniques et slaves.
Folklore sur les vampires dans la littérature et les arts européens entre le XVIIIe et le XXe siècle. Il s'agit d'une étude sur le folklore à propos de la figure du vampire et de sa remobilisation dans les arts et la littérature entre le XVIIIe et le XXe siècle. Une large partie du mémoire est également dédiée aux enjeux de la remobilisation des légendes populaires dans la construction des identités nationales au XIXe siècle, en particulier en Grèce et en Europe de l'Est. Les ouvrages étudiés proviennent d'Angleterre, de Roumanie, d'Allemagne, de France, de Grèce et de Russie. Nous avons également étudié des œuvres cinématographiques et picturales et introduit une analyse genrée de la figure de la femme fatale dans le romantisme. Enfin, nous abordons le mouvement primitiviste du XXe siècle tel qu'il était pensé par les artistes balkaniques et slaves. Les dépôts métalliques du BFa 3 (950-800 av. J.-C.) en Gaule atlantique. Modalités de circulation, de manipulation et d'enfouissement du métal. À la fin de l’âge du Bronze (950-800 av. J.-C.), la pratique consistant à enfouir hors de tout contexte funéraire des produits métalliques connaît un accroissement considérable en Gaule atlantique. Dans cet espace, s’étirant de la Charente aux Flandres, 255 dépôts sont signalés, livrant pas moins de 18 000 éléments métalliques. Malgré d’importantes avancées dans la compréhension de cette pratique, l’enchaînement précis des actions ayant conduit à la constitution des dépôts fait encore l’objet d’hypothèses variées et contradictoires. Les éléments qui sont le plus discutés concernent la place et le rôle de la fragmentation et des manipulations vis-à-vis des enfouissements, la réalité d’actes de sélection et d’exclusion, la durée de collecte du métal, le caractère définitif ou au contraire provisoire des dépôts, ainsi que l’intégration de cette pratique dans les systèmes économiques de la fin de l’âge du Bronze. Notre objectif a été de rassembler et d’interroger cette documentation afin de restituer les principales modalités de constitutions des dépôts du BFa 3 et de contribuer à caractériser le paysage techno-économique et culturel de la fin de l’âge du Bronze. Parmi les nombreuses questions intermédiaires que soulève ce sujet, les plus essentielles renvoient au statut du métal au moment de son enfouissement. Les restes métalliques sont-ils immobilisés pour leur valeur d’échange, d’usage ou pour leur éventuelle charge symbolique ? Ces lots sont-ils accumulés aléatoirement au gré des dynamiques de production et de circulation du métal ou bien témoignent-ils de phénomènes de sélection et de manipulation suffisamment puissants et normés pour ordonner la manière dont le métal est immobilisé ? Les différents traitements perceptibles sur les objets (fragmentation, manipulations diverses, choix des objets) interviennent-ils au moment et pour les besoins des immobilisations ou bien en sont-ils complètement déconnectés ? D’après nos observations, les dépôts du BFa 3 peuvent être considérés comme des ensembles majoritairement constitués à partir d’éléments dont l’usage a pu être prémonétaire. Cependant, le rassemblement du métal n’est pour autant pas complètement aléatoire et certaines manipulations ne renvoient pas à de simples considérations techno-économiques. Des compositions types, correspondants à des traits culturels suffisamment marqués, ont par ailleurs été identifiées. Les variations d’un espace à un autre seraient expliquées par l’enchevêtrement de plusieurs facteurs. Certains dépendent de la structure des groupes pratiquant les dépôts : la taille des communautés impliquées, leur composition sociale et les choix effectués quant à la quantité de métal immobilisée. D’autres sont le fait de la manière dont le métal circule : accès au métal, intensité des échanges et nombre d’agents économiques impliqués, existence ou non d’objets prémonétaires plus favorablement employés que d’autres. D’autres variables encore renvoient à des considérations ayant trait à l’intentionnalité des dépôts, mais aussi aux systèmes symboliques imprégnant de manière variable les différents groupes culturels de la fin de l’âge du Bronze. En cela nous pensons qu’un objet ayant perdu sa valeur d’usage peut, indépendamment de sa valeur d’échange, conserver une charge symbolique mobilisable dans le cadre des dépôts (matérialisant un individu, un groupe culturel, un statut, une idée, le cycle de vie du métal), mais aussi une valeur historique ou mémorielle, notamment quand il s’agit d’objets anciens. La concomitance d’immobilisations définitives et d’autres, provisoires, est enfin suggérée, mais devra, à l’avenir, faire l’objet d’investigations contextuelles nombreuses et précises.
Les dépôts métalliques du BFa 3 (950-800 av. J.-C.) en Gaule atlantique. Modalités de circulation, de manipulation et d'enfouissement du métal. À la fin de l’âge du Bronze (950-800 av. J.-C.), la pratique consistant à enfouir hors de tout contexte funéraire des produits métalliques connaît un accroissement considérable en Gaule atlantique. Dans cet espace, s’étirant de la Charente aux Flandres, 255 dépôts sont signalés, livrant pas moins de 18 000 éléments métalliques. Malgré d’importantes avancées dans la compréhension de cette pratique, l’enchaînement précis des actions ayant conduit à la constitution des dépôts fait encore l’objet d’hypothèses variées et contradictoires. Les éléments qui sont le plus discutés concernent la place et le rôle de la fragmentation et des manipulations vis-à-vis des enfouissements, la réalité d’actes de sélection et d’exclusion, la durée de collecte du métal, le caractère définitif ou au contraire provisoire des dépôts, ainsi que l’intégration de cette pratique dans les systèmes économiques de la fin de l’âge du Bronze. Notre objectif a été de rassembler et d’interroger cette documentation afin de restituer les principales modalités de constitutions des dépôts du BFa 3 et de contribuer à caractériser le paysage techno-économique et culturel de la fin de l’âge du Bronze. Parmi les nombreuses questions intermédiaires que soulève ce sujet, les plus essentielles renvoient au statut du métal au moment de son enfouissement. Les restes métalliques sont-ils immobilisés pour leur valeur d’échange, d’usage ou pour leur éventuelle charge symbolique ? Ces lots sont-ils accumulés aléatoirement au gré des dynamiques de production et de circulation du métal ou bien témoignent-ils de phénomènes de sélection et de manipulation suffisamment puissants et normés pour ordonner la manière dont le métal est immobilisé ? Les différents traitements perceptibles sur les objets (fragmentation, manipulations diverses, choix des objets) interviennent-ils au moment et pour les besoins des immobilisations ou bien en sont-ils complètement déconnectés ? D’après nos observations, les dépôts du BFa 3 peuvent être considérés comme des ensembles majoritairement constitués à partir d’éléments dont l’usage a pu être prémonétaire. Cependant, le rassemblement du métal n’est pour autant pas complètement aléatoire et certaines manipulations ne renvoient pas à de simples considérations techno-économiques. Des compositions types, correspondants à des traits culturels suffisamment marqués, ont par ailleurs été identifiées. Les variations d’un espace à un autre seraient expliquées par l’enchevêtrement de plusieurs facteurs. Certains dépendent de la structure des groupes pratiquant les dépôts : la taille des communautés impliquées, leur composition sociale et les choix effectués quant à la quantité de métal immobilisée. D’autres sont le fait de la manière dont le métal circule : accès au métal, intensité des échanges et nombre d’agents économiques impliqués, existence ou non d’objets prémonétaires plus favorablement employés que d’autres. D’autres variables encore renvoient à des considérations ayant trait à l’intentionnalité des dépôts, mais aussi aux systèmes symboliques imprégnant de manière variable les différents groupes culturels de la fin de l’âge du Bronze. En cela nous pensons qu’un objet ayant perdu sa valeur d’usage peut, indépendamment de sa valeur d’échange, conserver une charge symbolique mobilisable dans le cadre des dépôts (matérialisant un individu, un groupe culturel, un statut, une idée, le cycle de vie du métal), mais aussi une valeur historique ou mémorielle, notamment quand il s’agit d’objets anciens. La concomitance d’immobilisations définitives et d’autres, provisoires, est enfin suggérée, mais devra, à l’avenir, faire l’objet d’investigations contextuelles nombreuses et précises.