-
Relation entre les perceptions genrées du numérique des élèves et la réception des enseignements liés au numérique des enseignants
Ce travail de recherche a pour sujet les représentations genrées du numérique des élèves et les conséquences sur la réception des enseignements qui font intervenir du numérique (aussi en tant que contenu qu’en tant que moyen) selon que ce soit un homme ou une femme.
La première partie fait état de la recherche sur les études de genres et les relations entre genre, numérique et enseignement. Elle traite notamment de la façon dont les femmes sont invisibilisées, que ce soit dans la société, le numérique et l’école. La seconde partie est consacrée à la présentation du dispositif méthodologique et à mise en place. Le terrain est composé d’élèves de seconde d’une classe à option scientifique. La chercheuse a cherché à savoir, par le biais d’entretien semi-directifs, comment les élèves percevaient leurs compétences numériques, ainsi que celle des enseignants, décrites dans la troisième partie. La quatrième partie , la discussion met l’accent sur les thèmes suivants : une forte invisibilité des filles dans le numérique, un surinvestissement des garçons, une évaluation des compétence des enseignants par les élèves qui passe par la fluidité des gestes, et qui est traité sur le mode de la moquerie.
La chercheuse conclue par la difficulté d’évaluer la réception des enseignements liés au numérique par le genre, car ce dernier est mélangées à deux autres variables, qui sont l’âge et la discipline.
-
 L’impact du Brexit sur le parcours d’anglophones vivant en France pour l’acquisition du bilinguisme
L’impact du Brexit sur le parcours d’anglophones vivant en France pour l’acquisition du bilinguisme L’impact du Brexit sur le parcours d’anglophones vivant en France pour l’acquisition du bilinguisme.
En 2016, la population britannique a voté par référendum pour que le Royaume-Uni quitte l'Europe. Il a fallu attendre 5 ans pour que le Brexit soit pleinement mis en place et que les effets de ces changements se fassent progressivement sentir. Au cours de cette période, les citoyens britanniques vivant en France ont dû assurer leur avenir dans leur pays d'adoption, soit par l’obtention d’une carte de séjour, soit en demandant la nationalité française. Pour obtenir ces statuts, il est nécessaire de passer un test de langue prouvant leur niveau et montrant leur intégration. De nombreux immigrants britanniques semblent bien installés dans la société française, mais l'aspect linguistique semble être un obstacle pour certains. L'objectif de cette étude est de déterminer quelles sont les difficultés rencontrées par les adultes anglophones lors de l'apprentissage du français en situation immersive et quel impact le Brexit a-t-il eu sur cet apprentissage. C’est ainsi que nous avons émis la problématique suivante : Quelles influences, le Brexit peut-il avoir dans l’apprentissage du français chez les adultes anglophones, installés en France depuis au moins 5 ans ?
Pour répondre à cette question, nous avons distribué un questionnaire en ligne via les réseaux sociaux à plus de 100 personnes et nous avons également mené un entretien plus détaillé avec deux des participants. Ces personnes sont des citoyens britanniques vivant en Occitanie et pour notre recherche nous avons choisi de comparer ceux qui vivent en ville (Toulouse et ses environs) et ceux vivant à la campagne (ex. le Gers, le Tarn...) et qui sont installés en France depuis au moins cinq ans.
Les données recueillies nous ont montré qu'à l'heure actuelle, l'obligation de passer le test de langue pour stabiliser sa situation en France ne semble pas nécessaire pour nos ressortissants. La pression pour améliorer rapidement leur français afin de prouver leur intégration n’existe plus tellement pour le moment. De plus, nous pouvons constater que l'acquisition du bilinguisme est loin d'être l'objectif principal de la majorité des participants, celui-ci étant plutôt de pouvoir se débrouiller avec la langue au quotidien.
Le Brexit étant un événement historiquement récent, ces conclusions montrent qu’il faut plus de temps et plus de recul pour recueillir ce type de données. Un constat supplémentaire est que l'anglais étant une lingua franca, les anglophones qui cherchent à s'intégrer ont beau faire de nombreux efforts, cela peut parfois constituer un véritable frein dans leur apprentissage.
-
 Rôles des représentations de la grammaire dans la communication orale : le cas des adultes français apprenant l’anglais en centre de formation en langues
Rôles des représentations de la grammaire dans la communication orale : le cas des adultes français apprenant l’anglais en centre de formation en langues Force est de constater qu’en France, de nombreux adultes s’estiment incapables d’utiliser l’anglais pour communiquer, malgré plusieurs années passées à apprendre cette langue au collège, lycée ou à l’université. Plusieurs facteurs peuvent en être la cause mais celle qui nous intéresse particulièrement c’est la représentation de la grammaire. L’objectif de notre étude est de comprendre l’influence des représentations de la grammaire chez ces apprenants dans l’acte de communiquer oralement en anglais. Ainsi notre problématique de recherche est la suivante : dans quelles mesures les représentations de la grammaire chez des apprenants adultes français influencent-elles leur compétence de communication orale dans l’apprentissage de l’anglais ?
Pour tenter de répondre à cette question, nous avons mené notre étude auprès d’adultes français âgés de plus de 35 ans et inscrits dans un parcours de formation en anglais après avoir suivi des cours dans leur scolarité. Un questionnaire a été administré aux apprenants d’un centre de formation basé à Toulouse et Blagnac. Les données recueillies ont été complétées par des entretiens apprenants et des entretiens formateurs ainsi que par l’observation d’un atelier de conversation nous permettant d’observer les apprenants interrogés en situation de pratique orale de l’anglais.
Cette enquête a révélé plusieurs éléments de réponse. La première c’est que les apprenants considèrent la grammaire comme une compétence essentielle dans la maîtrise de l’anglais ou de toute langue étrangère. Des lacunes ou difficultés en grammaire sont ainsi considérées comme étant des obstacles à la prise de parole puisqu’elles vont favoriser les erreurs. Or nous avons pu voir que la peur de l’erreur est l’une des craintes dominantes qui favorise l’anxiété langagière chez ces apprenants. De même, la représentation du modèle du locuteur natif entraîne une certaine représentation de la compétence grammaticale, élevant ainsi le niveau d’exigence qui permettrait de se définir comme étant quelqu’un qui parle anglais.
Par le biais de cette étude, nous souhaitons mettre en avant l’idée de complexité dans le domaine d’apprentissage des langues, notamment lorsque nous sommes face à un public d’apprenants adultes avec des représentations, des idées reçues qui vont avoir des conséquences directes sur leur manière d’apprendre mais aussi sur leur capacité à communiquer oralement en anglais dans différents contextes.
-
 Proxémie en temps de pandémie : design sensoriel et réhumanisation
des relations dans l’espace public
Proxémie en temps de pandémie : design sensoriel et réhumanisation
des relations dans l’espace public Pour mon sujet de mémoire, j'ai décidé de travailler sur la proxémie. Ce terme consiste en l'étude de l'utilisation de l'espace par l'homme et les effets de la densité de population sur le comportement, la communication et l'interaction sociale. La proxémie a été inventée par
l'anthropologue Edward T. Hall en 1963. Cependant depuis les années 1960, la distanciation a changé de manière significative, notamment
après la pandémie de la Covid-19. Les humains ont pris peur et se sont éloignés les uns des autres. Des gestes barrières sont apparus : il a fallu respecter une distance de sécurité d'un mètre les uns des autres, parfois celle-ci pouvant s’étendre à deux mètres ; la moitié de nos
visages fut couvert par le masque, ce qui a rendu difficile la transmission des émotions, mais aussi le fait de ne plus se reconnaître dans la rue.
A mon avis, il faudrait réinventer complètement ces distances. Certaines ont augmenté et d'autres sont apparues. L'humain est habitué
à vivre en communauté et le confinement a déréglé tout cela. Certains se sont retrouvés totalement isolés chez eux, face à eux-mêmes. Nous étions comme des animaux en cage qui avaient besoin de sortir et d'interagir les uns avec les autres. Beaucoup de gens ont réalisé qu'ils ne pouvaient tout simplement pas vivre avec eux-mêmes.
Mais comment vivre avec les autres si nous ne pouvons pas vivre avec nous-mêmes ?
-
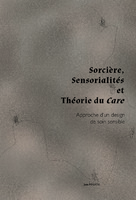 Sorcière, sensorialités, et théorie du care : pour une approche d'un design de soin sensible
Sorcière, sensorialités, et théorie du care : pour une approche d'un design de soin sensible Sorcière, sensorialité et théorie du care retrace l’histoire d’une intuition d’un lien entre designer sensoriel et sorcière pour créer une base théorique pour le design. Je questionne l’existence d’une posture de sorcière designer et sa fonction pour aller vers une autre manière de faire “l’habitabilité du monde”. Souhaitant créer ma posture de designer, la sorcière m’est apparue comme par magie.
Les sorcières ont construit un savoir médical basé sur des valeurs différentes de celles d’aujourd’hui. Cela fait d’elles des praticiennes du soin. Une approche du soin qui s’appuie sur l’ouverture sensorielle de notre corps ; la danse, le chant, les rituels sont des moyens de placer le corps au centre de la création.
Si le rôle de la sorcière est de prendre soin et celui du designer de trouver des solutions aux problèmes de la société, alors les deux font partie d’une éthique du care. Son caractère magique fait de ses actions des outils de transformation dont le designer peut s’inspirer s’il s’engage dans une démarche de care.
Elle interroge notre système de conception puisque la façon dont je pense ma relation au monde a un impact sur la façon dont je produis les choses. Ainsi, la gure de la sorcière nous suggère de faire une lecture sensible, sensorielle du monde. Une lecture qui offre la possibilité d’un autre rapport au monde pour l’accès aux soins pour tous.
Cette recherche propose de nouvelles façons de penser notre rapport au monde, nos relations sensibles et sensorielles entretenues entre notre corps et le monde.
-
 Les effets sensoriels de la couleur, design et synesthésie
Les effets sensoriels de la couleur, design et synesthésie Ce mémoire est une phase de recherche pour la conception d’un projet futur. Je cherche comment permettre aux personnes mal et ou non-voyantes, de percevoir la couleur.
Mon sujet ici, est axé sur les effets sensoriels de la couleur dans le design et la synesthésie. J’essaie de comprendre si les couleurs peuvent induire des effets sensoriels par elles-mêmes. Si notre culture et notre environnement ont un impact, ou si une forme de synesthésie influence notre perception de celles-ci.
Pour appuyer mes propos, je me réfère à des auteurs tels que Daniels Tammet, Serge Tornay et Michel Pastoureau. Des études de cas de projets de conception et d’œuvres d’art viennent étayer mes propos.
Ce travail a déjà été abordé par la science, avec la création de lunettes spéciales pour montrer « l’invisible » aux personnes aveugles. Cependant, de ce que j’en sais, ma théorie n’a encore jamais été abordée dans le domaine du design. J’ai eu l’occasion de travailler avec des personnes aveugles et des orthoptistes lors de la réalisation d’une collection de bijoux sensoriels. Aujourd’hui, je veux compléter ce projet de recherches, pour ce faire, j’utilise des méthodes de travail théoriques et expérimentales.
La synesthésie est compliquée à traduire par le design et la couleur. Cependant, les codes qu’elle induit et les imaginaires qui en découlent permettent d’en faire une transcription. Les codes visuels, textuels et colorés permettent la communication entre tous.
-
 Perception de la valeur des formations en ligne et accessibilité numérique
Perception de la valeur des formations en ligne et accessibilité numérique L’offre de formations en ligne ne cesse de proliférer. Face à la diversité de ces modalités, sur quels critères se baser dans la sélection d’une formation ? Alors qu’en France, l’idée d’éducation et de gratuité sont culturellement corrélées, quelle part occupe la gratuité dans la décision de s’engager dans une formation en ligne ?
Propulsés par les épisodes successifs de confinement, ces usages se sont également développés au sein l’apprentissage formel. La récente hybridation des parcours de formations de l’Enseignement Supérieur amène à un premier constat : bien que disponibles gratuitement à quiconque est inscrit, les premiers retours d’expériences révèlent de nombreuses disparités d’usages au sein des cohortes.
Cette étude s’intéressera dans un premier temps à l’influence que le prix peut exercer dans le processus décisionnel d’un-e apprenant-e à sélectionner une formation en ligne payante, et une autre qui ne l’est pas. Puis, elle proposera, à titre exploratoire, d’étudier plusieurs facteurs pouvant influer sur la perception de ce prix.
-
 Étude de l’effet d’environnements naturel et urbain sur l’attention dirigée et l’apprentissage
Étude de l’effet d’environnements naturel et urbain sur l’attention dirigée et l’apprentissage Plusieurs études montrent qu’une exposition à la nature, réelle ou virtuelle, a des effets bénéfiques sur les plans psychologique et physiologique. De plus, la théorie de la restauration de l’attention atteste d’un impact positif de la nature sur l’attention dirigée, un des processus nécessaires à l'apprentissage. La nature pourrait-elle donc permettre de mieux apprendre en restaurant notre capacité à focaliser notre attention de manière soutenue ? Dans cette étude, basée sur les données de 35 participants, la théorie de la restauration de l’attention et l’hypothèse selon laquelle la performance d’apprentissage est meilleure après une exposition à une nature virtuelle qu’après une exposition à une ville virtuelle, et ce dans un contexte d’apprentissage perturbé par des distracteurs, ne se vérifient pas. Néanmoins, cette dernière hypothèse se vérifie pour les personnes âgées de 40 ans et plus, la performance d’apprentissage est meilleure après une exposition à une nature virtuelle qu'après une exposition à une ville virtuelle, dans des contextes d’apprentissage totalement ou ponctuellement perturbés par des distracteurs.
-
Poïétique du design sensoriel : une pratique expérimentale, matériologique et consciencieuse
J’ai commencé mes recherches sur les biomatériaux, afin de repenser des logements autosuffisants. Cela m’a
amené à m’interroger sur le rôle joué par les designers. Quel est le rôle d’un designer sensoriel ? Aujourd’hui
les designers théorisent ce qu’ils font et abandonnent la pratique et le savoir-faire. J’aimerais poser un défi
au design sensoriel avec une méthodologie basée sur une approche environnementale et expérimentale.
Actuellement, les enjeux environnementaux dessinent notre avenir. Je pense que le design peut nous aider
à repenser notre mode de vie. Le design sensoriel devrait être au cœur du design. Cela pourrait permettre
d’amener les gens à une approche plus respectueuse de l’environnement. La pandémie de covid a bouleversé
nos vies. Nos temps de travail ont été bousculés. De ce fait, le designer, à dû concevoir, penser et créer sur une
temporalité arrêtée où la société à vécu en suspens. Ainsi, en tant que designer sensoriel, j’ai pu prendre du recul
sur ma méthode de pratique et repenser ma temporalité et ma perception de création.
Mon processus de réflexion et de pratique est basé sur le développement de la poïétique du design. Cette
poïétique relate un processus de création mêlant sensorialité et expérimentation. Grâce à une pratique des
sens, je pense que le designer peut aujourd’hui affirmer et revendiquer davantage ses valeurs au travers de ses
créations. Cette pratique peut permettre de penser un projet dans sa globalité jusqu’à l’expérience usager. Je
pense également que cette connexion des sens avec la matériologie invite à prendre conscience de ses actions
et s’épanouir pleinement dans ce domaine. Par la pratique du design sensoriel je peux créer et expérimenter en
pleine conscience dans le but de partager mes valeurs avec le monde.
-
Impact des modalités de contrôle actif/passif en contexte de réalité virtuelle sur la mémorisation
A l’heure où les mondes virtuels sont annoncés comme la technologie du futur à laquelle il faut se préparer, la formation et l’éducation connaissent un usage croissant de la réalité virtuelle immersive comme nouveau moyen d’apprentissage et d’acquisition des connaissances.
Si les résultats des usages exploratoires de situations pédagogiques, difficiles à obtenir en condition réelle, semblent accréditer la pertinence de ces technologies, le consensus n’est pas atteint dans les domaines de la pédagogie et de la psychologie cognitive sur son efficacité. Tant de paramètres entrent dans le processus d’apprentissage, tant de modalités sont constitutives de ce qu’est technologiquement la réalité virtuelle que la rencontre entre les 2 pose question.
Notre étude se concentrera sur les modalités de contrôle actif et passif dans un contexte de visite de musée virtuelle et s’attachera à mesurer l’effet de ces modalités sur la dégradation de la mémorisation. Au terme d’une expérience réalisée sur 40 personnes, nous montrerons qu’aucune des modalités utilisées ne semble avoir d’effet significatif sur la rétention d’informations.
-
 Influence des buts d’accomplissement de soi sur la recherche d’aides et des effets de celles-ci sur les performances d’apprentissage dans un EIAH
Influence des buts d’accomplissement de soi sur la recherche d’aides et des effets de celles-ci sur les performances d’apprentissage dans un EIAH Cette étude s’intéresse aux processus de demande d’aides dans un contexte EIAH. Plusieurs chercheurs ont identifié la demande d’aide comme une stratégie auto-régulation variable décisive pour améliorer la réussite dans les apprentissages et pour comprendre la différence de réussite entre les apprenants.
Des facteurs influencent le processus de recherche d’aides des apprenants en particulier la motivation et plus précisément les buts d’accomplissement de soi.
Ainsi, un état des lieux des recherches existantes, nous a permis de constater que la communauté scientifique n’est pas unanime concernant les effets de l’adoption de buts de maîtrise sur la demande d’aide et sur l’efficacité de l’aide sur l’apprentissage.
Cette expérience consistait à un apprentissage de drone virtuel sur smartphone à travers plusieurs parcours avec des obstacles et des arcs à franchir. Nous nous attendions d’une part, à ce que les apprenants qui ont un but de maitrise plus élevée que leur but de performance demandent plus d’aides que les apprenants qui ont un but de performance plus élevée que leur but de maitrise et d’autre part à ce que la performance des apprenants qui ont utilisé les aides est plus élevée que la performance des apprenants qui n’ont pas utilisé les aides. Nous n’avons pas pu valider ces questions de recherche. De surcroit notre première hypothèse opérationnelle est inversée c’est-à-dire que les apprenants qui penchent pour un but de performance demande plus d’aides que les apprenants penchant pour un but de maitrise.
Les difficultés dans l’évaluation des buts d’accomplissement, un échantillon d’apprenants relativement jeune et enfin le contexte de l’apprentissage c’est-à-dire « un jeu sur une application » ont été les principales variables parasites. Les résultats infirment ou confirment des expériences antérieures et n’apportent donc pas de plus-value concernant l’aide dans un environnement apprentissage informatisé. Cette étude a quand même le mérite de souligner la complexité du processus de recherche d’aide.
-
Étude de la conception multimédia d’un support en réalité virtuelle et plus value de la narration associée au texte sur un test de positionnement en réalité virtuelle à destination d’un public cible allant du lecteur faible au lecteur expert.
A travers mon stage dans le Laboratoire Cognition, Langues, Langage, Ergonomie (CLLE-LTC) de Toulouse, auprès de Jean-Christophe Sakdavong qui est Maître de Conférences en Informatique et Chercheur en Psychologie Cognitive au sein du Laboratoire, j’ai pu participer à la conception de 2 produits en réalité virtuelle.
N’ayant pas de connaissance particulière sur la conception multimédia d’un support en réalité virtuelle, ma démarche a été de vérifier à l’appui de lectures scientifiques si les principes de conception multimédia de Mayer étaient pertinents dans la réalité virtuelle, et spécifiquement, concernant la cible d’une des ressources, de vérifier si l’ajout de la lecture automatique de textes écrits serait une plus value.
Ce dernier point est, au premier abord, contradictoire au principe de redondance de Mayer mais il va trouver toute sa place dans le dispositif grâce aux nuances apportées par Mayer & Johnson (2008); Moreno & Mayer (2002); Le Bohec & Jamet, (2005); Makransky, Terkildsen, Mayer(2019).
-
Mission Center et Ispring : Une gamification de parcours ? La ludification d’un parcours de formation peut-elle aider l’apprenant à
mémoriser des connaissances ?
L’apprentissage à distance (e-learning), qui fait appel aux techniques de l’information et de la communication (TIC), permet de faire acquérir les compétences nécessaires aux apprenants en utilisant de nouvelles fonctionnalités comme la gamification (ou
ludification, en français). Force est de constater que l’apprentissage par le jeu constitue un élément de plus en plus important dans le monde de l’enseignement, tentant de créer un univers immersif et motivant mêlant jeu vidéo et notions théoriques de l’apprentissage scolaire. Cette évolution dans le monde de l’enseignement se voit possible grâce à l’apparition de nouveaux outils toujours plus attentifs aux besoins de l’apprenant. Malgré cela, nous pouvons nous demander si les apports théoriques ne sont pas abandonnés pour favoriser un apprentissage plus ludique qu’éducatif. Ainsi, la ludification de parcours d’enseignement peut-elle aider à la mémorisation des connaissances abordées ? Ce mémoire professionnel cherche à déterminer quels apports durables sur la mémorisation des notions un module d’apprentissage intégralement centré sur la gamification peut apporter à ses apprenants. Pour cela, il a été nécessaire de
s’interroger sur les concepts de la gamification ainsi que sur ceux de la mémorisation des apprenants pour tenter de lier ces deux notions dans le domaine de l’enseignement. Ainsi, cette analyse a permis de démontrer que l’usage de la gamification n’est pas anodin et qu’il exige une réflexion approfondie pour apporter une réelle valeur ajoutée à l’apprenant
-
Comment concevoir un jeu d’évasion en ligne afin de favoriser et encourager l’usage et la consultation de ressources pédagogiques ?
Depuis son avènement en 2004 au Japon, les jeux d’évasion se sont fortement développés et force est de constater que l’on observe, depuis quelques années, un engouement croissant pour leur utilisation dans le monde de l’enseignement. Ce dernier, en recherche constante d’activités pour susciter l’intérêt et la motivation des apprenants s’est en effet emparé du concept en y apportant une dimension éducative et pédagogique afin d’implémenter une nouvelle stratégie d’apprentissage basée sur des activités à la fois ludiques et pédagogiques. Ce mémoire s’attachera à délimiter les concepts associés aux jeux d’évasion dont les principales caractéristiques seront apportées au regard de la littérature scientifique. En s’appuyant sur cette dernière, nous détaillerons la méthode suivie et les différents outils utilisés pour concevoir la maquette d’un jeu d’évasion pédagogique en ligne dont l’objectif fixé est de favoriser et encourager l’usage et la consultation de ressources pédagogiques associées aux différents Hubs (centres de documentation) du Groupe IGS. Le parcours complet du jeu étant toujours en cours de réalisation, les phases de tests envisagés pour la validation du projet et le retour d’expérience des apprenants et des formateurs qui seront ciblés n’auront pas pu être inclus et détaillés dans ce rapport.
-
L’interactivité : une expérience augmentée ? L'interactivité mise en place dans les vidéos (ou les visites virtuelles à 360°) favorise-t-elle la performance de l'apprentissage des notions visualisées ?
Le domaine de l’ingénierie pédagogique est en constante évolution. Il a permis l'amélioration de contenus précédemment proposés par les ingénieurs pédagogiques afin de toujours répondre au mieux aux attentes des apprenants. Parmi les technologies mises en place, nous retrouvons l’interactivité des vidéos et des visites virtuelles.
Il est vrai que les outils numériques sont de plus en plus efficaces. Ils occupent un rôle de plus en plus important dans la stratégie d’enseignement des entreprises. Il peut s’agir de procurer des aides à la rétention des savoirs, un moment de réflexion pour favoriser la compréhension des notions, de guider les apprentissages…
Nous allons chercher à comprendre, à travers la rédaction de ce mémoire professionnel, ce qu’apportent les vidéos et les visites virtuelles interactives au cours de l’apprentissage de l’apprenant. Nous nous interrogerons sur les fonctions de l’interactivité ainsi que sur le rôle de la vidéo et de la visite virtuelle dans les apprentissages comme point de départ aux performances d’apprentissage de
l’apprenant. Ce travail s’appuiera sur des travaux d’experts dans le domaine. Nous détaillerons également l’utilisation de l’outil H5P qui a été utilisé pour effectuer ces travaux de réflexion. La complexité de ce travail repose sur le fait de placer de l’interactivité au moment le plus important pour apporter un apport pédagogique favorable à l’apprenant.
Enfin, notre analyse a permis de montrer que l’ajout des interactions dans les vidéos pédagogiques et les visites virtuelles a pour fonction de faire une pause dans l’apprentissage afin de prendre le temps de réfléchir, de répondre à des questions d'anticipation (que va-t-il se passer ensuite?) ou à des questions de résumé (que vient-on de voir ?) pour donner une certaine autonomie à l’apprenant. Celui-ci peut ainsi
être guidé pour être à même d’élaborer un diagnostic professionnel ou, tout simplement, pour se remémorer les étapes d’une procédure technique.
-
Les pénitents blancs de Mende, en Lozère :
comprendre leur utilité sociale, cause du sursaut de vie au XIXe
siècle, avant leur déclin début XXe siècle.
Étude sur les modalités de retour de la confrérie des pénitents blancs de Mende en Lozère au lendemain de la Révolution Française suivie de l'étude de leur déclin au cours du XXe siècle.
-
De la conception à la réalisation d’un prototype de jeu sérieux sur la plateforme Moodle
De nombreux chercheurs s'intéressent à l’impact du jeu sérieux dans les apprentissages; la plupart s’accorde à reconnaître leurs bienfaits sur la motivation et l’engagement; c’est dans cette optique qu’un prototype de jeux sérieux été réalisé pour accompagner des micro formations sur l’utilisation de Moodle auprès d’un public enseignant de l’Université; d'après les recherches sur les jeux sérieux, ce jeu devrait apporter une plus-value aux formations en les rendant les plus attractives possible en particulier pour les enseignants les plus en retrait de la transition numérique. Le jeu sérieux se passe sur la plateforme d’apprentissage Moodle. La question de départ est de savoir si Moodle possède des éléments ludiques pour faire d’un apprentissage un jeu sérieux. La conception et la réalisation d’un jeu sérieux est très complexe et chronophage ; le prototype réalisé dans le cadre de mon mémoire a été évalué par les autres membres de l’équipe spécialistes en ingénierie pédagogique. Le résultat de l’enquête est encourageant et le jeu mérite d’être mieux examiné afin de définir les travaux d’amélioration à venir ; Expérimenté par la suite, on pourra vérifier si l’impact de ce jeu sérieux sur les apprentissages confirme bien l'hypothèse sur les bienfaits des jeux sérieux.
-
Comment accompagner efficacement une période de transition digitale ?
Depuis quelques années, le domaine du digital et les outils numériques sont de plus en plus présents en entreprise. On attend donc des salariés et des différents publics confrontés à ces outils de les maîtriser puisqu’ils sont désormais inclus dans la plupart de leurs activités quotidiennes. Mais qu’en est-il de l’accompagnement proposé pour y parvenir ?
Dans ce mémoire professionnel, nous allons chercher à comprendre en quoi l’accompagnement est important en période de transition et quelles peuvent être les pistes pour gérer au mieux cette période particulière. Nous nous pencherons sur la question de l’harmonisation des ressources et dans quelle mesure cela impacte l’accompagnement des publics.
Nous alimenterons cette réflexion à l’aide de théories en ergonomie et d’apports sur la notion de transformation digitale en entreprise.
L’analyse de toutes ces pistes nous aura finalement permis de démontrer l’importance de l’accompagnement et de l’harmonisation des ressources dans une période de transition digitale.
-
 L’intégration d’activités d’expression orale en anglais sur une plateforme e-learning dans le cadre d’un apprentissage asynchrone de la langue
L’intégration d’activités d’expression orale en anglais sur une plateforme e-learning dans le cadre d’un apprentissage asynchrone de la langue L’essor des nouvelles technologies a entraîné de nouvelles pratiques en matière d’apprentissage et d’enseignement. Les dernières décennies ont vu fleurir une multitude de Edtech, ces entreprises spécialisées en innovation pédagogique. L’une d’entre elles, GlobalExam a suivi la tendance en arrivant sur le marché en 2013 avec une préparation en ligne aux tests de langues. Neuf ans plus tard, cette start-up continue de développer et de vendre ses formations linguistiques au format numérique et souhaite ajouter une nouvelle page à son catalogue : former à l’expression orale en anglais à travers sa plateforme. Un défi ambitieux au regard d’une compétence qui implique non pas une interaction numérique mais bien humaine. La modalité asynchrone des parcours dispensés par l’entreprise semble aller à l’encontre des besoins en communication qu’implique le développement de la compétence “parler”. Et pourtant, il semblerait que ce type d’apprentissage en autonomie présente plusieurs avantages à la pratique orale de la langue : un temps d’entraînement illimité, des thèmes choisis sur mesure, et surtout la capacité à s’entraîner loin des regards et des oreilles d’autrui. Si on questionne l’efficacité des activités d’expression orale en modalité asynchrone, il est clair que les compétences visées, aussi bien en termes de production que d’interaction, ne sont pas atteintes. En effet, l’apprenant a besoin de correction et d’interaction humaine pour améliorer sa compétence “parler”. Cependant, bien consciente des limites imposées par le format numérique et autonome de ses formations, l’entreprise vise davantage à entraîner, à rassurer et à motiver ses apprenants à la pratique de la langue. Aux vues des recherches scientifiques sur la prise de parole orale en langue étrangère, il semblerait que les apprenants aient davantage besoin de confiance en eux et d’assurance pour oser parler, plutôt que de réelles compétences linguistiques. Sur ces besoins là, les activités proposées prennent tout leur sens.
-
Décrire et analyser un dispositif de formation en constellation en mathématiques selon les théories de l'activité
Ce mémoire se propose de décrire un dispositif particulier de formation en constellation sur la résolution de problèmes en cycle 2 et de comprendre comment la formatrice et une enseignante engagées dans ce dispositif se le sont approprié. Deux temps particuliers de ce dispositif ont été étudiés : un premier temps où l’enseignante a mis en œuvre dans sa classe une séance de résolution de problème proposée par la formatrice, un deuxième temps qui
réunissait toutes les enseignantes engagées dans le dispositif pour analyser collectivement les séances qu’elles avaient mises en œuvre dans leur classe.
Selon le cadre des théories de l’activité, l’objectif de cette étude était d’accéder à l’activité de
la formatrice et l’activité de l’enseignante et plus précisément d’analyser les écarts entre les
tâches prescrites et les tâches effectives. Les résultats font apparaître des écarts : la formatrice
doit s’adapter pour rendre le dispositif viable, le dispositif est pour l’enseignante plus le moyen
de reprendre confiance en elle que de développer de nouveaux savoirs mathématiques.
 L’impact du Brexit sur le parcours d’anglophones vivant en France pour l’acquisition du bilinguisme L’impact du Brexit sur le parcours d’anglophones vivant en France pour l’acquisition du bilinguisme. En 2016, la population britannique a voté par référendum pour que le Royaume-Uni quitte l'Europe. Il a fallu attendre 5 ans pour que le Brexit soit pleinement mis en place et que les effets de ces changements se fassent progressivement sentir. Au cours de cette période, les citoyens britanniques vivant en France ont dû assurer leur avenir dans leur pays d'adoption, soit par l’obtention d’une carte de séjour, soit en demandant la nationalité française. Pour obtenir ces statuts, il est nécessaire de passer un test de langue prouvant leur niveau et montrant leur intégration. De nombreux immigrants britanniques semblent bien installés dans la société française, mais l'aspect linguistique semble être un obstacle pour certains. L'objectif de cette étude est de déterminer quelles sont les difficultés rencontrées par les adultes anglophones lors de l'apprentissage du français en situation immersive et quel impact le Brexit a-t-il eu sur cet apprentissage. C’est ainsi que nous avons émis la problématique suivante : Quelles influences, le Brexit peut-il avoir dans l’apprentissage du français chez les adultes anglophones, installés en France depuis au moins 5 ans ? Pour répondre à cette question, nous avons distribué un questionnaire en ligne via les réseaux sociaux à plus de 100 personnes et nous avons également mené un entretien plus détaillé avec deux des participants. Ces personnes sont des citoyens britanniques vivant en Occitanie et pour notre recherche nous avons choisi de comparer ceux qui vivent en ville (Toulouse et ses environs) et ceux vivant à la campagne (ex. le Gers, le Tarn...) et qui sont installés en France depuis au moins cinq ans. Les données recueillies nous ont montré qu'à l'heure actuelle, l'obligation de passer le test de langue pour stabiliser sa situation en France ne semble pas nécessaire pour nos ressortissants. La pression pour améliorer rapidement leur français afin de prouver leur intégration n’existe plus tellement pour le moment. De plus, nous pouvons constater que l'acquisition du bilinguisme est loin d'être l'objectif principal de la majorité des participants, celui-ci étant plutôt de pouvoir se débrouiller avec la langue au quotidien. Le Brexit étant un événement historiquement récent, ces conclusions montrent qu’il faut plus de temps et plus de recul pour recueillir ce type de données. Un constat supplémentaire est que l'anglais étant une lingua franca, les anglophones qui cherchent à s'intégrer ont beau faire de nombreux efforts, cela peut parfois constituer un véritable frein dans leur apprentissage.
L’impact du Brexit sur le parcours d’anglophones vivant en France pour l’acquisition du bilinguisme L’impact du Brexit sur le parcours d’anglophones vivant en France pour l’acquisition du bilinguisme. En 2016, la population britannique a voté par référendum pour que le Royaume-Uni quitte l'Europe. Il a fallu attendre 5 ans pour que le Brexit soit pleinement mis en place et que les effets de ces changements se fassent progressivement sentir. Au cours de cette période, les citoyens britanniques vivant en France ont dû assurer leur avenir dans leur pays d'adoption, soit par l’obtention d’une carte de séjour, soit en demandant la nationalité française. Pour obtenir ces statuts, il est nécessaire de passer un test de langue prouvant leur niveau et montrant leur intégration. De nombreux immigrants britanniques semblent bien installés dans la société française, mais l'aspect linguistique semble être un obstacle pour certains. L'objectif de cette étude est de déterminer quelles sont les difficultés rencontrées par les adultes anglophones lors de l'apprentissage du français en situation immersive et quel impact le Brexit a-t-il eu sur cet apprentissage. C’est ainsi que nous avons émis la problématique suivante : Quelles influences, le Brexit peut-il avoir dans l’apprentissage du français chez les adultes anglophones, installés en France depuis au moins 5 ans ? Pour répondre à cette question, nous avons distribué un questionnaire en ligne via les réseaux sociaux à plus de 100 personnes et nous avons également mené un entretien plus détaillé avec deux des participants. Ces personnes sont des citoyens britanniques vivant en Occitanie et pour notre recherche nous avons choisi de comparer ceux qui vivent en ville (Toulouse et ses environs) et ceux vivant à la campagne (ex. le Gers, le Tarn...) et qui sont installés en France depuis au moins cinq ans. Les données recueillies nous ont montré qu'à l'heure actuelle, l'obligation de passer le test de langue pour stabiliser sa situation en France ne semble pas nécessaire pour nos ressortissants. La pression pour améliorer rapidement leur français afin de prouver leur intégration n’existe plus tellement pour le moment. De plus, nous pouvons constater que l'acquisition du bilinguisme est loin d'être l'objectif principal de la majorité des participants, celui-ci étant plutôt de pouvoir se débrouiller avec la langue au quotidien. Le Brexit étant un événement historiquement récent, ces conclusions montrent qu’il faut plus de temps et plus de recul pour recueillir ce type de données. Un constat supplémentaire est que l'anglais étant une lingua franca, les anglophones qui cherchent à s'intégrer ont beau faire de nombreux efforts, cela peut parfois constituer un véritable frein dans leur apprentissage. Rôles des représentations de la grammaire dans la communication orale : le cas des adultes français apprenant l’anglais en centre de formation en langues Force est de constater qu’en France, de nombreux adultes s’estiment incapables d’utiliser l’anglais pour communiquer, malgré plusieurs années passées à apprendre cette langue au collège, lycée ou à l’université. Plusieurs facteurs peuvent en être la cause mais celle qui nous intéresse particulièrement c’est la représentation de la grammaire. L’objectif de notre étude est de comprendre l’influence des représentations de la grammaire chez ces apprenants dans l’acte de communiquer oralement en anglais. Ainsi notre problématique de recherche est la suivante : dans quelles mesures les représentations de la grammaire chez des apprenants adultes français influencent-elles leur compétence de communication orale dans l’apprentissage de l’anglais ? Pour tenter de répondre à cette question, nous avons mené notre étude auprès d’adultes français âgés de plus de 35 ans et inscrits dans un parcours de formation en anglais après avoir suivi des cours dans leur scolarité. Un questionnaire a été administré aux apprenants d’un centre de formation basé à Toulouse et Blagnac. Les données recueillies ont été complétées par des entretiens apprenants et des entretiens formateurs ainsi que par l’observation d’un atelier de conversation nous permettant d’observer les apprenants interrogés en situation de pratique orale de l’anglais. Cette enquête a révélé plusieurs éléments de réponse. La première c’est que les apprenants considèrent la grammaire comme une compétence essentielle dans la maîtrise de l’anglais ou de toute langue étrangère. Des lacunes ou difficultés en grammaire sont ainsi considérées comme étant des obstacles à la prise de parole puisqu’elles vont favoriser les erreurs. Or nous avons pu voir que la peur de l’erreur est l’une des craintes dominantes qui favorise l’anxiété langagière chez ces apprenants. De même, la représentation du modèle du locuteur natif entraîne une certaine représentation de la compétence grammaticale, élevant ainsi le niveau d’exigence qui permettrait de se définir comme étant quelqu’un qui parle anglais. Par le biais de cette étude, nous souhaitons mettre en avant l’idée de complexité dans le domaine d’apprentissage des langues, notamment lorsque nous sommes face à un public d’apprenants adultes avec des représentations, des idées reçues qui vont avoir des conséquences directes sur leur manière d’apprendre mais aussi sur leur capacité à communiquer oralement en anglais dans différents contextes.
Rôles des représentations de la grammaire dans la communication orale : le cas des adultes français apprenant l’anglais en centre de formation en langues Force est de constater qu’en France, de nombreux adultes s’estiment incapables d’utiliser l’anglais pour communiquer, malgré plusieurs années passées à apprendre cette langue au collège, lycée ou à l’université. Plusieurs facteurs peuvent en être la cause mais celle qui nous intéresse particulièrement c’est la représentation de la grammaire. L’objectif de notre étude est de comprendre l’influence des représentations de la grammaire chez ces apprenants dans l’acte de communiquer oralement en anglais. Ainsi notre problématique de recherche est la suivante : dans quelles mesures les représentations de la grammaire chez des apprenants adultes français influencent-elles leur compétence de communication orale dans l’apprentissage de l’anglais ? Pour tenter de répondre à cette question, nous avons mené notre étude auprès d’adultes français âgés de plus de 35 ans et inscrits dans un parcours de formation en anglais après avoir suivi des cours dans leur scolarité. Un questionnaire a été administré aux apprenants d’un centre de formation basé à Toulouse et Blagnac. Les données recueillies ont été complétées par des entretiens apprenants et des entretiens formateurs ainsi que par l’observation d’un atelier de conversation nous permettant d’observer les apprenants interrogés en situation de pratique orale de l’anglais. Cette enquête a révélé plusieurs éléments de réponse. La première c’est que les apprenants considèrent la grammaire comme une compétence essentielle dans la maîtrise de l’anglais ou de toute langue étrangère. Des lacunes ou difficultés en grammaire sont ainsi considérées comme étant des obstacles à la prise de parole puisqu’elles vont favoriser les erreurs. Or nous avons pu voir que la peur de l’erreur est l’une des craintes dominantes qui favorise l’anxiété langagière chez ces apprenants. De même, la représentation du modèle du locuteur natif entraîne une certaine représentation de la compétence grammaticale, élevant ainsi le niveau d’exigence qui permettrait de se définir comme étant quelqu’un qui parle anglais. Par le biais de cette étude, nous souhaitons mettre en avant l’idée de complexité dans le domaine d’apprentissage des langues, notamment lorsque nous sommes face à un public d’apprenants adultes avec des représentations, des idées reçues qui vont avoir des conséquences directes sur leur manière d’apprendre mais aussi sur leur capacité à communiquer oralement en anglais dans différents contextes. Proxémie en temps de pandémie : design sensoriel et réhumanisation
des relations dans l’espace public Pour mon sujet de mémoire, j'ai décidé de travailler sur la proxémie. Ce terme consiste en l'étude de l'utilisation de l'espace par l'homme et les effets de la densité de population sur le comportement, la communication et l'interaction sociale. La proxémie a été inventée par l'anthropologue Edward T. Hall en 1963. Cependant depuis les années 1960, la distanciation a changé de manière significative, notamment après la pandémie de la Covid-19. Les humains ont pris peur et se sont éloignés les uns des autres. Des gestes barrières sont apparus : il a fallu respecter une distance de sécurité d'un mètre les uns des autres, parfois celle-ci pouvant s’étendre à deux mètres ; la moitié de nos visages fut couvert par le masque, ce qui a rendu difficile la transmission des émotions, mais aussi le fait de ne plus se reconnaître dans la rue. A mon avis, il faudrait réinventer complètement ces distances. Certaines ont augmenté et d'autres sont apparues. L'humain est habitué à vivre en communauté et le confinement a déréglé tout cela. Certains se sont retrouvés totalement isolés chez eux, face à eux-mêmes. Nous étions comme des animaux en cage qui avaient besoin de sortir et d'interagir les uns avec les autres. Beaucoup de gens ont réalisé qu'ils ne pouvaient tout simplement pas vivre avec eux-mêmes. Mais comment vivre avec les autres si nous ne pouvons pas vivre avec nous-mêmes ?
Proxémie en temps de pandémie : design sensoriel et réhumanisation
des relations dans l’espace public Pour mon sujet de mémoire, j'ai décidé de travailler sur la proxémie. Ce terme consiste en l'étude de l'utilisation de l'espace par l'homme et les effets de la densité de population sur le comportement, la communication et l'interaction sociale. La proxémie a été inventée par l'anthropologue Edward T. Hall en 1963. Cependant depuis les années 1960, la distanciation a changé de manière significative, notamment après la pandémie de la Covid-19. Les humains ont pris peur et se sont éloignés les uns des autres. Des gestes barrières sont apparus : il a fallu respecter une distance de sécurité d'un mètre les uns des autres, parfois celle-ci pouvant s’étendre à deux mètres ; la moitié de nos visages fut couvert par le masque, ce qui a rendu difficile la transmission des émotions, mais aussi le fait de ne plus se reconnaître dans la rue. A mon avis, il faudrait réinventer complètement ces distances. Certaines ont augmenté et d'autres sont apparues. L'humain est habitué à vivre en communauté et le confinement a déréglé tout cela. Certains se sont retrouvés totalement isolés chez eux, face à eux-mêmes. Nous étions comme des animaux en cage qui avaient besoin de sortir et d'interagir les uns avec les autres. Beaucoup de gens ont réalisé qu'ils ne pouvaient tout simplement pas vivre avec eux-mêmes. Mais comment vivre avec les autres si nous ne pouvons pas vivre avec nous-mêmes ?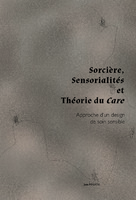 Sorcière, sensorialités, et théorie du care : pour une approche d'un design de soin sensible Sorcière, sensorialité et théorie du care retrace l’histoire d’une intuition d’un lien entre designer sensoriel et sorcière pour créer une base théorique pour le design. Je questionne l’existence d’une posture de sorcière designer et sa fonction pour aller vers une autre manière de faire “l’habitabilité du monde”. Souhaitant créer ma posture de designer, la sorcière m’est apparue comme par magie. Les sorcières ont construit un savoir médical basé sur des valeurs différentes de celles d’aujourd’hui. Cela fait d’elles des praticiennes du soin. Une approche du soin qui s’appuie sur l’ouverture sensorielle de notre corps ; la danse, le chant, les rituels sont des moyens de placer le corps au centre de la création. Si le rôle de la sorcière est de prendre soin et celui du designer de trouver des solutions aux problèmes de la société, alors les deux font partie d’une éthique du care. Son caractère magique fait de ses actions des outils de transformation dont le designer peut s’inspirer s’il s’engage dans une démarche de care. Elle interroge notre système de conception puisque la façon dont je pense ma relation au monde a un impact sur la façon dont je produis les choses. Ainsi, la gure de la sorcière nous suggère de faire une lecture sensible, sensorielle du monde. Une lecture qui offre la possibilité d’un autre rapport au monde pour l’accès aux soins pour tous. Cette recherche propose de nouvelles façons de penser notre rapport au monde, nos relations sensibles et sensorielles entretenues entre notre corps et le monde.
Sorcière, sensorialités, et théorie du care : pour une approche d'un design de soin sensible Sorcière, sensorialité et théorie du care retrace l’histoire d’une intuition d’un lien entre designer sensoriel et sorcière pour créer une base théorique pour le design. Je questionne l’existence d’une posture de sorcière designer et sa fonction pour aller vers une autre manière de faire “l’habitabilité du monde”. Souhaitant créer ma posture de designer, la sorcière m’est apparue comme par magie. Les sorcières ont construit un savoir médical basé sur des valeurs différentes de celles d’aujourd’hui. Cela fait d’elles des praticiennes du soin. Une approche du soin qui s’appuie sur l’ouverture sensorielle de notre corps ; la danse, le chant, les rituels sont des moyens de placer le corps au centre de la création. Si le rôle de la sorcière est de prendre soin et celui du designer de trouver des solutions aux problèmes de la société, alors les deux font partie d’une éthique du care. Son caractère magique fait de ses actions des outils de transformation dont le designer peut s’inspirer s’il s’engage dans une démarche de care. Elle interroge notre système de conception puisque la façon dont je pense ma relation au monde a un impact sur la façon dont je produis les choses. Ainsi, la gure de la sorcière nous suggère de faire une lecture sensible, sensorielle du monde. Une lecture qui offre la possibilité d’un autre rapport au monde pour l’accès aux soins pour tous. Cette recherche propose de nouvelles façons de penser notre rapport au monde, nos relations sensibles et sensorielles entretenues entre notre corps et le monde. Les effets sensoriels de la couleur, design et synesthésie Ce mémoire est une phase de recherche pour la conception d’un projet futur. Je cherche comment permettre aux personnes mal et ou non-voyantes, de percevoir la couleur. Mon sujet ici, est axé sur les effets sensoriels de la couleur dans le design et la synesthésie. J’essaie de comprendre si les couleurs peuvent induire des effets sensoriels par elles-mêmes. Si notre culture et notre environnement ont un impact, ou si une forme de synesthésie influence notre perception de celles-ci. Pour appuyer mes propos, je me réfère à des auteurs tels que Daniels Tammet, Serge Tornay et Michel Pastoureau. Des études de cas de projets de conception et d’œuvres d’art viennent étayer mes propos. Ce travail a déjà été abordé par la science, avec la création de lunettes spéciales pour montrer « l’invisible » aux personnes aveugles. Cependant, de ce que j’en sais, ma théorie n’a encore jamais été abordée dans le domaine du design. J’ai eu l’occasion de travailler avec des personnes aveugles et des orthoptistes lors de la réalisation d’une collection de bijoux sensoriels. Aujourd’hui, je veux compléter ce projet de recherches, pour ce faire, j’utilise des méthodes de travail théoriques et expérimentales. La synesthésie est compliquée à traduire par le design et la couleur. Cependant, les codes qu’elle induit et les imaginaires qui en découlent permettent d’en faire une transcription. Les codes visuels, textuels et colorés permettent la communication entre tous.
Les effets sensoriels de la couleur, design et synesthésie Ce mémoire est une phase de recherche pour la conception d’un projet futur. Je cherche comment permettre aux personnes mal et ou non-voyantes, de percevoir la couleur. Mon sujet ici, est axé sur les effets sensoriels de la couleur dans le design et la synesthésie. J’essaie de comprendre si les couleurs peuvent induire des effets sensoriels par elles-mêmes. Si notre culture et notre environnement ont un impact, ou si une forme de synesthésie influence notre perception de celles-ci. Pour appuyer mes propos, je me réfère à des auteurs tels que Daniels Tammet, Serge Tornay et Michel Pastoureau. Des études de cas de projets de conception et d’œuvres d’art viennent étayer mes propos. Ce travail a déjà été abordé par la science, avec la création de lunettes spéciales pour montrer « l’invisible » aux personnes aveugles. Cependant, de ce que j’en sais, ma théorie n’a encore jamais été abordée dans le domaine du design. J’ai eu l’occasion de travailler avec des personnes aveugles et des orthoptistes lors de la réalisation d’une collection de bijoux sensoriels. Aujourd’hui, je veux compléter ce projet de recherches, pour ce faire, j’utilise des méthodes de travail théoriques et expérimentales. La synesthésie est compliquée à traduire par le design et la couleur. Cependant, les codes qu’elle induit et les imaginaires qui en découlent permettent d’en faire une transcription. Les codes visuels, textuels et colorés permettent la communication entre tous. Perception de la valeur des formations en ligne et accessibilité numérique L’offre de formations en ligne ne cesse de proliférer. Face à la diversité de ces modalités, sur quels critères se baser dans la sélection d’une formation ? Alors qu’en France, l’idée d’éducation et de gratuité sont culturellement corrélées, quelle part occupe la gratuité dans la décision de s’engager dans une formation en ligne ? Propulsés par les épisodes successifs de confinement, ces usages se sont également développés au sein l’apprentissage formel. La récente hybridation des parcours de formations de l’Enseignement Supérieur amène à un premier constat : bien que disponibles gratuitement à quiconque est inscrit, les premiers retours d’expériences révèlent de nombreuses disparités d’usages au sein des cohortes. Cette étude s’intéressera dans un premier temps à l’influence que le prix peut exercer dans le processus décisionnel d’un-e apprenant-e à sélectionner une formation en ligne payante, et une autre qui ne l’est pas. Puis, elle proposera, à titre exploratoire, d’étudier plusieurs facteurs pouvant influer sur la perception de ce prix.
Perception de la valeur des formations en ligne et accessibilité numérique L’offre de formations en ligne ne cesse de proliférer. Face à la diversité de ces modalités, sur quels critères se baser dans la sélection d’une formation ? Alors qu’en France, l’idée d’éducation et de gratuité sont culturellement corrélées, quelle part occupe la gratuité dans la décision de s’engager dans une formation en ligne ? Propulsés par les épisodes successifs de confinement, ces usages se sont également développés au sein l’apprentissage formel. La récente hybridation des parcours de formations de l’Enseignement Supérieur amène à un premier constat : bien que disponibles gratuitement à quiconque est inscrit, les premiers retours d’expériences révèlent de nombreuses disparités d’usages au sein des cohortes. Cette étude s’intéressera dans un premier temps à l’influence que le prix peut exercer dans le processus décisionnel d’un-e apprenant-e à sélectionner une formation en ligne payante, et une autre qui ne l’est pas. Puis, elle proposera, à titre exploratoire, d’étudier plusieurs facteurs pouvant influer sur la perception de ce prix. Étude de l’effet d’environnements naturel et urbain sur l’attention dirigée et l’apprentissage Plusieurs études montrent qu’une exposition à la nature, réelle ou virtuelle, a des effets bénéfiques sur les plans psychologique et physiologique. De plus, la théorie de la restauration de l’attention atteste d’un impact positif de la nature sur l’attention dirigée, un des processus nécessaires à l'apprentissage. La nature pourrait-elle donc permettre de mieux apprendre en restaurant notre capacité à focaliser notre attention de manière soutenue ? Dans cette étude, basée sur les données de 35 participants, la théorie de la restauration de l’attention et l’hypothèse selon laquelle la performance d’apprentissage est meilleure après une exposition à une nature virtuelle qu’après une exposition à une ville virtuelle, et ce dans un contexte d’apprentissage perturbé par des distracteurs, ne se vérifient pas. Néanmoins, cette dernière hypothèse se vérifie pour les personnes âgées de 40 ans et plus, la performance d’apprentissage est meilleure après une exposition à une nature virtuelle qu'après une exposition à une ville virtuelle, dans des contextes d’apprentissage totalement ou ponctuellement perturbés par des distracteurs.
Étude de l’effet d’environnements naturel et urbain sur l’attention dirigée et l’apprentissage Plusieurs études montrent qu’une exposition à la nature, réelle ou virtuelle, a des effets bénéfiques sur les plans psychologique et physiologique. De plus, la théorie de la restauration de l’attention atteste d’un impact positif de la nature sur l’attention dirigée, un des processus nécessaires à l'apprentissage. La nature pourrait-elle donc permettre de mieux apprendre en restaurant notre capacité à focaliser notre attention de manière soutenue ? Dans cette étude, basée sur les données de 35 participants, la théorie de la restauration de l’attention et l’hypothèse selon laquelle la performance d’apprentissage est meilleure après une exposition à une nature virtuelle qu’après une exposition à une ville virtuelle, et ce dans un contexte d’apprentissage perturbé par des distracteurs, ne se vérifient pas. Néanmoins, cette dernière hypothèse se vérifie pour les personnes âgées de 40 ans et plus, la performance d’apprentissage est meilleure après une exposition à une nature virtuelle qu'après une exposition à une ville virtuelle, dans des contextes d’apprentissage totalement ou ponctuellement perturbés par des distracteurs. Influence des buts d’accomplissement de soi sur la recherche d’aides et des effets de celles-ci sur les performances d’apprentissage dans un EIAH Cette étude s’intéresse aux processus de demande d’aides dans un contexte EIAH. Plusieurs chercheurs ont identifié la demande d’aide comme une stratégie auto-régulation variable décisive pour améliorer la réussite dans les apprentissages et pour comprendre la différence de réussite entre les apprenants. Des facteurs influencent le processus de recherche d’aides des apprenants en particulier la motivation et plus précisément les buts d’accomplissement de soi. Ainsi, un état des lieux des recherches existantes, nous a permis de constater que la communauté scientifique n’est pas unanime concernant les effets de l’adoption de buts de maîtrise sur la demande d’aide et sur l’efficacité de l’aide sur l’apprentissage. Cette expérience consistait à un apprentissage de drone virtuel sur smartphone à travers plusieurs parcours avec des obstacles et des arcs à franchir. Nous nous attendions d’une part, à ce que les apprenants qui ont un but de maitrise plus élevée que leur but de performance demandent plus d’aides que les apprenants qui ont un but de performance plus élevée que leur but de maitrise et d’autre part à ce que la performance des apprenants qui ont utilisé les aides est plus élevée que la performance des apprenants qui n’ont pas utilisé les aides. Nous n’avons pas pu valider ces questions de recherche. De surcroit notre première hypothèse opérationnelle est inversée c’est-à-dire que les apprenants qui penchent pour un but de performance demande plus d’aides que les apprenants penchant pour un but de maitrise. Les difficultés dans l’évaluation des buts d’accomplissement, un échantillon d’apprenants relativement jeune et enfin le contexte de l’apprentissage c’est-à-dire « un jeu sur une application » ont été les principales variables parasites. Les résultats infirment ou confirment des expériences antérieures et n’apportent donc pas de plus-value concernant l’aide dans un environnement apprentissage informatisé. Cette étude a quand même le mérite de souligner la complexité du processus de recherche d’aide.
Influence des buts d’accomplissement de soi sur la recherche d’aides et des effets de celles-ci sur les performances d’apprentissage dans un EIAH Cette étude s’intéresse aux processus de demande d’aides dans un contexte EIAH. Plusieurs chercheurs ont identifié la demande d’aide comme une stratégie auto-régulation variable décisive pour améliorer la réussite dans les apprentissages et pour comprendre la différence de réussite entre les apprenants. Des facteurs influencent le processus de recherche d’aides des apprenants en particulier la motivation et plus précisément les buts d’accomplissement de soi. Ainsi, un état des lieux des recherches existantes, nous a permis de constater que la communauté scientifique n’est pas unanime concernant les effets de l’adoption de buts de maîtrise sur la demande d’aide et sur l’efficacité de l’aide sur l’apprentissage. Cette expérience consistait à un apprentissage de drone virtuel sur smartphone à travers plusieurs parcours avec des obstacles et des arcs à franchir. Nous nous attendions d’une part, à ce que les apprenants qui ont un but de maitrise plus élevée que leur but de performance demandent plus d’aides que les apprenants qui ont un but de performance plus élevée que leur but de maitrise et d’autre part à ce que la performance des apprenants qui ont utilisé les aides est plus élevée que la performance des apprenants qui n’ont pas utilisé les aides. Nous n’avons pas pu valider ces questions de recherche. De surcroit notre première hypothèse opérationnelle est inversée c’est-à-dire que les apprenants qui penchent pour un but de performance demande plus d’aides que les apprenants penchant pour un but de maitrise. Les difficultés dans l’évaluation des buts d’accomplissement, un échantillon d’apprenants relativement jeune et enfin le contexte de l’apprentissage c’est-à-dire « un jeu sur une application » ont été les principales variables parasites. Les résultats infirment ou confirment des expériences antérieures et n’apportent donc pas de plus-value concernant l’aide dans un environnement apprentissage informatisé. Cette étude a quand même le mérite de souligner la complexité du processus de recherche d’aide. L’intégration d’activités d’expression orale en anglais sur une plateforme e-learning dans le cadre d’un apprentissage asynchrone de la langue L’essor des nouvelles technologies a entraîné de nouvelles pratiques en matière d’apprentissage et d’enseignement. Les dernières décennies ont vu fleurir une multitude de Edtech, ces entreprises spécialisées en innovation pédagogique. L’une d’entre elles, GlobalExam a suivi la tendance en arrivant sur le marché en 2013 avec une préparation en ligne aux tests de langues. Neuf ans plus tard, cette start-up continue de développer et de vendre ses formations linguistiques au format numérique et souhaite ajouter une nouvelle page à son catalogue : former à l’expression orale en anglais à travers sa plateforme. Un défi ambitieux au regard d’une compétence qui implique non pas une interaction numérique mais bien humaine. La modalité asynchrone des parcours dispensés par l’entreprise semble aller à l’encontre des besoins en communication qu’implique le développement de la compétence “parler”. Et pourtant, il semblerait que ce type d’apprentissage en autonomie présente plusieurs avantages à la pratique orale de la langue : un temps d’entraînement illimité, des thèmes choisis sur mesure, et surtout la capacité à s’entraîner loin des regards et des oreilles d’autrui. Si on questionne l’efficacité des activités d’expression orale en modalité asynchrone, il est clair que les compétences visées, aussi bien en termes de production que d’interaction, ne sont pas atteintes. En effet, l’apprenant a besoin de correction et d’interaction humaine pour améliorer sa compétence “parler”. Cependant, bien consciente des limites imposées par le format numérique et autonome de ses formations, l’entreprise vise davantage à entraîner, à rassurer et à motiver ses apprenants à la pratique de la langue. Aux vues des recherches scientifiques sur la prise de parole orale en langue étrangère, il semblerait que les apprenants aient davantage besoin de confiance en eux et d’assurance pour oser parler, plutôt que de réelles compétences linguistiques. Sur ces besoins là, les activités proposées prennent tout leur sens.
L’intégration d’activités d’expression orale en anglais sur une plateforme e-learning dans le cadre d’un apprentissage asynchrone de la langue L’essor des nouvelles technologies a entraîné de nouvelles pratiques en matière d’apprentissage et d’enseignement. Les dernières décennies ont vu fleurir une multitude de Edtech, ces entreprises spécialisées en innovation pédagogique. L’une d’entre elles, GlobalExam a suivi la tendance en arrivant sur le marché en 2013 avec une préparation en ligne aux tests de langues. Neuf ans plus tard, cette start-up continue de développer et de vendre ses formations linguistiques au format numérique et souhaite ajouter une nouvelle page à son catalogue : former à l’expression orale en anglais à travers sa plateforme. Un défi ambitieux au regard d’une compétence qui implique non pas une interaction numérique mais bien humaine. La modalité asynchrone des parcours dispensés par l’entreprise semble aller à l’encontre des besoins en communication qu’implique le développement de la compétence “parler”. Et pourtant, il semblerait que ce type d’apprentissage en autonomie présente plusieurs avantages à la pratique orale de la langue : un temps d’entraînement illimité, des thèmes choisis sur mesure, et surtout la capacité à s’entraîner loin des regards et des oreilles d’autrui. Si on questionne l’efficacité des activités d’expression orale en modalité asynchrone, il est clair que les compétences visées, aussi bien en termes de production que d’interaction, ne sont pas atteintes. En effet, l’apprenant a besoin de correction et d’interaction humaine pour améliorer sa compétence “parler”. Cependant, bien consciente des limites imposées par le format numérique et autonome de ses formations, l’entreprise vise davantage à entraîner, à rassurer et à motiver ses apprenants à la pratique de la langue. Aux vues des recherches scientifiques sur la prise de parole orale en langue étrangère, il semblerait que les apprenants aient davantage besoin de confiance en eux et d’assurance pour oser parler, plutôt que de réelles compétences linguistiques. Sur ces besoins là, les activités proposées prennent tout leur sens.