-
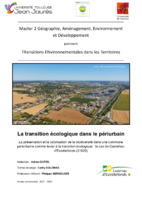 La préservation et la valorisation de la biodiversité au sein d'une commune périurbaine comme levier à la transition écologique.
La préservation et la valorisation de la biodiversité au sein d'une commune périurbaine comme levier à la transition écologique. Il ne fait aucun doute quant à la relation entre le réchauffement climatique et l'érosion de la biodiversité.
Les institutions publiques ont bien compris cette problématique et notamment les collectivités territoriales et locales périurbaines où la question environnementale est plus que pressante. C'est dans ce cadre que s'inscrit mon stage au sein de la commune de Castelnau d'Estrétefonds, commune périurbaine de la métropole toulousaine.
Durant mes 6 mois de stage, j'ai réalisé plusieurs missions relevant de la sensibilisation, de la valorisation et de la préservation de la biodiversité comme levier à la transition écologique.
-
 Discussion des approches cartographiques pour la production des cartes climatiques de l'environnement urbain à visée opérationnelle
Discussion des approches cartographiques pour la production des cartes climatiques de l'environnement urbain à visée opérationnelle Dans le contexte général d’une hausse des températures en milieu urbain, les programmes de recherche MApUCE (2014-2019) et PAENDORA (2017-2019) ont constitué une collaboration de chercheurs interdisciplinaires (climatologues, géographes, architectes, sociologues et juristes) et d’acteurs de l’urbanisme notamment la FNAU. Ce mémoire s’inscrit dans la question de recherche des cartographies climatiques pour les documents d’urbanisme en France. En effet, lors des projets cités, des travaux récents sur les phénomènes de climat urbains et leur cartographie, ont en particulier été développées sur la problématique du confort d’été, au travers des indicateurs que sont l’îlot de chaleur urbain (ICU) et l’indicateur universel de confort thermique (UTCI). Ce mémoire aborde la question spécifique de la place des cartographies du climat urbain et des données environnementales dans les documents d’urbanisme, des standards ou normes qui les régissent. La réponse apportée d’une part est celle d’un panorama permettant d’obtenir une vision synthétique de cet état de l’art cartographique. D’autre part, le mémoire aborde la question de la représentation cartographique de ces phénomènes de climat urbain, grâce à la proposition d’une méthode guidée. Cette méthode permet de rappeler les règles sémiologiques qui s’appliquent à des cartes en général et celles du climat urbain en particulier, en détaillant les données à mobiliser et les manières de les représenter, ainsi que leur composition dans des cartes aux multiples figurés surfaciques complexes à élaborer.
-
 De l'imprévisibilité à la reconversion : processus de bifurcation au travers d'un dispositif de préformation
De l'imprévisibilité à la reconversion : processus de bifurcation au travers d'un dispositif de préformation Cette recherche fait suite à des interrogations relatives à la démarche de reconversion professionnelle de personnes en situation de handicap. Il s’agit de mettre en avant le processus de bifurcation, au travers du parcours de vie de personnes en situation de handicap, ayant intégrée un dispositif de préformation. Ce travail s’inscrit donc dans une démarche abductive et a une visée compréhensive à partir de laquelle l’hypothèse suivante a été posée : l’inscription au dispositif OH constitue un élément de bifurcation dans le parcours de vie des personnes en situation de handicap. Cette bifurcation va évoluer au travers de l’expérimentation du dispositif et peut amener à la confirmation de cette dernière ou à une autre bifurcation.
Deux types de recueils de données ont été établis : l’entretien semi-directif et la schématisation du parcours, à partir d’un support créé pour cette recherche. Les résultats de cette recherche ont permis de mettre en évidence les effets du dispositif OH sur le parcours de vie des participants, mais aussi d’identifier des effets non escomptés. Ainsi des perspectives d’évolution ont pu être évoquées, notamment dans la prise en compte des spécificités des parcours des participants et dans la nécessité d’accompagner à la (re)valorisation des individus.
-
 Le développement de la sensibilisation à la valorisation et la réduction des déchets, au sein d'un territoire rural
Le développement de la sensibilisation à la valorisation et la réduction des déchets, au sein d'un territoire rural Dans une société où la quantité de déchets est toujours plus importante, des objectifs deviennent primordiaux dans la gestion de ces derniers : leur valorisation et leur réduction. Pour atteindre ces objectifs, l’aspect réglementaire et la connaissance de nombreux outils, ouvrent le champ des possibles en matière de réduction des déchets. Chaque acteur participant à la gestion des déchets a un rôle à jouer. A échelle locale, les structures compétentes en la matière, de type collectivités ou syndicats intercommunaux, se dotent bien souvent d’un service de prévention, permettant aux citoyens d’acquérir la connaissance et les solutions nécessaires pour réduire leurs déchets au sein du foyer.
Ce document présente les missions de stage réalisées au sein du service prévention et économie circulaire du Syndicat intercommunal de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés, appelé le Sictom du Sud-Gironde. Ces actions, concernant les thématiques de recyclage et de réduction des déchets, ont permis de mettre en lumière la façon dont les domaines de la sensibilisation et de l’animation à la prévention des déchets, peuvent se développer sur un territoire rural.
-
 Participation à l'inventaire des zones humides du bassin versant du Ciron et élaboration d'une stratégie en leur faveur
Participation à l'inventaire des zones humides du bassin versant du Ciron et élaboration d'une stratégie en leur faveur Les zones humides sont des milieux naturels uniques. Ces espaces de transition entre la terre et l'eau rendent de nombreux services aux sociétés et sont le support d'une biodiversité remarquable. Leur rôle dans le cycle de l'eau est primordial dans la préservation de cette ressource. Ces éléments prennent de plus en plus d'ampleur dans le contexte actuel d'érosion de la biodiversité, de réchauffement climatique, de sécheresse ou encore des méga-incendies. Les zones humides sont dans une dynamique de forte régression depuis le siècle dernier et elles sont aujourd'hui menacées par l'agriculture intensive, la foresterie et l'urbanisation ou encore la création de plans d'eau etc. Ce document présente la réalisation de l'inventaire ainsi que la réalisation d'un document cadre stratégique en faveur des zones humides mené par le Syndicat Mixte d'Aménagement du Bassin Versant du Ciron. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre d'un stage de deuxième année de master pour une durée de 6 mois. L'objectif de cette étude est de poursuivre la connaissance des zones humides du territoire par la réalisation d'un inventaire ainsi que la rédaction d'un document stratégique vis à vis des zones humides dans le cadre de la révision du SAGE Ciron en 2023.
-
 L'implication Citoyenne pour la biodiversité : Quelle stratégie adopter par le PNRSB pour impliquer et sensibiliser un spectre aussi large que possible de citoyens sur le thème de la biodiversité - sujet peu populaire et intimidant - dans des communes rurales aux migrations pendulaires fortes ?
L'implication Citoyenne pour la biodiversité : Quelle stratégie adopter par le PNRSB pour impliquer et sensibiliser un spectre aussi large que possible de citoyens sur le thème de la biodiversité - sujet peu populaire et intimidant - dans des communes rurales aux migrations pendulaires fortes ? Ce rapport de stage rend compte de mon travail effectué au sein du Parc Naturel Régional de la Sainte-Baume de mars à juillet 2022, dans le cadre des Atlas de Biodiversité Communale (ABC). Cet outil mis en place depuis 2019 dans l’enceinte du PNR atteint toutes les ambitions du Parc d’un point de vue de l’amélioration de la connaissance naturaliste, mais rencontre des difficultés concernant l’implication citoyenne et la sensibilisation du grand public. Elle est pourtant nécessaire à la préservation de la biodiversité sur le long terme. En effet, le PNR est situé en périphérie des trois grands centres urbains d’Aix, Marseille et Toulon et accueille ainsi une population consommant plus l’espace qu’elle ne l’habite étant donné l’importance de leurs mobilités pendulaires. Ajoutons à cela la méfiance qui entoure souvent les démarches participatives et structures publiques, ainsi que les doutes que ressent la population face aux sujets scientifiques, et nous comprendrons les difficultés d‘implication citoyenne dans les ABC. Ainsi, quelle stratégie adopter par le PNRSB pour impliquer et sensibiliser un spectre aussi large que possible de citoyens sur le thème de la biodiversité - sujet peu populaire et intimidant - dans des communes rurales aux migrations pendulaires fortes ?
Nous proposerons une stratégie permettant de déjouer les principales difficultés en s’axant principalement vers un meilleur ancrage dans le territoire, un lien plus fort avec les partenaires locaux ainsi qu’avec les acteurs ABC en général. Pour cela, une bonne connaissance du territoire, des références culturelles, des jeux d’acteurs est indispensable. Le deuxième point d’importance sera de se mettre à la portée de ceux à qui l’on s’adresse en adoptant un langage non spécialiste et en proposant une variété d’animations de sensibilisation afin d’atteindre une large diversité de public. L’objectif sera dans le même temps de réduire la méfiance et au contraire, valoriser la population dans ses compétences et connaissances. Enfin, la communication tant dans les échanges entre acteurs que dans la promotion de l’évènement gagnerait à être renforcée, notamment par une planification préalable et une intégration plus systématique des partenaires ABC. De même, l’écriture et le partage de retours d’expériences ainsi que la valorisation du travail ABC après la fin de la démarche permettrait de faire avancer l’engagement de nombreux acteurs en faveur de la biodiversité.
-
 Mise en place d'une stratégie foncière en faveur de la biodiversité au Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales
Mise en place d'une stratégie foncière en faveur de la biodiversité au Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales Après une présentation progressive du contexte, des grands thèmes ainsi que de l’Histoire du territoire, sera détaillé un état de l’art de quelques lectures qu’il semblait intéressant d’approfondir.
Ensuite, seront présentées les missions qui ont été les miennes pendant 6 mois.
En effet, le département des Pyrénées-Orientales s’est rendu compte qu’il avait une méconnaissance des enjeux en matière d’environnement et de biodiversité sur les parcelles qu’il possède. Or, ces dernières ont souvent pour avenir et vocation, de devenir des aménagements routiers, des bâtiments etc. En bref, c’est un patrimoine foncier qui, le plus souvent, est acheté pour être artificialisé. Ainsi, comment ne pas s’intéresser au patrimoine environnemental de ces parcelles avant de les artificialiser ? Cela pourrait permettre de les préserver et de prendre en compte la biodiversité dans un contexte de plus en plus propice au zéro artificialisation nette et à la désartificialisation.
Ce stage a donc eu pour objectif, par le biais de critères larges, de sonder chacune des 3915 parcelles possédées par le Conseil Départemental afin d’y déceler des enjeux environnementaux.
Mais comment s’arrêter là lorsque le cœur du sujet est aussi les pressions que subis la biodiversité ? Ainsi, sur chacune des parcelles, en plus des enjeux, ont été analysées les pressions, liées à l’urbanisme, à l’agriculture et au tourisme. Ce dernier a cependant été traité comme une pression « bonus », car étant difficilement quantifiable.
Tout au long du travail, méthodiquement, les parcelles ont été regroupées en entités de plusieurs parcelles, afin de faciliter leur analyse. Celles-ci ont ensuite été analysées et une fiche d’analyse ainsi qu’une carte ont chaque fois été réalisées pour les 45 entités crées.
Dans le même temps, toutes ces informations, données et analyses sont venues constituer une base de données EXCEL/attributaire qui représente toute la voûte du travail. Elle a été pensée le plus simplement possible, afin de s’adapter aux agents, même les moins à l’aise sur des logiciels d’information géographique.
Enfin, lorsque tout été généré, une priorisation et une hiérarchisation ont été mises en place cartographiquement, en regroupant tous les enjeux et toutes les pressions. La méthode devra par la suite être détaillée, approfondie et enrichie par le Département, afin d’affiner sa pertinence. Un travail de terrain sera donc nécessaire.
Ainsi, ce mémoire et la méthodologie qu’il introduit, sont une base de travail d’un projet qui je l’espère, favorisera la biodiversité et permettra de limiter les pressions. Pourquoi ne pas même envisager des complémentarités entre enjeux et pressions actuels ?
-
 La perception du paysage dans les études paysagères d'énergies renouvelables.
La perception du paysage dans les études paysagères d'énergies renouvelables. Aujourd’hui l’urgence climatique a imposé la transition énergétique dans les sociétés occidentales, l’objectif étant d’utiliser des énergies décarbonées afin d’atteindre la neutralité carbone. Les régions du nord de la France (Grand Est et Hauts-de-France) participent à la transition environnementale avec l’installation des énergies renouvelables telles que l’éolien et le photovoltaïque. Ces deux régions sont les premières en matière d’installations renouvelables sur le territoire, et continuent dans cette lancée en continuant d’implanter de nouveaux parcs. Ces infrastructures, afin d’être construites, font l’objet d’études techniques, environnementales et paysagères. Le bureau d’études ATER Environnement réalise des études paysagères qui permettent de connaître les impacts que pourrait avoir les parcs éoliens ou photovoltaïques sur le paysage. A travers l’étude et l’analyse des territoires, on peut déterminer la sensibilité d’un périmètre d’étude. Pour cela, on étudie plusieurs critères : les axes de communication, les lieux de vie, les circuits touristiques, les sites protégés, les monuments historiques et les zones UNESCO. Par la suite, une étude d’impact est réalisée par rapport à l’implantation du futur parc (éolien ou photovoltaïque) afin d’en déterminer son impact qui est caractérisé par un indice allant de nul à très fort. Une fois les études réalisées, elles sont transmises à la DREAL qui va accepter ou non l’implantation d’un nouveau parc. L’objectif des bureaux d’études est de recommander une implantation du futur parc qui s’intègre dans le paysage. Les études permettent de cadrer les implantations sur le territoire. Grâce à l’expertise des paysagistes, les énergies renouvelables se développent avec le plus de cohérence possible. Ainsi, les énergies renouvelables continuent de se développer sur le territoire français. Les régions Hauts-de-France et Grand Est, en plus du nombre important de parcs éoliens (construits, accordés et en instructions), voient le nombre de parcs photovoltaïques s’implanter avec plus d’importance qu’auparavant, et permet d’aller vers la neutralité carbone.
-
 Le tri à la source des biodéchets, pour une mobilisation citoyenne par les acteurs de la prévention et la gestion de proximité des biodéchets : cas à Toulouse Métropole.
Le tri à la source des biodéchets, pour une mobilisation citoyenne par les acteurs de la prévention et la gestion de proximité des biodéchets : cas à Toulouse Métropole. La loi Anti-gaspillage pour une économie circulaire (AGEC) oblige le tri à la source à tous les producteurs et détenteurs de biodéchets, y compris aux collectivités locales, au plus tard le 31 décembre 2023.
En vue de cette obligation, cette étude permet de comprendre comment les acteurs d’un territoire peuvent mobiliser les habitants à la gestion de proximité des biodéchets. Pour y répondre, il s’agit d’analyser dans quelles mesures le milieu professionnel peut disposer de leviers pour faciliter la transmission du message et des gestes pratiques sur la prévention des déchets. Ensuite, il est nécessaire d’étudier les dispositifs mis en place au sein d’autres métropoles pour identifier d’autres solutions. Puis cela consiste de recenser les acteurs locaux et leurs actions contribuant à la prévention et la gestion des biodéchets à Toulouse Métropole.
La prise de contact au sein des structures professionnelles s’est déroulée dans le cadre d’une expérimentation proposée par Toulouse Métropole et co-construite avec ces dernières. L’identification des dispositifs dans d’autres métropoles s’est réalisée à partir d’un questionnaire directif, de même pour l’étude des acteurs locaux du territoire avec un questionnaire semi-directif.
Les résultats montrent que l’ensemble des acteurs d’un territoire peuvent agir de manière complémentaire et mobiliser une bonne partie de la population. En effet, le milieu professionnel constitue possiblement une opportunité pour sensibiliser les habitants sur leur lieu de travail. Les métropoles accompagnent les habitants disposant d’espaces pour le compostage individuel et collectif, et travaillent majoritairement avec des partenaires pour promouvoir et accompagner les projets de compostage. Enfin, les acteurs locaux présents à Toulouse Métropole assurent un lien avec les habitants plutôt sensibilisés, déploient localement des actions et apportent chacun leur vision du compostage des biodéchets.
Ce mémoire de stage ne permet pas d’étudier l’ensemble des acteurs relais de la gestion des biodéchets. C’est pourquoi un état des lieux de l’ensemble de ces derniers permettrait d’identifier les catégories de population manquant d’informations ou de dispositifs de gestion des biodéchets.
-
 Stage Conseil des Équidés Nouvelle Aquitaine. La transition environnementale dans la filière équine : comment les outils existants et en développement sont appropriés par les différents acteurs ?
Stage Conseil des Équidés Nouvelle Aquitaine. La transition environnementale dans la filière équine : comment les outils existants et en développement sont appropriés par les différents acteurs ? La filière équine est une filière riche et comportant de nombreux acteurs, très différents les uns des autres. Eleveurs de chevaux, centre équestres, entraineurs de chevaux de courses, selliers, vétérinaires, … Ces différents acteurs sont implantés sur des territoires tout aussi différents et ont des structures et des fonctionnements multiples. Cette diversité est un enjeu majeur pour la filière, qui tente de construire des outils fédérateurs.
Ces outils commencent aujourd’hui à se mettre au service de la transition environnementale. Bien-être animal, optimisation environnementale des exploitations, gestion des prairies, valorisation du fumier, énergie cheval, tourisme vert et occupation du territoire sont les principaux points de cette transition environnementale dans la filière.
Plusieurs outils sont développés ou en développement.
Par exemple, un label de qualité, Qualit’Equidés, qui certifie les professionnels sur leurs bonnes pratiques en termes de réglementation, de bien être animal, de biosécurité et d’environnement se déploie aujourd’hui sur plusieurs régions françaises, dont Nouvelle Aquitaine.
Ces outils sont acceptés de manière très disparate. Différents facteurs entrent en ligne de compte : typologie de l’exploitation, âge et expérience du gérant, intérêt en termes de communication ou de besoins économiques, … De manière générale, on constate que l’entrée dans la transition environnementale se fait pour des raisons économiques, avant les raisons idéologiques. Elle se fait également pour des raisons de communication, de vitrine, mais peu par conscience écologique. Les exploitations « cheval » ont la « chance » de ne pas être pointées du doigt au sein du milieu agricole, et ne souffrent d’aucun scandale écologique ou environnemental. Mais cela freine quelque peu sa prise en compte de la transition environnementale. La filière n’a pas besoin de « verdir » son image, qui est déjà très verte dans l’inconscient collectif. Le plus gros du travail, auprès du grand public et surtout pour elle-même, est celle du bien être animal. Ce dernier est également diversement compris et pris en compte selon les typologies d’acteur.
On comprend alors que cette grande diversité est un frein pour la filière, mais des associations comme le Conseil des Equidés tendent à réduire les écarts entre professionnels en proposant des outils fédérateurs. L’éducation et la formation restera la clé du changement et de l’évolution.
-
 Agrivoltaïsme : Présentation d'une solution face à l'impératif de transition écologique et aux difficultés rencontrées par les agriculteurs.
Agrivoltaïsme : Présentation d'une solution face à l'impératif de transition écologique et aux difficultés rencontrées par les agriculteurs. L’agrivoltaïsme est une pratique qui consiste à réaliser un couplage entre une activité agricole et une production d’énergie. Cette filière émergente propose notamment des solutions afin de répondre à plusieurs enjeux. D’une part cela permet de répondre à la problématique du manque de ressources foncières disponibles, nécessaires pour atteindre les objectifs de la filière photovoltaïque. D’autre part, ce couplage apparaît comme une opportunité pour la filière agricole, permettant aux agriculteurs d’augmenter leur résilience face aux crises économiques, sociales, et sanitaires auxquelles ils sont confrontés. Toutefois l’agrivoltaïsme est un sujet très controversé. Cette pratique se heurte à une forte problématique d’acceptabilité sociale. Il existe à ce jour encore peu de retours d’expériences sur ce type de projet, ne permettant pas d’affirmer avec certitude son efficacité et sa pertinence. La filière est également en pleine structuration réglementaire. Le cadre légal de l’agrivoltaïsme est encore peu défini, et de nombreuses zones d’ombres persistent à ce jour, constituant une difficulté supplémentaire pour le développement de ce type de projets. Deux cas d’études de centrales agrivoltaïques sont étudiés au sein de ce rapport. Ces projets sont confrontés aux problématiques classiques des centrales agrivoltaïques, à savoir leur acceptabilité sociale, ainsi que les contraintes techniques du dimensionnement des installations. L’analyse de ces projets permet de nourrir la réflexion, concernant l’adéquation de cette pratique avec les enjeux identifiés sur les territoires dans lesquels ils s’inscrivent.
-
Sexualité et cancer de la prostate en Martinique: Des masculinités à toute épreuve
Le cancer de la prostate touche en moyenne cinq cent nouveaux hommes chaque année, en Martinique. L’incidence standardisée à l’échelle mondiale est de 164 pour 100 000 personnes-années, deux fois supérieure au taux en France (88,8). Il se classe comme le plus élevé du Monde. Cette atteinte du corps des hommes (cisgenres dans l'étude) par le cancer est une atteinte statutaire et sociale de leurs masculinités et de leur sexualité au travers des représentations stéréotypées du genre. Une double peine paradoxale leur est infligée. D'une part, une perte de la virilité associée à la perte de la rigidité du pénis et d'autre part, une injonction à la performance pénétrative du pénis malgré la maladie. Dans cette épreuve, l'intervention biomédicale sur le corps des hommes qui menacent de faiblir ou de ne pas répondre au défi sexuel traduit l'importance de la performance, voire de la performativité de la virilité. Objectif: une érection pénienne absolue réalisable à volonté et à toute épreuve.
Par conséquent dans un dispositif hégémonique érection-pénétration, comment les hommes affrontent les étapes du traitement de la maladie? Comment négocient-ils leur biographie sexuelle d'après cancer? Comment la sexualité des femmes, compagnes des hommes faisant l'expérience du cancer de la prostate, est-elle mobilisée?
Le programme d'éducation à la sexualité associé à cette étude sociologique fait le choix de se centrer sur le plaisir et l'autonomie des hommes, hors du circuit systémique et systématique érection-pénétration du pénis, d'autant plus que par défaut, ce circuit devient une source de renforcement du non-plaisir quand il est inatteignable pour les hommes faisant l'expérience du cancer de la prostate.
-
 Réactivation de la coopération transfrontalière pour la gestion
de la garonne
Réactivation de la coopération transfrontalière pour la gestion
de la garonne Le Syndicat Mixte d’Étude et d’Aménagement de la Garonne (SMEAG) en tant que porteur du schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) « Vallée de la Garonne » 2020-2030 pour le compte de la
Commission Locale de l’Eau, met en œuvre une politique pour créer des conditions de gouvernance favorables.
Sa ligne directrice est l’atteinte des objectifs environnementaux fixés par la Directive Cadre sur l’Eau (DCE).
Cette étude s’inscrit en préalable de la disposition V.6 « Créer une instance de pilotage de la Garonne
transfrontalière » du SAGE.
L’objectif de cette étude est d’identifier les freins et les opportunités à la mise en place d’une
coopération entre la France et l’Espagne pour la gestion de la Garonne. Ce mémoire de stage constitue un
diagnostic de la coopération transfrontalière partagé afin de pouvoir poser les bases d’une coopération
durable.
La zone d’étude est composée de la commission géographique « Garonne montagnarde » du SAGE
ainsi que la comarque du Val d’Aran en Espagne où la Garonne prend ses sources. Les dynamiques du territoire
de la Garonne transfrontalière sont directement liées à son environnement montagnard. Les prévisions
climatiques annoncent un milieu naturel sous pression menaçant de nombreux secteurs d’activité de la région.
Ces prévisions appellent à des changements d’usage et de gestion de la ressource dès à présent. La partie
française et espagnole de la zone d’étude possède de nombreuses caractéristiques culturelles communes en
lien avec l’histoire de la vallée. Malgré ces caractéristiques partagées, l’état de l’art de la coopération montre
que les projets communs pour la gestion intégrée de l’eau ne sont pas aussi nombreux que ceux autour
d’autres thématiques. Depuis 10 ans, les échanges et les discussions entre les gestionnaires de l’eau se sont
perdus du fait d’une carence d’animation et d’une complexité politique.
Les résultats de cette étude sont notamment fondés sur 14 entretiens semi-directifs avec les acteurs
du territoire côtés Français et Espagnol. Les opportunités à la réactivation de la coopération sont liées aux
caractéristiques communes des deux territoires, aux aides financières de l’Union Européenne ainsi qu’à une
volonté générale de retravailler ensemble. Les freins mis en lumière sont liés à un manque d’implication des
parties prenantes de la coopération et aux deux modes de gestion et d’administration véritablement
différents. Les nombreuses thématiques potentielles de travail identifiées par les acteurs du territoire
prouvent un retard dans une gestion cohérente de la Garonne autour de la frontière franco-espagnole.
L’étude suggère une première coopération sur la thématique de la sensibilisation à l’environnement
et l’eau. Aux vus des résultats, il sera nécessaire d’inscrire la coopération dans un programme de financement
Interreg type POCTEFA en prenant en compte les enjeux de gouvernance identifiés. Le futur groupe de travail
devra s’approprier les résultats de cette étude présentés le 25 août 2022 au Val d’Aran, afin de définir
ensemble un plan d’action.
-
 Évaluation d'une affiche comme nouvel outil de communication sur les risques majeurs
Évaluation d'une affiche comme nouvel outil de communication sur les risques majeurs Les risques majeurs sont des évènements brutaux et de faible occurrence ce qui tend à les occulter de la conscience collective. Pourtant, dans le contexte du changement global, ceux-ci sont voués à croitre tant en terme d’intensité que de fréquence. Face à cette menace, en France, comme à l’étranger plusieurs mesures sont mises en place pour gérer les risques. Elles sont d’ordre structurel ou non et tentent d’agir avant, durant et après la crise. Parmi ces mesures, la communication vise à éduquer, à informer et à rendre actrices les personnes lors d’évènements majeurs.
Pour y arriver, plusieurs outils existent tels que le DICRIM (Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs) qui était au centre du projet Effi-DICRIM. Au cours de ce projet, a été proposée une affiche sous forme de détachable pouvant être annexée au DICRIM ou être développée dans un format plus grand sous forme de poster.
Synthétique et facilement adaptable à l’ensemble des communes, cette dernière comporte : les systèmes d’alarmes de la commune, les consignes des comportements à tenir en cas d’évènement, la composition d’un kit d’urgence et les numéros utiles (numéros d’urgence et mairie). Elle a donc pour objectif de conférer au public une information mobilisable avant et durant la crise. Dans ce travail, nous avons proposé une démarche pour évaluer l’efficacité de cette affiche auprès du grand public. Pour y parvenir, ce travail a été mené auprès de deux communes, Auriol et le Tholonet. Pour chacune d’elles, l’affiche a été adaptée puis intégrée à un questionnaire destiné à la population. Ce premier questionnaire tente d’apporter des informations sur les connaissances des risques et de l’appréciation de l’affiche de des répondants. Un second questionnaire a ensuite été soumis aux répondants volontaires pour faire le suivi de leurs connaissances et de l’appréciation de l’affiche, permettant de surcroit, l’évaluation de l’affiche dans le temps. Au total ce sont 80 personnes issues des deux communes qui ont participé à l’enquête. Sur la base de ces réponses, l’analyse menée permet de mettre en avant des dépendances ou non entre le profil, les connaissances et l’appréciation de l’affiche. Ces éléments étant susceptibles d’influencer le transfert d’information de manière favorable ou non indiquent finalement comment atteindre le public efficacement dans la communication sur les risques.
-
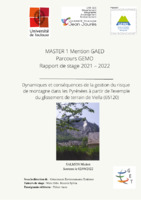 Dynamiques et conséquences de la gestion du risque de montagne dans les Pyrénées à partir de l’exemple du glissement de terrain de Viella (65120)
Dynamiques et conséquences de la gestion du risque de montagne dans les Pyrénées à partir de l’exemple du glissement de terrain de Viella (65120) Dans une petite commune des Hautes-Pyrénées, à Viella, se produit depuis plusieurs siècles un des plus importants glissements de terrain d’Europe : important du fait de sa taille et des impacts qu’il peut causer sur le village et ses habitants. En 1997, une grosse crue du Bastan déstabilise le versant et provoque un gros glissement de terrain l’année suivante. Un siècle plus tard, l’histoire se répète : la crue du Bastan en 2013 déstabilise à nouveau la montagne et réactive le glissement en 2018, mettant en
péril certaines habitations et infrastructures. Fissures sur les maisons, sur l’église et même sur les murs de cimetière, peu de bâtiments ont été épargnés. Certaines habitations, devenues trop dangereuses pour être habitées, doivent être démolies. Celles-ci commencèrent en juin 2022, provoquant de grosses conséquences psychologiques sur les sinistrés. Pas de suivi psychologique pour ces derniers, ils ne se sentent pas soutenus dans cette crise, d’autant plus qu’ils rencontrent de grosses difficultés avec les assurances qui tardent à les indemniser. De nombreuses institutions se mobilisent pour essayer de comprendre ce phénomène et tentent de le ralentir. A la suite de longues études, le service de restauration de terrain en montagne (RTM) rend son rapport : de l’eau s’infiltre et circule partout sous la montagne et sous le village, provoquant une déstabilisation du versant. Des travaux doivent être réalisés pour limiter cet écoulement souterrain et stabiliser à nouveau le
versant afin de ralentir le glissement. Ces travaux commencèrent en décembre 2021. Les habitants, soucieux et inquiets pour l’avenir de leur village, créent une association après cette nouvelle crise. Attachés à leur commune, la plupart des habitants ne peuvent se résigner à partir. Malgré tout, certains y sont contraints : la peur du danger et l’impact du glissement sur leurs habitations étant omniprésent. Malgré ce risque, pendant de longues années après le premier gros glissement, des autorisations de construire ont continué à être délivrées, même sur des zones à risques. Y a-t-il eu une négligence de la part des services de l’état sur les constructions ? Les Hommes continuent encore aujourd’hui à s’installer sur la commune. La mémoire du risque a-t-elle été mise de côté ? Y a-t-il une sous-estimation du danger ou une méconnaissance du risque ?
Ce mémoire expose les dynamiques et les conséquences de la gestion de crise en montagne, en ayant à la fois une approche sociologique et géomorphologique.
-
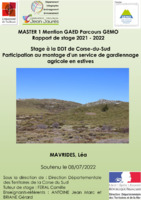 Participation au montage d’un service de gardiennage agricole en estives
Participation au montage d’un service de gardiennage agricole en estives Au cours de ce stage de Master 1, d’une durée de deux mois, réalisé à la Direction Départementale des Territoires de Corse du Sud, j’ai participé au montage d’un service de gardiennage agricole en estives. Ce projet s’expérimentera d’abord sur le
plateau du Coscione, en Corse du Sud. Au sein de la structure, ma mission principale reposait sur la rédaction d’un cahier des charges de gestion pastorale en accord avec les milieux naturels. Pour ce faire, j’ai procédé en plusieurs étapes : caractérisation des milieux, réalisation d’entretiens avec les acteurs, visites sur le terrain. Ce rapport constitue une amorce à ce projet, qui nécessite encore réflexion et maturation.
-
 Les perceptions locales de la vallée de l’Orbiel : traitement de cartes participatives
Les perceptions locales de la vallée de l’Orbiel : traitement de cartes participatives La crue d’octobre 2018 qui s’est produite dans la vallée de l’Orbiel a fait émerger des questions sur le risque environnemental et sanitaire que présente la pollution de l’ancien site minier de Salsigne. C’est dans ce contexte que les étudiants de M2 TRENT ont réalisé un diagnostic et ont organisé des ateliers de cartographies participatives avec les habitants du bassin versant de l’Orbiel. Mon stage consistait à poursuivre leur travail par le traitement et l’analyse des cartes participatives qui ont été réalisées. L’approche par la cartographie participative permet de récolter des connaissances locales et de représenter la perception qu’ont les habitants de leur territoire. Après numérisation des cartes papiers dans un logiciel SIG, les données ont été fusionnées afin de réaliser une carte synthèse présentant les perceptions de la population pour chacune des thématiques abordées. Il en résulte, une description du paysage dans sa globalité, avec ses caractéristiques géographiques propres (reliefs, vallées, régions du Minervois et du Cabardès). Par ailleurs, les cartes révèlent un territoire fractionné avec des villes isolées au Nord et des villes dynamiques au Sud, ce qui est à l’origine d’un accès aux services publics inégal. Il ressort également de mon analyse la vision d’une végétation « mosaïque » avec des espaces ouverts (vignes et garrigues) sur les plaines contrastant avec les espaces plutôt fermés (forêts) de la Montagne Noire. Par conséquent, la représentation que font les habitants de leur territoire est très vaste et diverse. Cependant peu d’habitants ont évoqué la pollution minière qui est pourtant l’enjeu majeur de vallée de l’Orbiel, laissant en suspens des questions : Sont-ils ignorants des dangers ? Ou bien ne se sentent-ils pas concernés par ce risque ? Est-ce la cause d’une désinformation ou minimisation des dangers par les élus ou par le BRGM en charge de la gestion de la sécurité de la mine ? On peut émettre l’hypothèse d’un échantillon biaisé par la présence d’acteurs décisionnaires. En effet des maires et des élus ont participé aux ateliers et on peut penser qu’ils ne souhaitent pas ternir l’image de leur territoire.
-
 Les forêts alluviales du Grésivaudan (Isère) : Problématique de gestion de l'ENS.
Les forêts alluviales du Grésivaudan (Isère) : Problématique de gestion de l'ENS. Les périodes de canicules de plus en plus marquées et, plus globalement, le réchauffement qui sévit à
l'échelle planétaire, nous font prendre conscience que les endroits pour se rafraîchir, notamment les
zones humides, se font de plus en plus rares alors qu'elles sont de plus en plus appréciées.
Se rafraichir dans un cadre naturel idyllique riche en biodiversité, c'est un des nombreux services
écologiques que nous confère la forêt alluviale du Grésivaudan dans le département de l'Isère. Longeant
le fleuve du même nom, cette forêt est dans sa quasi-totalité classée en espace naturel sensible, un
statut qui lui confère une gestion particulière.
Derrière cet endroit remarquable et comme tout autre espace naturel sensible, une autre dimension à
laquelle on ne pense pas forcément se cache : celle de la gestion de cet espace.
Ce rapport de stage se penchera justement sur cette dimension en s'intégrant au cœur de l'élaboration
d'un plan de gestion. Celle-ci nécessite autant d'analyses rigoureuses que d'interventions. Il sera vu
dans ce dossier comment effectuer des diagnostics écologiques spécifiques aux espèces envahissantes
et aux plantations de peupliers sur cette forêt, ainsi que la gestion adaptée pour chacune de ces
problématiques. Cette étude relèvera la nécessité d'une gestion évolutive en adéquation aux trajectoires
écologiques des milieux, puisqu'un milieu naturel n'est jamais fixe dans le temps, c'est une dynamique
écologique.
-
 Les informations géographiques volontaires comme un outil d'observation des pratiques de sport de nature et de la fréquentation des milieux naturels.
Les informations géographiques volontaires comme un outil d'observation des pratiques de sport de nature et de la fréquentation des milieux naturels. Le Geo web participatif est devenue virale sur l’internet, sur la base de contributions volontaires, les utilisateurs participent à la création de base de données informationnels géolocalisés, on parle d’informations géographiques volontaires. Dans le cadre des sports de nature, animées par un souffle libertaire, des plateformes collaboratives spécialisés dans les sports de nature avec une richesse de fonctionnalités et de contenus ont influencé la création de nouveaux usages et de nouveaux espaces de pratique. Les pratiquants de sport de nature, sous la forme de contributions volontaires, se retrouvent au centre d’un dispositif de partage et de création intentionnelle de contenu informationnel. L’exploitation des informations géolocalisées issues de ces plateformes de sport de nature peuvent venir combler la fracture en termes de capital informationnel associés aux pratiques et à la fréquentation des aires protégés. Elles peuvent s’ancrer dans de nouveaux dispositifs d’évaluation de la fréquentation et aider les acteurs territoriaux à orienter des stratégies pour gérer les flux de personnes et préserver les espaces sensibles.
A ce jour, très peu de travaux se sont intéressés aux informations géographiques volontaires dans les sports de nature. Il s’agira ici de démontrer le potentiel des IGV appliqué au sport de nature, en analysant les usages du numérique chez les pratiquants de sports de nature ; en valorisant la donnée issue d’une plateforme spécialisée dans les sports de montagne, camp to camp, à plusieurs échelles du territoire, celle des Alpes et celle du Parc national des Écrins.
-
 Les impacts hydromorphologiques de l'arasement du seuil de Caubous sur la Garonne amont
Les impacts hydromorphologiques de l'arasement du seuil de Caubous sur la Garonne amont Les opérations d’effacements des ouvrages transversaux sont soutenues par la DCE depuis 2000 dans l’objectif de retrouver un bon état des cours d’eau. Il est entendu par bon état les qualités chimiques et écologiques. L’hydromorphologie est perçue comme un paramètre secondaire soutenant la qualité écologique. La DCE a été transposé dans le droit français au travers de la LEMA et des Grenelles de l’environnement qui consacrent une grande importance à la continuité écologique. Celle-ci est la mesure phare pour la restauration écologique. Ces lois prônent ainsi des opérations d’effacements d’ouvrages afin que les transit sédimentaires et faunistiques soient rétablis. L’objectif de ce travail repose sur la manière dont on pourrait appréhender les impacts hydromorphologiques à partir des hauteurs d’eau sur le seuil de Caubous. Ainsi, la présente recherche propose d’abord de saisir la manière dont l’arasement des seuils altère le fonctionnement d’un hydrosystème au travers de diverses études. Puis, nous nous sommes intéressés au changement de paradigme qu’ont induite les lois pour comprendre les raisons qui ont poussé à l’arasement du seuil de Caubous. La singularité du terrain nous a conduit à étudier le secteur d’étude sur les particularités physiques et anthropiques dont il fait l’objet. Les méthodes utilisées se basent sur des hauteurs d’eau de cinq limnimètres posés sur le bief en aval de Saint-Béat et des hauteurs d’eau de la station hydrologique de Saint-Béat. Pour étudier les limnimètres entre eux, nous avons adopté une approche quantitative aux moyens de statistiques. Les résultats laissent penser que le lit à l’aval du seuil s’est exhaussé directement après l’arasement. La zone amont présente quant à elle un abaissement de la ligne d’eau deux ans après, suggérant l’apparition d’une érosion régressive. La comparaison avec la station hydrologique a confirmé que lors de ces périodes fluctuantes, les hauteurs d’eau de Saint-Béat ne régissaient pas ou que peu les variations des hauteurs d’eau des limnimètres. Par la suite, l’approche qualitative a montré une puissance spécifique importante, déterminant de la capacité de réajustement du chenal. Les berges, très anthropisées, ne suggèrent aucun ajustement latéral. Quant à la nature des matériaux, majoritairement grossiers, soutient l’érosion verticale des lits. Finalement, on montre que les hauteurs d’eau sont un bon moyen pour appréhender les mutations hydromorphologiques suite à l’arasement d’un seuil mais nécessitent tout de même d’autres approches pour compléter et affirmer les hypothèses que l’on pourrait établir.
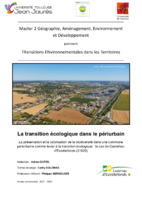 La préservation et la valorisation de la biodiversité au sein d'une commune périurbaine comme levier à la transition écologique. Il ne fait aucun doute quant à la relation entre le réchauffement climatique et l'érosion de la biodiversité. Les institutions publiques ont bien compris cette problématique et notamment les collectivités territoriales et locales périurbaines où la question environnementale est plus que pressante. C'est dans ce cadre que s'inscrit mon stage au sein de la commune de Castelnau d'Estrétefonds, commune périurbaine de la métropole toulousaine. Durant mes 6 mois de stage, j'ai réalisé plusieurs missions relevant de la sensibilisation, de la valorisation et de la préservation de la biodiversité comme levier à la transition écologique.
La préservation et la valorisation de la biodiversité au sein d'une commune périurbaine comme levier à la transition écologique. Il ne fait aucun doute quant à la relation entre le réchauffement climatique et l'érosion de la biodiversité. Les institutions publiques ont bien compris cette problématique et notamment les collectivités territoriales et locales périurbaines où la question environnementale est plus que pressante. C'est dans ce cadre que s'inscrit mon stage au sein de la commune de Castelnau d'Estrétefonds, commune périurbaine de la métropole toulousaine. Durant mes 6 mois de stage, j'ai réalisé plusieurs missions relevant de la sensibilisation, de la valorisation et de la préservation de la biodiversité comme levier à la transition écologique. Discussion des approches cartographiques pour la production des cartes climatiques de l'environnement urbain à visée opérationnelle Dans le contexte général d’une hausse des températures en milieu urbain, les programmes de recherche MApUCE (2014-2019) et PAENDORA (2017-2019) ont constitué une collaboration de chercheurs interdisciplinaires (climatologues, géographes, architectes, sociologues et juristes) et d’acteurs de l’urbanisme notamment la FNAU. Ce mémoire s’inscrit dans la question de recherche des cartographies climatiques pour les documents d’urbanisme en France. En effet, lors des projets cités, des travaux récents sur les phénomènes de climat urbains et leur cartographie, ont en particulier été développées sur la problématique du confort d’été, au travers des indicateurs que sont l’îlot de chaleur urbain (ICU) et l’indicateur universel de confort thermique (UTCI). Ce mémoire aborde la question spécifique de la place des cartographies du climat urbain et des données environnementales dans les documents d’urbanisme, des standards ou normes qui les régissent. La réponse apportée d’une part est celle d’un panorama permettant d’obtenir une vision synthétique de cet état de l’art cartographique. D’autre part, le mémoire aborde la question de la représentation cartographique de ces phénomènes de climat urbain, grâce à la proposition d’une méthode guidée. Cette méthode permet de rappeler les règles sémiologiques qui s’appliquent à des cartes en général et celles du climat urbain en particulier, en détaillant les données à mobiliser et les manières de les représenter, ainsi que leur composition dans des cartes aux multiples figurés surfaciques complexes à élaborer.
Discussion des approches cartographiques pour la production des cartes climatiques de l'environnement urbain à visée opérationnelle Dans le contexte général d’une hausse des températures en milieu urbain, les programmes de recherche MApUCE (2014-2019) et PAENDORA (2017-2019) ont constitué une collaboration de chercheurs interdisciplinaires (climatologues, géographes, architectes, sociologues et juristes) et d’acteurs de l’urbanisme notamment la FNAU. Ce mémoire s’inscrit dans la question de recherche des cartographies climatiques pour les documents d’urbanisme en France. En effet, lors des projets cités, des travaux récents sur les phénomènes de climat urbains et leur cartographie, ont en particulier été développées sur la problématique du confort d’été, au travers des indicateurs que sont l’îlot de chaleur urbain (ICU) et l’indicateur universel de confort thermique (UTCI). Ce mémoire aborde la question spécifique de la place des cartographies du climat urbain et des données environnementales dans les documents d’urbanisme, des standards ou normes qui les régissent. La réponse apportée d’une part est celle d’un panorama permettant d’obtenir une vision synthétique de cet état de l’art cartographique. D’autre part, le mémoire aborde la question de la représentation cartographique de ces phénomènes de climat urbain, grâce à la proposition d’une méthode guidée. Cette méthode permet de rappeler les règles sémiologiques qui s’appliquent à des cartes en général et celles du climat urbain en particulier, en détaillant les données à mobiliser et les manières de les représenter, ainsi que leur composition dans des cartes aux multiples figurés surfaciques complexes à élaborer. De l'imprévisibilité à la reconversion : processus de bifurcation au travers d'un dispositif de préformation Cette recherche fait suite à des interrogations relatives à la démarche de reconversion professionnelle de personnes en situation de handicap. Il s’agit de mettre en avant le processus de bifurcation, au travers du parcours de vie de personnes en situation de handicap, ayant intégrée un dispositif de préformation. Ce travail s’inscrit donc dans une démarche abductive et a une visée compréhensive à partir de laquelle l’hypothèse suivante a été posée : l’inscription au dispositif OH constitue un élément de bifurcation dans le parcours de vie des personnes en situation de handicap. Cette bifurcation va évoluer au travers de l’expérimentation du dispositif et peut amener à la confirmation de cette dernière ou à une autre bifurcation. Deux types de recueils de données ont été établis : l’entretien semi-directif et la schématisation du parcours, à partir d’un support créé pour cette recherche. Les résultats de cette recherche ont permis de mettre en évidence les effets du dispositif OH sur le parcours de vie des participants, mais aussi d’identifier des effets non escomptés. Ainsi des perspectives d’évolution ont pu être évoquées, notamment dans la prise en compte des spécificités des parcours des participants et dans la nécessité d’accompagner à la (re)valorisation des individus.
De l'imprévisibilité à la reconversion : processus de bifurcation au travers d'un dispositif de préformation Cette recherche fait suite à des interrogations relatives à la démarche de reconversion professionnelle de personnes en situation de handicap. Il s’agit de mettre en avant le processus de bifurcation, au travers du parcours de vie de personnes en situation de handicap, ayant intégrée un dispositif de préformation. Ce travail s’inscrit donc dans une démarche abductive et a une visée compréhensive à partir de laquelle l’hypothèse suivante a été posée : l’inscription au dispositif OH constitue un élément de bifurcation dans le parcours de vie des personnes en situation de handicap. Cette bifurcation va évoluer au travers de l’expérimentation du dispositif et peut amener à la confirmation de cette dernière ou à une autre bifurcation. Deux types de recueils de données ont été établis : l’entretien semi-directif et la schématisation du parcours, à partir d’un support créé pour cette recherche. Les résultats de cette recherche ont permis de mettre en évidence les effets du dispositif OH sur le parcours de vie des participants, mais aussi d’identifier des effets non escomptés. Ainsi des perspectives d’évolution ont pu être évoquées, notamment dans la prise en compte des spécificités des parcours des participants et dans la nécessité d’accompagner à la (re)valorisation des individus. Le développement de la sensibilisation à la valorisation et la réduction des déchets, au sein d'un territoire rural Dans une société où la quantité de déchets est toujours plus importante, des objectifs deviennent primordiaux dans la gestion de ces derniers : leur valorisation et leur réduction. Pour atteindre ces objectifs, l’aspect réglementaire et la connaissance de nombreux outils, ouvrent le champ des possibles en matière de réduction des déchets. Chaque acteur participant à la gestion des déchets a un rôle à jouer. A échelle locale, les structures compétentes en la matière, de type collectivités ou syndicats intercommunaux, se dotent bien souvent d’un service de prévention, permettant aux citoyens d’acquérir la connaissance et les solutions nécessaires pour réduire leurs déchets au sein du foyer. Ce document présente les missions de stage réalisées au sein du service prévention et économie circulaire du Syndicat intercommunal de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés, appelé le Sictom du Sud-Gironde. Ces actions, concernant les thématiques de recyclage et de réduction des déchets, ont permis de mettre en lumière la façon dont les domaines de la sensibilisation et de l’animation à la prévention des déchets, peuvent se développer sur un territoire rural.
Le développement de la sensibilisation à la valorisation et la réduction des déchets, au sein d'un territoire rural Dans une société où la quantité de déchets est toujours plus importante, des objectifs deviennent primordiaux dans la gestion de ces derniers : leur valorisation et leur réduction. Pour atteindre ces objectifs, l’aspect réglementaire et la connaissance de nombreux outils, ouvrent le champ des possibles en matière de réduction des déchets. Chaque acteur participant à la gestion des déchets a un rôle à jouer. A échelle locale, les structures compétentes en la matière, de type collectivités ou syndicats intercommunaux, se dotent bien souvent d’un service de prévention, permettant aux citoyens d’acquérir la connaissance et les solutions nécessaires pour réduire leurs déchets au sein du foyer. Ce document présente les missions de stage réalisées au sein du service prévention et économie circulaire du Syndicat intercommunal de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés, appelé le Sictom du Sud-Gironde. Ces actions, concernant les thématiques de recyclage et de réduction des déchets, ont permis de mettre en lumière la façon dont les domaines de la sensibilisation et de l’animation à la prévention des déchets, peuvent se développer sur un territoire rural. Participation à l'inventaire des zones humides du bassin versant du Ciron et élaboration d'une stratégie en leur faveur Les zones humides sont des milieux naturels uniques. Ces espaces de transition entre la terre et l'eau rendent de nombreux services aux sociétés et sont le support d'une biodiversité remarquable. Leur rôle dans le cycle de l'eau est primordial dans la préservation de cette ressource. Ces éléments prennent de plus en plus d'ampleur dans le contexte actuel d'érosion de la biodiversité, de réchauffement climatique, de sécheresse ou encore des méga-incendies. Les zones humides sont dans une dynamique de forte régression depuis le siècle dernier et elles sont aujourd'hui menacées par l'agriculture intensive, la foresterie et l'urbanisation ou encore la création de plans d'eau etc. Ce document présente la réalisation de l'inventaire ainsi que la réalisation d'un document cadre stratégique en faveur des zones humides mené par le Syndicat Mixte d'Aménagement du Bassin Versant du Ciron. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre d'un stage de deuxième année de master pour une durée de 6 mois. L'objectif de cette étude est de poursuivre la connaissance des zones humides du territoire par la réalisation d'un inventaire ainsi que la rédaction d'un document stratégique vis à vis des zones humides dans le cadre de la révision du SAGE Ciron en 2023.
Participation à l'inventaire des zones humides du bassin versant du Ciron et élaboration d'une stratégie en leur faveur Les zones humides sont des milieux naturels uniques. Ces espaces de transition entre la terre et l'eau rendent de nombreux services aux sociétés et sont le support d'une biodiversité remarquable. Leur rôle dans le cycle de l'eau est primordial dans la préservation de cette ressource. Ces éléments prennent de plus en plus d'ampleur dans le contexte actuel d'érosion de la biodiversité, de réchauffement climatique, de sécheresse ou encore des méga-incendies. Les zones humides sont dans une dynamique de forte régression depuis le siècle dernier et elles sont aujourd'hui menacées par l'agriculture intensive, la foresterie et l'urbanisation ou encore la création de plans d'eau etc. Ce document présente la réalisation de l'inventaire ainsi que la réalisation d'un document cadre stratégique en faveur des zones humides mené par le Syndicat Mixte d'Aménagement du Bassin Versant du Ciron. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre d'un stage de deuxième année de master pour une durée de 6 mois. L'objectif de cette étude est de poursuivre la connaissance des zones humides du territoire par la réalisation d'un inventaire ainsi que la rédaction d'un document stratégique vis à vis des zones humides dans le cadre de la révision du SAGE Ciron en 2023. L'implication Citoyenne pour la biodiversité : Quelle stratégie adopter par le PNRSB pour impliquer et sensibiliser un spectre aussi large que possible de citoyens sur le thème de la biodiversité - sujet peu populaire et intimidant - dans des communes rurales aux migrations pendulaires fortes ? Ce rapport de stage rend compte de mon travail effectué au sein du Parc Naturel Régional de la Sainte-Baume de mars à juillet 2022, dans le cadre des Atlas de Biodiversité Communale (ABC). Cet outil mis en place depuis 2019 dans l’enceinte du PNR atteint toutes les ambitions du Parc d’un point de vue de l’amélioration de la connaissance naturaliste, mais rencontre des difficultés concernant l’implication citoyenne et la sensibilisation du grand public. Elle est pourtant nécessaire à la préservation de la biodiversité sur le long terme. En effet, le PNR est situé en périphérie des trois grands centres urbains d’Aix, Marseille et Toulon et accueille ainsi une population consommant plus l’espace qu’elle ne l’habite étant donné l’importance de leurs mobilités pendulaires. Ajoutons à cela la méfiance qui entoure souvent les démarches participatives et structures publiques, ainsi que les doutes que ressent la population face aux sujets scientifiques, et nous comprendrons les difficultés d‘implication citoyenne dans les ABC. Ainsi, quelle stratégie adopter par le PNRSB pour impliquer et sensibiliser un spectre aussi large que possible de citoyens sur le thème de la biodiversité - sujet peu populaire et intimidant - dans des communes rurales aux migrations pendulaires fortes ? Nous proposerons une stratégie permettant de déjouer les principales difficultés en s’axant principalement vers un meilleur ancrage dans le territoire, un lien plus fort avec les partenaires locaux ainsi qu’avec les acteurs ABC en général. Pour cela, une bonne connaissance du territoire, des références culturelles, des jeux d’acteurs est indispensable. Le deuxième point d’importance sera de se mettre à la portée de ceux à qui l’on s’adresse en adoptant un langage non spécialiste et en proposant une variété d’animations de sensibilisation afin d’atteindre une large diversité de public. L’objectif sera dans le même temps de réduire la méfiance et au contraire, valoriser la population dans ses compétences et connaissances. Enfin, la communication tant dans les échanges entre acteurs que dans la promotion de l’évènement gagnerait à être renforcée, notamment par une planification préalable et une intégration plus systématique des partenaires ABC. De même, l’écriture et le partage de retours d’expériences ainsi que la valorisation du travail ABC après la fin de la démarche permettrait de faire avancer l’engagement de nombreux acteurs en faveur de la biodiversité.
L'implication Citoyenne pour la biodiversité : Quelle stratégie adopter par le PNRSB pour impliquer et sensibiliser un spectre aussi large que possible de citoyens sur le thème de la biodiversité - sujet peu populaire et intimidant - dans des communes rurales aux migrations pendulaires fortes ? Ce rapport de stage rend compte de mon travail effectué au sein du Parc Naturel Régional de la Sainte-Baume de mars à juillet 2022, dans le cadre des Atlas de Biodiversité Communale (ABC). Cet outil mis en place depuis 2019 dans l’enceinte du PNR atteint toutes les ambitions du Parc d’un point de vue de l’amélioration de la connaissance naturaliste, mais rencontre des difficultés concernant l’implication citoyenne et la sensibilisation du grand public. Elle est pourtant nécessaire à la préservation de la biodiversité sur le long terme. En effet, le PNR est situé en périphérie des trois grands centres urbains d’Aix, Marseille et Toulon et accueille ainsi une population consommant plus l’espace qu’elle ne l’habite étant donné l’importance de leurs mobilités pendulaires. Ajoutons à cela la méfiance qui entoure souvent les démarches participatives et structures publiques, ainsi que les doutes que ressent la population face aux sujets scientifiques, et nous comprendrons les difficultés d‘implication citoyenne dans les ABC. Ainsi, quelle stratégie adopter par le PNRSB pour impliquer et sensibiliser un spectre aussi large que possible de citoyens sur le thème de la biodiversité - sujet peu populaire et intimidant - dans des communes rurales aux migrations pendulaires fortes ? Nous proposerons une stratégie permettant de déjouer les principales difficultés en s’axant principalement vers un meilleur ancrage dans le territoire, un lien plus fort avec les partenaires locaux ainsi qu’avec les acteurs ABC en général. Pour cela, une bonne connaissance du territoire, des références culturelles, des jeux d’acteurs est indispensable. Le deuxième point d’importance sera de se mettre à la portée de ceux à qui l’on s’adresse en adoptant un langage non spécialiste et en proposant une variété d’animations de sensibilisation afin d’atteindre une large diversité de public. L’objectif sera dans le même temps de réduire la méfiance et au contraire, valoriser la population dans ses compétences et connaissances. Enfin, la communication tant dans les échanges entre acteurs que dans la promotion de l’évènement gagnerait à être renforcée, notamment par une planification préalable et une intégration plus systématique des partenaires ABC. De même, l’écriture et le partage de retours d’expériences ainsi que la valorisation du travail ABC après la fin de la démarche permettrait de faire avancer l’engagement de nombreux acteurs en faveur de la biodiversité. Mise en place d'une stratégie foncière en faveur de la biodiversité au Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales Après une présentation progressive du contexte, des grands thèmes ainsi que de l’Histoire du territoire, sera détaillé un état de l’art de quelques lectures qu’il semblait intéressant d’approfondir. Ensuite, seront présentées les missions qui ont été les miennes pendant 6 mois. En effet, le département des Pyrénées-Orientales s’est rendu compte qu’il avait une méconnaissance des enjeux en matière d’environnement et de biodiversité sur les parcelles qu’il possède. Or, ces dernières ont souvent pour avenir et vocation, de devenir des aménagements routiers, des bâtiments etc. En bref, c’est un patrimoine foncier qui, le plus souvent, est acheté pour être artificialisé. Ainsi, comment ne pas s’intéresser au patrimoine environnemental de ces parcelles avant de les artificialiser ? Cela pourrait permettre de les préserver et de prendre en compte la biodiversité dans un contexte de plus en plus propice au zéro artificialisation nette et à la désartificialisation. Ce stage a donc eu pour objectif, par le biais de critères larges, de sonder chacune des 3915 parcelles possédées par le Conseil Départemental afin d’y déceler des enjeux environnementaux. Mais comment s’arrêter là lorsque le cœur du sujet est aussi les pressions que subis la biodiversité ? Ainsi, sur chacune des parcelles, en plus des enjeux, ont été analysées les pressions, liées à l’urbanisme, à l’agriculture et au tourisme. Ce dernier a cependant été traité comme une pression « bonus », car étant difficilement quantifiable. Tout au long du travail, méthodiquement, les parcelles ont été regroupées en entités de plusieurs parcelles, afin de faciliter leur analyse. Celles-ci ont ensuite été analysées et une fiche d’analyse ainsi qu’une carte ont chaque fois été réalisées pour les 45 entités crées. Dans le même temps, toutes ces informations, données et analyses sont venues constituer une base de données EXCEL/attributaire qui représente toute la voûte du travail. Elle a été pensée le plus simplement possible, afin de s’adapter aux agents, même les moins à l’aise sur des logiciels d’information géographique. Enfin, lorsque tout été généré, une priorisation et une hiérarchisation ont été mises en place cartographiquement, en regroupant tous les enjeux et toutes les pressions. La méthode devra par la suite être détaillée, approfondie et enrichie par le Département, afin d’affiner sa pertinence. Un travail de terrain sera donc nécessaire. Ainsi, ce mémoire et la méthodologie qu’il introduit, sont une base de travail d’un projet qui je l’espère, favorisera la biodiversité et permettra de limiter les pressions. Pourquoi ne pas même envisager des complémentarités entre enjeux et pressions actuels ?
Mise en place d'une stratégie foncière en faveur de la biodiversité au Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales Après une présentation progressive du contexte, des grands thèmes ainsi que de l’Histoire du territoire, sera détaillé un état de l’art de quelques lectures qu’il semblait intéressant d’approfondir. Ensuite, seront présentées les missions qui ont été les miennes pendant 6 mois. En effet, le département des Pyrénées-Orientales s’est rendu compte qu’il avait une méconnaissance des enjeux en matière d’environnement et de biodiversité sur les parcelles qu’il possède. Or, ces dernières ont souvent pour avenir et vocation, de devenir des aménagements routiers, des bâtiments etc. En bref, c’est un patrimoine foncier qui, le plus souvent, est acheté pour être artificialisé. Ainsi, comment ne pas s’intéresser au patrimoine environnemental de ces parcelles avant de les artificialiser ? Cela pourrait permettre de les préserver et de prendre en compte la biodiversité dans un contexte de plus en plus propice au zéro artificialisation nette et à la désartificialisation. Ce stage a donc eu pour objectif, par le biais de critères larges, de sonder chacune des 3915 parcelles possédées par le Conseil Départemental afin d’y déceler des enjeux environnementaux. Mais comment s’arrêter là lorsque le cœur du sujet est aussi les pressions que subis la biodiversité ? Ainsi, sur chacune des parcelles, en plus des enjeux, ont été analysées les pressions, liées à l’urbanisme, à l’agriculture et au tourisme. Ce dernier a cependant été traité comme une pression « bonus », car étant difficilement quantifiable. Tout au long du travail, méthodiquement, les parcelles ont été regroupées en entités de plusieurs parcelles, afin de faciliter leur analyse. Celles-ci ont ensuite été analysées et une fiche d’analyse ainsi qu’une carte ont chaque fois été réalisées pour les 45 entités crées. Dans le même temps, toutes ces informations, données et analyses sont venues constituer une base de données EXCEL/attributaire qui représente toute la voûte du travail. Elle a été pensée le plus simplement possible, afin de s’adapter aux agents, même les moins à l’aise sur des logiciels d’information géographique. Enfin, lorsque tout été généré, une priorisation et une hiérarchisation ont été mises en place cartographiquement, en regroupant tous les enjeux et toutes les pressions. La méthode devra par la suite être détaillée, approfondie et enrichie par le Département, afin d’affiner sa pertinence. Un travail de terrain sera donc nécessaire. Ainsi, ce mémoire et la méthodologie qu’il introduit, sont une base de travail d’un projet qui je l’espère, favorisera la biodiversité et permettra de limiter les pressions. Pourquoi ne pas même envisager des complémentarités entre enjeux et pressions actuels ? La perception du paysage dans les études paysagères d'énergies renouvelables. Aujourd’hui l’urgence climatique a imposé la transition énergétique dans les sociétés occidentales, l’objectif étant d’utiliser des énergies décarbonées afin d’atteindre la neutralité carbone. Les régions du nord de la France (Grand Est et Hauts-de-France) participent à la transition environnementale avec l’installation des énergies renouvelables telles que l’éolien et le photovoltaïque. Ces deux régions sont les premières en matière d’installations renouvelables sur le territoire, et continuent dans cette lancée en continuant d’implanter de nouveaux parcs. Ces infrastructures, afin d’être construites, font l’objet d’études techniques, environnementales et paysagères. Le bureau d’études ATER Environnement réalise des études paysagères qui permettent de connaître les impacts que pourrait avoir les parcs éoliens ou photovoltaïques sur le paysage. A travers l’étude et l’analyse des territoires, on peut déterminer la sensibilité d’un périmètre d’étude. Pour cela, on étudie plusieurs critères : les axes de communication, les lieux de vie, les circuits touristiques, les sites protégés, les monuments historiques et les zones UNESCO. Par la suite, une étude d’impact est réalisée par rapport à l’implantation du futur parc (éolien ou photovoltaïque) afin d’en déterminer son impact qui est caractérisé par un indice allant de nul à très fort. Une fois les études réalisées, elles sont transmises à la DREAL qui va accepter ou non l’implantation d’un nouveau parc. L’objectif des bureaux d’études est de recommander une implantation du futur parc qui s’intègre dans le paysage. Les études permettent de cadrer les implantations sur le territoire. Grâce à l’expertise des paysagistes, les énergies renouvelables se développent avec le plus de cohérence possible. Ainsi, les énergies renouvelables continuent de se développer sur le territoire français. Les régions Hauts-de-France et Grand Est, en plus du nombre important de parcs éoliens (construits, accordés et en instructions), voient le nombre de parcs photovoltaïques s’implanter avec plus d’importance qu’auparavant, et permet d’aller vers la neutralité carbone.
La perception du paysage dans les études paysagères d'énergies renouvelables. Aujourd’hui l’urgence climatique a imposé la transition énergétique dans les sociétés occidentales, l’objectif étant d’utiliser des énergies décarbonées afin d’atteindre la neutralité carbone. Les régions du nord de la France (Grand Est et Hauts-de-France) participent à la transition environnementale avec l’installation des énergies renouvelables telles que l’éolien et le photovoltaïque. Ces deux régions sont les premières en matière d’installations renouvelables sur le territoire, et continuent dans cette lancée en continuant d’implanter de nouveaux parcs. Ces infrastructures, afin d’être construites, font l’objet d’études techniques, environnementales et paysagères. Le bureau d’études ATER Environnement réalise des études paysagères qui permettent de connaître les impacts que pourrait avoir les parcs éoliens ou photovoltaïques sur le paysage. A travers l’étude et l’analyse des territoires, on peut déterminer la sensibilité d’un périmètre d’étude. Pour cela, on étudie plusieurs critères : les axes de communication, les lieux de vie, les circuits touristiques, les sites protégés, les monuments historiques et les zones UNESCO. Par la suite, une étude d’impact est réalisée par rapport à l’implantation du futur parc (éolien ou photovoltaïque) afin d’en déterminer son impact qui est caractérisé par un indice allant de nul à très fort. Une fois les études réalisées, elles sont transmises à la DREAL qui va accepter ou non l’implantation d’un nouveau parc. L’objectif des bureaux d’études est de recommander une implantation du futur parc qui s’intègre dans le paysage. Les études permettent de cadrer les implantations sur le territoire. Grâce à l’expertise des paysagistes, les énergies renouvelables se développent avec le plus de cohérence possible. Ainsi, les énergies renouvelables continuent de se développer sur le territoire français. Les régions Hauts-de-France et Grand Est, en plus du nombre important de parcs éoliens (construits, accordés et en instructions), voient le nombre de parcs photovoltaïques s’implanter avec plus d’importance qu’auparavant, et permet d’aller vers la neutralité carbone. Le tri à la source des biodéchets, pour une mobilisation citoyenne par les acteurs de la prévention et la gestion de proximité des biodéchets : cas à Toulouse Métropole. La loi Anti-gaspillage pour une économie circulaire (AGEC) oblige le tri à la source à tous les producteurs et détenteurs de biodéchets, y compris aux collectivités locales, au plus tard le 31 décembre 2023. En vue de cette obligation, cette étude permet de comprendre comment les acteurs d’un territoire peuvent mobiliser les habitants à la gestion de proximité des biodéchets. Pour y répondre, il s’agit d’analyser dans quelles mesures le milieu professionnel peut disposer de leviers pour faciliter la transmission du message et des gestes pratiques sur la prévention des déchets. Ensuite, il est nécessaire d’étudier les dispositifs mis en place au sein d’autres métropoles pour identifier d’autres solutions. Puis cela consiste de recenser les acteurs locaux et leurs actions contribuant à la prévention et la gestion des biodéchets à Toulouse Métropole. La prise de contact au sein des structures professionnelles s’est déroulée dans le cadre d’une expérimentation proposée par Toulouse Métropole et co-construite avec ces dernières. L’identification des dispositifs dans d’autres métropoles s’est réalisée à partir d’un questionnaire directif, de même pour l’étude des acteurs locaux du territoire avec un questionnaire semi-directif. Les résultats montrent que l’ensemble des acteurs d’un territoire peuvent agir de manière complémentaire et mobiliser une bonne partie de la population. En effet, le milieu professionnel constitue possiblement une opportunité pour sensibiliser les habitants sur leur lieu de travail. Les métropoles accompagnent les habitants disposant d’espaces pour le compostage individuel et collectif, et travaillent majoritairement avec des partenaires pour promouvoir et accompagner les projets de compostage. Enfin, les acteurs locaux présents à Toulouse Métropole assurent un lien avec les habitants plutôt sensibilisés, déploient localement des actions et apportent chacun leur vision du compostage des biodéchets. Ce mémoire de stage ne permet pas d’étudier l’ensemble des acteurs relais de la gestion des biodéchets. C’est pourquoi un état des lieux de l’ensemble de ces derniers permettrait d’identifier les catégories de population manquant d’informations ou de dispositifs de gestion des biodéchets.
Le tri à la source des biodéchets, pour une mobilisation citoyenne par les acteurs de la prévention et la gestion de proximité des biodéchets : cas à Toulouse Métropole. La loi Anti-gaspillage pour une économie circulaire (AGEC) oblige le tri à la source à tous les producteurs et détenteurs de biodéchets, y compris aux collectivités locales, au plus tard le 31 décembre 2023. En vue de cette obligation, cette étude permet de comprendre comment les acteurs d’un territoire peuvent mobiliser les habitants à la gestion de proximité des biodéchets. Pour y répondre, il s’agit d’analyser dans quelles mesures le milieu professionnel peut disposer de leviers pour faciliter la transmission du message et des gestes pratiques sur la prévention des déchets. Ensuite, il est nécessaire d’étudier les dispositifs mis en place au sein d’autres métropoles pour identifier d’autres solutions. Puis cela consiste de recenser les acteurs locaux et leurs actions contribuant à la prévention et la gestion des biodéchets à Toulouse Métropole. La prise de contact au sein des structures professionnelles s’est déroulée dans le cadre d’une expérimentation proposée par Toulouse Métropole et co-construite avec ces dernières. L’identification des dispositifs dans d’autres métropoles s’est réalisée à partir d’un questionnaire directif, de même pour l’étude des acteurs locaux du territoire avec un questionnaire semi-directif. Les résultats montrent que l’ensemble des acteurs d’un territoire peuvent agir de manière complémentaire et mobiliser une bonne partie de la population. En effet, le milieu professionnel constitue possiblement une opportunité pour sensibiliser les habitants sur leur lieu de travail. Les métropoles accompagnent les habitants disposant d’espaces pour le compostage individuel et collectif, et travaillent majoritairement avec des partenaires pour promouvoir et accompagner les projets de compostage. Enfin, les acteurs locaux présents à Toulouse Métropole assurent un lien avec les habitants plutôt sensibilisés, déploient localement des actions et apportent chacun leur vision du compostage des biodéchets. Ce mémoire de stage ne permet pas d’étudier l’ensemble des acteurs relais de la gestion des biodéchets. C’est pourquoi un état des lieux de l’ensemble de ces derniers permettrait d’identifier les catégories de population manquant d’informations ou de dispositifs de gestion des biodéchets. Stage Conseil des Équidés Nouvelle Aquitaine. La transition environnementale dans la filière équine : comment les outils existants et en développement sont appropriés par les différents acteurs ? La filière équine est une filière riche et comportant de nombreux acteurs, très différents les uns des autres. Eleveurs de chevaux, centre équestres, entraineurs de chevaux de courses, selliers, vétérinaires, … Ces différents acteurs sont implantés sur des territoires tout aussi différents et ont des structures et des fonctionnements multiples. Cette diversité est un enjeu majeur pour la filière, qui tente de construire des outils fédérateurs. Ces outils commencent aujourd’hui à se mettre au service de la transition environnementale. Bien-être animal, optimisation environnementale des exploitations, gestion des prairies, valorisation du fumier, énergie cheval, tourisme vert et occupation du territoire sont les principaux points de cette transition environnementale dans la filière. Plusieurs outils sont développés ou en développement. Par exemple, un label de qualité, Qualit’Equidés, qui certifie les professionnels sur leurs bonnes pratiques en termes de réglementation, de bien être animal, de biosécurité et d’environnement se déploie aujourd’hui sur plusieurs régions françaises, dont Nouvelle Aquitaine. Ces outils sont acceptés de manière très disparate. Différents facteurs entrent en ligne de compte : typologie de l’exploitation, âge et expérience du gérant, intérêt en termes de communication ou de besoins économiques, … De manière générale, on constate que l’entrée dans la transition environnementale se fait pour des raisons économiques, avant les raisons idéologiques. Elle se fait également pour des raisons de communication, de vitrine, mais peu par conscience écologique. Les exploitations « cheval » ont la « chance » de ne pas être pointées du doigt au sein du milieu agricole, et ne souffrent d’aucun scandale écologique ou environnemental. Mais cela freine quelque peu sa prise en compte de la transition environnementale. La filière n’a pas besoin de « verdir » son image, qui est déjà très verte dans l’inconscient collectif. Le plus gros du travail, auprès du grand public et surtout pour elle-même, est celle du bien être animal. Ce dernier est également diversement compris et pris en compte selon les typologies d’acteur. On comprend alors que cette grande diversité est un frein pour la filière, mais des associations comme le Conseil des Equidés tendent à réduire les écarts entre professionnels en proposant des outils fédérateurs. L’éducation et la formation restera la clé du changement et de l’évolution.
Stage Conseil des Équidés Nouvelle Aquitaine. La transition environnementale dans la filière équine : comment les outils existants et en développement sont appropriés par les différents acteurs ? La filière équine est une filière riche et comportant de nombreux acteurs, très différents les uns des autres. Eleveurs de chevaux, centre équestres, entraineurs de chevaux de courses, selliers, vétérinaires, … Ces différents acteurs sont implantés sur des territoires tout aussi différents et ont des structures et des fonctionnements multiples. Cette diversité est un enjeu majeur pour la filière, qui tente de construire des outils fédérateurs. Ces outils commencent aujourd’hui à se mettre au service de la transition environnementale. Bien-être animal, optimisation environnementale des exploitations, gestion des prairies, valorisation du fumier, énergie cheval, tourisme vert et occupation du territoire sont les principaux points de cette transition environnementale dans la filière. Plusieurs outils sont développés ou en développement. Par exemple, un label de qualité, Qualit’Equidés, qui certifie les professionnels sur leurs bonnes pratiques en termes de réglementation, de bien être animal, de biosécurité et d’environnement se déploie aujourd’hui sur plusieurs régions françaises, dont Nouvelle Aquitaine. Ces outils sont acceptés de manière très disparate. Différents facteurs entrent en ligne de compte : typologie de l’exploitation, âge et expérience du gérant, intérêt en termes de communication ou de besoins économiques, … De manière générale, on constate que l’entrée dans la transition environnementale se fait pour des raisons économiques, avant les raisons idéologiques. Elle se fait également pour des raisons de communication, de vitrine, mais peu par conscience écologique. Les exploitations « cheval » ont la « chance » de ne pas être pointées du doigt au sein du milieu agricole, et ne souffrent d’aucun scandale écologique ou environnemental. Mais cela freine quelque peu sa prise en compte de la transition environnementale. La filière n’a pas besoin de « verdir » son image, qui est déjà très verte dans l’inconscient collectif. Le plus gros du travail, auprès du grand public et surtout pour elle-même, est celle du bien être animal. Ce dernier est également diversement compris et pris en compte selon les typologies d’acteur. On comprend alors que cette grande diversité est un frein pour la filière, mais des associations comme le Conseil des Equidés tendent à réduire les écarts entre professionnels en proposant des outils fédérateurs. L’éducation et la formation restera la clé du changement et de l’évolution. Agrivoltaïsme : Présentation d'une solution face à l'impératif de transition écologique et aux difficultés rencontrées par les agriculteurs. L’agrivoltaïsme est une pratique qui consiste à réaliser un couplage entre une activité agricole et une production d’énergie. Cette filière émergente propose notamment des solutions afin de répondre à plusieurs enjeux. D’une part cela permet de répondre à la problématique du manque de ressources foncières disponibles, nécessaires pour atteindre les objectifs de la filière photovoltaïque. D’autre part, ce couplage apparaît comme une opportunité pour la filière agricole, permettant aux agriculteurs d’augmenter leur résilience face aux crises économiques, sociales, et sanitaires auxquelles ils sont confrontés. Toutefois l’agrivoltaïsme est un sujet très controversé. Cette pratique se heurte à une forte problématique d’acceptabilité sociale. Il existe à ce jour encore peu de retours d’expériences sur ce type de projet, ne permettant pas d’affirmer avec certitude son efficacité et sa pertinence. La filière est également en pleine structuration réglementaire. Le cadre légal de l’agrivoltaïsme est encore peu défini, et de nombreuses zones d’ombres persistent à ce jour, constituant une difficulté supplémentaire pour le développement de ce type de projets. Deux cas d’études de centrales agrivoltaïques sont étudiés au sein de ce rapport. Ces projets sont confrontés aux problématiques classiques des centrales agrivoltaïques, à savoir leur acceptabilité sociale, ainsi que les contraintes techniques du dimensionnement des installations. L’analyse de ces projets permet de nourrir la réflexion, concernant l’adéquation de cette pratique avec les enjeux identifiés sur les territoires dans lesquels ils s’inscrivent.
Agrivoltaïsme : Présentation d'une solution face à l'impératif de transition écologique et aux difficultés rencontrées par les agriculteurs. L’agrivoltaïsme est une pratique qui consiste à réaliser un couplage entre une activité agricole et une production d’énergie. Cette filière émergente propose notamment des solutions afin de répondre à plusieurs enjeux. D’une part cela permet de répondre à la problématique du manque de ressources foncières disponibles, nécessaires pour atteindre les objectifs de la filière photovoltaïque. D’autre part, ce couplage apparaît comme une opportunité pour la filière agricole, permettant aux agriculteurs d’augmenter leur résilience face aux crises économiques, sociales, et sanitaires auxquelles ils sont confrontés. Toutefois l’agrivoltaïsme est un sujet très controversé. Cette pratique se heurte à une forte problématique d’acceptabilité sociale. Il existe à ce jour encore peu de retours d’expériences sur ce type de projet, ne permettant pas d’affirmer avec certitude son efficacité et sa pertinence. La filière est également en pleine structuration réglementaire. Le cadre légal de l’agrivoltaïsme est encore peu défini, et de nombreuses zones d’ombres persistent à ce jour, constituant une difficulté supplémentaire pour le développement de ce type de projets. Deux cas d’études de centrales agrivoltaïques sont étudiés au sein de ce rapport. Ces projets sont confrontés aux problématiques classiques des centrales agrivoltaïques, à savoir leur acceptabilité sociale, ainsi que les contraintes techniques du dimensionnement des installations. L’analyse de ces projets permet de nourrir la réflexion, concernant l’adéquation de cette pratique avec les enjeux identifiés sur les territoires dans lesquels ils s’inscrivent. Réactivation de la coopération transfrontalière pour la gestion
de la garonne Le Syndicat Mixte d’Étude et d’Aménagement de la Garonne (SMEAG) en tant que porteur du schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) « Vallée de la Garonne » 2020-2030 pour le compte de la Commission Locale de l’Eau, met en œuvre une politique pour créer des conditions de gouvernance favorables. Sa ligne directrice est l’atteinte des objectifs environnementaux fixés par la Directive Cadre sur l’Eau (DCE). Cette étude s’inscrit en préalable de la disposition V.6 « Créer une instance de pilotage de la Garonne transfrontalière » du SAGE. L’objectif de cette étude est d’identifier les freins et les opportunités à la mise en place d’une coopération entre la France et l’Espagne pour la gestion de la Garonne. Ce mémoire de stage constitue un diagnostic de la coopération transfrontalière partagé afin de pouvoir poser les bases d’une coopération durable. La zone d’étude est composée de la commission géographique « Garonne montagnarde » du SAGE ainsi que la comarque du Val d’Aran en Espagne où la Garonne prend ses sources. Les dynamiques du territoire de la Garonne transfrontalière sont directement liées à son environnement montagnard. Les prévisions climatiques annoncent un milieu naturel sous pression menaçant de nombreux secteurs d’activité de la région. Ces prévisions appellent à des changements d’usage et de gestion de la ressource dès à présent. La partie française et espagnole de la zone d’étude possède de nombreuses caractéristiques culturelles communes en lien avec l’histoire de la vallée. Malgré ces caractéristiques partagées, l’état de l’art de la coopération montre que les projets communs pour la gestion intégrée de l’eau ne sont pas aussi nombreux que ceux autour d’autres thématiques. Depuis 10 ans, les échanges et les discussions entre les gestionnaires de l’eau se sont perdus du fait d’une carence d’animation et d’une complexité politique. Les résultats de cette étude sont notamment fondés sur 14 entretiens semi-directifs avec les acteurs du territoire côtés Français et Espagnol. Les opportunités à la réactivation de la coopération sont liées aux caractéristiques communes des deux territoires, aux aides financières de l’Union Européenne ainsi qu’à une volonté générale de retravailler ensemble. Les freins mis en lumière sont liés à un manque d’implication des parties prenantes de la coopération et aux deux modes de gestion et d’administration véritablement différents. Les nombreuses thématiques potentielles de travail identifiées par les acteurs du territoire prouvent un retard dans une gestion cohérente de la Garonne autour de la frontière franco-espagnole. L’étude suggère une première coopération sur la thématique de la sensibilisation à l’environnement et l’eau. Aux vus des résultats, il sera nécessaire d’inscrire la coopération dans un programme de financement Interreg type POCTEFA en prenant en compte les enjeux de gouvernance identifiés. Le futur groupe de travail devra s’approprier les résultats de cette étude présentés le 25 août 2022 au Val d’Aran, afin de définir ensemble un plan d’action.
Réactivation de la coopération transfrontalière pour la gestion
de la garonne Le Syndicat Mixte d’Étude et d’Aménagement de la Garonne (SMEAG) en tant que porteur du schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) « Vallée de la Garonne » 2020-2030 pour le compte de la Commission Locale de l’Eau, met en œuvre une politique pour créer des conditions de gouvernance favorables. Sa ligne directrice est l’atteinte des objectifs environnementaux fixés par la Directive Cadre sur l’Eau (DCE). Cette étude s’inscrit en préalable de la disposition V.6 « Créer une instance de pilotage de la Garonne transfrontalière » du SAGE. L’objectif de cette étude est d’identifier les freins et les opportunités à la mise en place d’une coopération entre la France et l’Espagne pour la gestion de la Garonne. Ce mémoire de stage constitue un diagnostic de la coopération transfrontalière partagé afin de pouvoir poser les bases d’une coopération durable. La zone d’étude est composée de la commission géographique « Garonne montagnarde » du SAGE ainsi que la comarque du Val d’Aran en Espagne où la Garonne prend ses sources. Les dynamiques du territoire de la Garonne transfrontalière sont directement liées à son environnement montagnard. Les prévisions climatiques annoncent un milieu naturel sous pression menaçant de nombreux secteurs d’activité de la région. Ces prévisions appellent à des changements d’usage et de gestion de la ressource dès à présent. La partie française et espagnole de la zone d’étude possède de nombreuses caractéristiques culturelles communes en lien avec l’histoire de la vallée. Malgré ces caractéristiques partagées, l’état de l’art de la coopération montre que les projets communs pour la gestion intégrée de l’eau ne sont pas aussi nombreux que ceux autour d’autres thématiques. Depuis 10 ans, les échanges et les discussions entre les gestionnaires de l’eau se sont perdus du fait d’une carence d’animation et d’une complexité politique. Les résultats de cette étude sont notamment fondés sur 14 entretiens semi-directifs avec les acteurs du territoire côtés Français et Espagnol. Les opportunités à la réactivation de la coopération sont liées aux caractéristiques communes des deux territoires, aux aides financières de l’Union Européenne ainsi qu’à une volonté générale de retravailler ensemble. Les freins mis en lumière sont liés à un manque d’implication des parties prenantes de la coopération et aux deux modes de gestion et d’administration véritablement différents. Les nombreuses thématiques potentielles de travail identifiées par les acteurs du territoire prouvent un retard dans une gestion cohérente de la Garonne autour de la frontière franco-espagnole. L’étude suggère une première coopération sur la thématique de la sensibilisation à l’environnement et l’eau. Aux vus des résultats, il sera nécessaire d’inscrire la coopération dans un programme de financement Interreg type POCTEFA en prenant en compte les enjeux de gouvernance identifiés. Le futur groupe de travail devra s’approprier les résultats de cette étude présentés le 25 août 2022 au Val d’Aran, afin de définir ensemble un plan d’action. Évaluation d'une affiche comme nouvel outil de communication sur les risques majeurs Les risques majeurs sont des évènements brutaux et de faible occurrence ce qui tend à les occulter de la conscience collective. Pourtant, dans le contexte du changement global, ceux-ci sont voués à croitre tant en terme d’intensité que de fréquence. Face à cette menace, en France, comme à l’étranger plusieurs mesures sont mises en place pour gérer les risques. Elles sont d’ordre structurel ou non et tentent d’agir avant, durant et après la crise. Parmi ces mesures, la communication vise à éduquer, à informer et à rendre actrices les personnes lors d’évènements majeurs. Pour y arriver, plusieurs outils existent tels que le DICRIM (Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs) qui était au centre du projet Effi-DICRIM. Au cours de ce projet, a été proposée une affiche sous forme de détachable pouvant être annexée au DICRIM ou être développée dans un format plus grand sous forme de poster. Synthétique et facilement adaptable à l’ensemble des communes, cette dernière comporte : les systèmes d’alarmes de la commune, les consignes des comportements à tenir en cas d’évènement, la composition d’un kit d’urgence et les numéros utiles (numéros d’urgence et mairie). Elle a donc pour objectif de conférer au public une information mobilisable avant et durant la crise. Dans ce travail, nous avons proposé une démarche pour évaluer l’efficacité de cette affiche auprès du grand public. Pour y parvenir, ce travail a été mené auprès de deux communes, Auriol et le Tholonet. Pour chacune d’elles, l’affiche a été adaptée puis intégrée à un questionnaire destiné à la population. Ce premier questionnaire tente d’apporter des informations sur les connaissances des risques et de l’appréciation de l’affiche de des répondants. Un second questionnaire a ensuite été soumis aux répondants volontaires pour faire le suivi de leurs connaissances et de l’appréciation de l’affiche, permettant de surcroit, l’évaluation de l’affiche dans le temps. Au total ce sont 80 personnes issues des deux communes qui ont participé à l’enquête. Sur la base de ces réponses, l’analyse menée permet de mettre en avant des dépendances ou non entre le profil, les connaissances et l’appréciation de l’affiche. Ces éléments étant susceptibles d’influencer le transfert d’information de manière favorable ou non indiquent finalement comment atteindre le public efficacement dans la communication sur les risques.
Évaluation d'une affiche comme nouvel outil de communication sur les risques majeurs Les risques majeurs sont des évènements brutaux et de faible occurrence ce qui tend à les occulter de la conscience collective. Pourtant, dans le contexte du changement global, ceux-ci sont voués à croitre tant en terme d’intensité que de fréquence. Face à cette menace, en France, comme à l’étranger plusieurs mesures sont mises en place pour gérer les risques. Elles sont d’ordre structurel ou non et tentent d’agir avant, durant et après la crise. Parmi ces mesures, la communication vise à éduquer, à informer et à rendre actrices les personnes lors d’évènements majeurs. Pour y arriver, plusieurs outils existent tels que le DICRIM (Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs) qui était au centre du projet Effi-DICRIM. Au cours de ce projet, a été proposée une affiche sous forme de détachable pouvant être annexée au DICRIM ou être développée dans un format plus grand sous forme de poster. Synthétique et facilement adaptable à l’ensemble des communes, cette dernière comporte : les systèmes d’alarmes de la commune, les consignes des comportements à tenir en cas d’évènement, la composition d’un kit d’urgence et les numéros utiles (numéros d’urgence et mairie). Elle a donc pour objectif de conférer au public une information mobilisable avant et durant la crise. Dans ce travail, nous avons proposé une démarche pour évaluer l’efficacité de cette affiche auprès du grand public. Pour y parvenir, ce travail a été mené auprès de deux communes, Auriol et le Tholonet. Pour chacune d’elles, l’affiche a été adaptée puis intégrée à un questionnaire destiné à la population. Ce premier questionnaire tente d’apporter des informations sur les connaissances des risques et de l’appréciation de l’affiche de des répondants. Un second questionnaire a ensuite été soumis aux répondants volontaires pour faire le suivi de leurs connaissances et de l’appréciation de l’affiche, permettant de surcroit, l’évaluation de l’affiche dans le temps. Au total ce sont 80 personnes issues des deux communes qui ont participé à l’enquête. Sur la base de ces réponses, l’analyse menée permet de mettre en avant des dépendances ou non entre le profil, les connaissances et l’appréciation de l’affiche. Ces éléments étant susceptibles d’influencer le transfert d’information de manière favorable ou non indiquent finalement comment atteindre le public efficacement dans la communication sur les risques.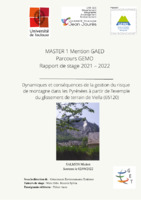 Dynamiques et conséquences de la gestion du risque de montagne dans les Pyrénées à partir de l’exemple du glissement de terrain de Viella (65120) Dans une petite commune des Hautes-Pyrénées, à Viella, se produit depuis plusieurs siècles un des plus importants glissements de terrain d’Europe : important du fait de sa taille et des impacts qu’il peut causer sur le village et ses habitants. En 1997, une grosse crue du Bastan déstabilise le versant et provoque un gros glissement de terrain l’année suivante. Un siècle plus tard, l’histoire se répète : la crue du Bastan en 2013 déstabilise à nouveau la montagne et réactive le glissement en 2018, mettant en péril certaines habitations et infrastructures. Fissures sur les maisons, sur l’église et même sur les murs de cimetière, peu de bâtiments ont été épargnés. Certaines habitations, devenues trop dangereuses pour être habitées, doivent être démolies. Celles-ci commencèrent en juin 2022, provoquant de grosses conséquences psychologiques sur les sinistrés. Pas de suivi psychologique pour ces derniers, ils ne se sentent pas soutenus dans cette crise, d’autant plus qu’ils rencontrent de grosses difficultés avec les assurances qui tardent à les indemniser. De nombreuses institutions se mobilisent pour essayer de comprendre ce phénomène et tentent de le ralentir. A la suite de longues études, le service de restauration de terrain en montagne (RTM) rend son rapport : de l’eau s’infiltre et circule partout sous la montagne et sous le village, provoquant une déstabilisation du versant. Des travaux doivent être réalisés pour limiter cet écoulement souterrain et stabiliser à nouveau le versant afin de ralentir le glissement. Ces travaux commencèrent en décembre 2021. Les habitants, soucieux et inquiets pour l’avenir de leur village, créent une association après cette nouvelle crise. Attachés à leur commune, la plupart des habitants ne peuvent se résigner à partir. Malgré tout, certains y sont contraints : la peur du danger et l’impact du glissement sur leurs habitations étant omniprésent. Malgré ce risque, pendant de longues années après le premier gros glissement, des autorisations de construire ont continué à être délivrées, même sur des zones à risques. Y a-t-il eu une négligence de la part des services de l’état sur les constructions ? Les Hommes continuent encore aujourd’hui à s’installer sur la commune. La mémoire du risque a-t-elle été mise de côté ? Y a-t-il une sous-estimation du danger ou une méconnaissance du risque ? Ce mémoire expose les dynamiques et les conséquences de la gestion de crise en montagne, en ayant à la fois une approche sociologique et géomorphologique.
Dynamiques et conséquences de la gestion du risque de montagne dans les Pyrénées à partir de l’exemple du glissement de terrain de Viella (65120) Dans une petite commune des Hautes-Pyrénées, à Viella, se produit depuis plusieurs siècles un des plus importants glissements de terrain d’Europe : important du fait de sa taille et des impacts qu’il peut causer sur le village et ses habitants. En 1997, une grosse crue du Bastan déstabilise le versant et provoque un gros glissement de terrain l’année suivante. Un siècle plus tard, l’histoire se répète : la crue du Bastan en 2013 déstabilise à nouveau la montagne et réactive le glissement en 2018, mettant en péril certaines habitations et infrastructures. Fissures sur les maisons, sur l’église et même sur les murs de cimetière, peu de bâtiments ont été épargnés. Certaines habitations, devenues trop dangereuses pour être habitées, doivent être démolies. Celles-ci commencèrent en juin 2022, provoquant de grosses conséquences psychologiques sur les sinistrés. Pas de suivi psychologique pour ces derniers, ils ne se sentent pas soutenus dans cette crise, d’autant plus qu’ils rencontrent de grosses difficultés avec les assurances qui tardent à les indemniser. De nombreuses institutions se mobilisent pour essayer de comprendre ce phénomène et tentent de le ralentir. A la suite de longues études, le service de restauration de terrain en montagne (RTM) rend son rapport : de l’eau s’infiltre et circule partout sous la montagne et sous le village, provoquant une déstabilisation du versant. Des travaux doivent être réalisés pour limiter cet écoulement souterrain et stabiliser à nouveau le versant afin de ralentir le glissement. Ces travaux commencèrent en décembre 2021. Les habitants, soucieux et inquiets pour l’avenir de leur village, créent une association après cette nouvelle crise. Attachés à leur commune, la plupart des habitants ne peuvent se résigner à partir. Malgré tout, certains y sont contraints : la peur du danger et l’impact du glissement sur leurs habitations étant omniprésent. Malgré ce risque, pendant de longues années après le premier gros glissement, des autorisations de construire ont continué à être délivrées, même sur des zones à risques. Y a-t-il eu une négligence de la part des services de l’état sur les constructions ? Les Hommes continuent encore aujourd’hui à s’installer sur la commune. La mémoire du risque a-t-elle été mise de côté ? Y a-t-il une sous-estimation du danger ou une méconnaissance du risque ? Ce mémoire expose les dynamiques et les conséquences de la gestion de crise en montagne, en ayant à la fois une approche sociologique et géomorphologique.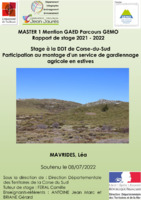 Participation au montage d’un service de gardiennage agricole en estives Au cours de ce stage de Master 1, d’une durée de deux mois, réalisé à la Direction Départementale des Territoires de Corse du Sud, j’ai participé au montage d’un service de gardiennage agricole en estives. Ce projet s’expérimentera d’abord sur le plateau du Coscione, en Corse du Sud. Au sein de la structure, ma mission principale reposait sur la rédaction d’un cahier des charges de gestion pastorale en accord avec les milieux naturels. Pour ce faire, j’ai procédé en plusieurs étapes : caractérisation des milieux, réalisation d’entretiens avec les acteurs, visites sur le terrain. Ce rapport constitue une amorce à ce projet, qui nécessite encore réflexion et maturation.
Participation au montage d’un service de gardiennage agricole en estives Au cours de ce stage de Master 1, d’une durée de deux mois, réalisé à la Direction Départementale des Territoires de Corse du Sud, j’ai participé au montage d’un service de gardiennage agricole en estives. Ce projet s’expérimentera d’abord sur le plateau du Coscione, en Corse du Sud. Au sein de la structure, ma mission principale reposait sur la rédaction d’un cahier des charges de gestion pastorale en accord avec les milieux naturels. Pour ce faire, j’ai procédé en plusieurs étapes : caractérisation des milieux, réalisation d’entretiens avec les acteurs, visites sur le terrain. Ce rapport constitue une amorce à ce projet, qui nécessite encore réflexion et maturation. Les perceptions locales de la vallée de l’Orbiel : traitement de cartes participatives La crue d’octobre 2018 qui s’est produite dans la vallée de l’Orbiel a fait émerger des questions sur le risque environnemental et sanitaire que présente la pollution de l’ancien site minier de Salsigne. C’est dans ce contexte que les étudiants de M2 TRENT ont réalisé un diagnostic et ont organisé des ateliers de cartographies participatives avec les habitants du bassin versant de l’Orbiel. Mon stage consistait à poursuivre leur travail par le traitement et l’analyse des cartes participatives qui ont été réalisées. L’approche par la cartographie participative permet de récolter des connaissances locales et de représenter la perception qu’ont les habitants de leur territoire. Après numérisation des cartes papiers dans un logiciel SIG, les données ont été fusionnées afin de réaliser une carte synthèse présentant les perceptions de la population pour chacune des thématiques abordées. Il en résulte, une description du paysage dans sa globalité, avec ses caractéristiques géographiques propres (reliefs, vallées, régions du Minervois et du Cabardès). Par ailleurs, les cartes révèlent un territoire fractionné avec des villes isolées au Nord et des villes dynamiques au Sud, ce qui est à l’origine d’un accès aux services publics inégal. Il ressort également de mon analyse la vision d’une végétation « mosaïque » avec des espaces ouverts (vignes et garrigues) sur les plaines contrastant avec les espaces plutôt fermés (forêts) de la Montagne Noire. Par conséquent, la représentation que font les habitants de leur territoire est très vaste et diverse. Cependant peu d’habitants ont évoqué la pollution minière qui est pourtant l’enjeu majeur de vallée de l’Orbiel, laissant en suspens des questions : Sont-ils ignorants des dangers ? Ou bien ne se sentent-ils pas concernés par ce risque ? Est-ce la cause d’une désinformation ou minimisation des dangers par les élus ou par le BRGM en charge de la gestion de la sécurité de la mine ? On peut émettre l’hypothèse d’un échantillon biaisé par la présence d’acteurs décisionnaires. En effet des maires et des élus ont participé aux ateliers et on peut penser qu’ils ne souhaitent pas ternir l’image de leur territoire.
Les perceptions locales de la vallée de l’Orbiel : traitement de cartes participatives La crue d’octobre 2018 qui s’est produite dans la vallée de l’Orbiel a fait émerger des questions sur le risque environnemental et sanitaire que présente la pollution de l’ancien site minier de Salsigne. C’est dans ce contexte que les étudiants de M2 TRENT ont réalisé un diagnostic et ont organisé des ateliers de cartographies participatives avec les habitants du bassin versant de l’Orbiel. Mon stage consistait à poursuivre leur travail par le traitement et l’analyse des cartes participatives qui ont été réalisées. L’approche par la cartographie participative permet de récolter des connaissances locales et de représenter la perception qu’ont les habitants de leur territoire. Après numérisation des cartes papiers dans un logiciel SIG, les données ont été fusionnées afin de réaliser une carte synthèse présentant les perceptions de la population pour chacune des thématiques abordées. Il en résulte, une description du paysage dans sa globalité, avec ses caractéristiques géographiques propres (reliefs, vallées, régions du Minervois et du Cabardès). Par ailleurs, les cartes révèlent un territoire fractionné avec des villes isolées au Nord et des villes dynamiques au Sud, ce qui est à l’origine d’un accès aux services publics inégal. Il ressort également de mon analyse la vision d’une végétation « mosaïque » avec des espaces ouverts (vignes et garrigues) sur les plaines contrastant avec les espaces plutôt fermés (forêts) de la Montagne Noire. Par conséquent, la représentation que font les habitants de leur territoire est très vaste et diverse. Cependant peu d’habitants ont évoqué la pollution minière qui est pourtant l’enjeu majeur de vallée de l’Orbiel, laissant en suspens des questions : Sont-ils ignorants des dangers ? Ou bien ne se sentent-ils pas concernés par ce risque ? Est-ce la cause d’une désinformation ou minimisation des dangers par les élus ou par le BRGM en charge de la gestion de la sécurité de la mine ? On peut émettre l’hypothèse d’un échantillon biaisé par la présence d’acteurs décisionnaires. En effet des maires et des élus ont participé aux ateliers et on peut penser qu’ils ne souhaitent pas ternir l’image de leur territoire. Les forêts alluviales du Grésivaudan (Isère) : Problématique de gestion de l'ENS. Les périodes de canicules de plus en plus marquées et, plus globalement, le réchauffement qui sévit à l'échelle planétaire, nous font prendre conscience que les endroits pour se rafraîchir, notamment les zones humides, se font de plus en plus rares alors qu'elles sont de plus en plus appréciées. Se rafraichir dans un cadre naturel idyllique riche en biodiversité, c'est un des nombreux services écologiques que nous confère la forêt alluviale du Grésivaudan dans le département de l'Isère. Longeant le fleuve du même nom, cette forêt est dans sa quasi-totalité classée en espace naturel sensible, un statut qui lui confère une gestion particulière. Derrière cet endroit remarquable et comme tout autre espace naturel sensible, une autre dimension à laquelle on ne pense pas forcément se cache : celle de la gestion de cet espace. Ce rapport de stage se penchera justement sur cette dimension en s'intégrant au cœur de l'élaboration d'un plan de gestion. Celle-ci nécessite autant d'analyses rigoureuses que d'interventions. Il sera vu dans ce dossier comment effectuer des diagnostics écologiques spécifiques aux espèces envahissantes et aux plantations de peupliers sur cette forêt, ainsi que la gestion adaptée pour chacune de ces problématiques. Cette étude relèvera la nécessité d'une gestion évolutive en adéquation aux trajectoires écologiques des milieux, puisqu'un milieu naturel n'est jamais fixe dans le temps, c'est une dynamique écologique.
Les forêts alluviales du Grésivaudan (Isère) : Problématique de gestion de l'ENS. Les périodes de canicules de plus en plus marquées et, plus globalement, le réchauffement qui sévit à l'échelle planétaire, nous font prendre conscience que les endroits pour se rafraîchir, notamment les zones humides, se font de plus en plus rares alors qu'elles sont de plus en plus appréciées. Se rafraichir dans un cadre naturel idyllique riche en biodiversité, c'est un des nombreux services écologiques que nous confère la forêt alluviale du Grésivaudan dans le département de l'Isère. Longeant le fleuve du même nom, cette forêt est dans sa quasi-totalité classée en espace naturel sensible, un statut qui lui confère une gestion particulière. Derrière cet endroit remarquable et comme tout autre espace naturel sensible, une autre dimension à laquelle on ne pense pas forcément se cache : celle de la gestion de cet espace. Ce rapport de stage se penchera justement sur cette dimension en s'intégrant au cœur de l'élaboration d'un plan de gestion. Celle-ci nécessite autant d'analyses rigoureuses que d'interventions. Il sera vu dans ce dossier comment effectuer des diagnostics écologiques spécifiques aux espèces envahissantes et aux plantations de peupliers sur cette forêt, ainsi que la gestion adaptée pour chacune de ces problématiques. Cette étude relèvera la nécessité d'une gestion évolutive en adéquation aux trajectoires écologiques des milieux, puisqu'un milieu naturel n'est jamais fixe dans le temps, c'est une dynamique écologique. Les informations géographiques volontaires comme un outil d'observation des pratiques de sport de nature et de la fréquentation des milieux naturels. Le Geo web participatif est devenue virale sur l’internet, sur la base de contributions volontaires, les utilisateurs participent à la création de base de données informationnels géolocalisés, on parle d’informations géographiques volontaires. Dans le cadre des sports de nature, animées par un souffle libertaire, des plateformes collaboratives spécialisés dans les sports de nature avec une richesse de fonctionnalités et de contenus ont influencé la création de nouveaux usages et de nouveaux espaces de pratique. Les pratiquants de sport de nature, sous la forme de contributions volontaires, se retrouvent au centre d’un dispositif de partage et de création intentionnelle de contenu informationnel. L’exploitation des informations géolocalisées issues de ces plateformes de sport de nature peuvent venir combler la fracture en termes de capital informationnel associés aux pratiques et à la fréquentation des aires protégés. Elles peuvent s’ancrer dans de nouveaux dispositifs d’évaluation de la fréquentation et aider les acteurs territoriaux à orienter des stratégies pour gérer les flux de personnes et préserver les espaces sensibles. A ce jour, très peu de travaux se sont intéressés aux informations géographiques volontaires dans les sports de nature. Il s’agira ici de démontrer le potentiel des IGV appliqué au sport de nature, en analysant les usages du numérique chez les pratiquants de sports de nature ; en valorisant la donnée issue d’une plateforme spécialisée dans les sports de montagne, camp to camp, à plusieurs échelles du territoire, celle des Alpes et celle du Parc national des Écrins.
Les informations géographiques volontaires comme un outil d'observation des pratiques de sport de nature et de la fréquentation des milieux naturels. Le Geo web participatif est devenue virale sur l’internet, sur la base de contributions volontaires, les utilisateurs participent à la création de base de données informationnels géolocalisés, on parle d’informations géographiques volontaires. Dans le cadre des sports de nature, animées par un souffle libertaire, des plateformes collaboratives spécialisés dans les sports de nature avec une richesse de fonctionnalités et de contenus ont influencé la création de nouveaux usages et de nouveaux espaces de pratique. Les pratiquants de sport de nature, sous la forme de contributions volontaires, se retrouvent au centre d’un dispositif de partage et de création intentionnelle de contenu informationnel. L’exploitation des informations géolocalisées issues de ces plateformes de sport de nature peuvent venir combler la fracture en termes de capital informationnel associés aux pratiques et à la fréquentation des aires protégés. Elles peuvent s’ancrer dans de nouveaux dispositifs d’évaluation de la fréquentation et aider les acteurs territoriaux à orienter des stratégies pour gérer les flux de personnes et préserver les espaces sensibles. A ce jour, très peu de travaux se sont intéressés aux informations géographiques volontaires dans les sports de nature. Il s’agira ici de démontrer le potentiel des IGV appliqué au sport de nature, en analysant les usages du numérique chez les pratiquants de sports de nature ; en valorisant la donnée issue d’une plateforme spécialisée dans les sports de montagne, camp to camp, à plusieurs échelles du territoire, celle des Alpes et celle du Parc national des Écrins. Les impacts hydromorphologiques de l'arasement du seuil de Caubous sur la Garonne amont Les opérations d’effacements des ouvrages transversaux sont soutenues par la DCE depuis 2000 dans l’objectif de retrouver un bon état des cours d’eau. Il est entendu par bon état les qualités chimiques et écologiques. L’hydromorphologie est perçue comme un paramètre secondaire soutenant la qualité écologique. La DCE a été transposé dans le droit français au travers de la LEMA et des Grenelles de l’environnement qui consacrent une grande importance à la continuité écologique. Celle-ci est la mesure phare pour la restauration écologique. Ces lois prônent ainsi des opérations d’effacements d’ouvrages afin que les transit sédimentaires et faunistiques soient rétablis. L’objectif de ce travail repose sur la manière dont on pourrait appréhender les impacts hydromorphologiques à partir des hauteurs d’eau sur le seuil de Caubous. Ainsi, la présente recherche propose d’abord de saisir la manière dont l’arasement des seuils altère le fonctionnement d’un hydrosystème au travers de diverses études. Puis, nous nous sommes intéressés au changement de paradigme qu’ont induite les lois pour comprendre les raisons qui ont poussé à l’arasement du seuil de Caubous. La singularité du terrain nous a conduit à étudier le secteur d’étude sur les particularités physiques et anthropiques dont il fait l’objet. Les méthodes utilisées se basent sur des hauteurs d’eau de cinq limnimètres posés sur le bief en aval de Saint-Béat et des hauteurs d’eau de la station hydrologique de Saint-Béat. Pour étudier les limnimètres entre eux, nous avons adopté une approche quantitative aux moyens de statistiques. Les résultats laissent penser que le lit à l’aval du seuil s’est exhaussé directement après l’arasement. La zone amont présente quant à elle un abaissement de la ligne d’eau deux ans après, suggérant l’apparition d’une érosion régressive. La comparaison avec la station hydrologique a confirmé que lors de ces périodes fluctuantes, les hauteurs d’eau de Saint-Béat ne régissaient pas ou que peu les variations des hauteurs d’eau des limnimètres. Par la suite, l’approche qualitative a montré une puissance spécifique importante, déterminant de la capacité de réajustement du chenal. Les berges, très anthropisées, ne suggèrent aucun ajustement latéral. Quant à la nature des matériaux, majoritairement grossiers, soutient l’érosion verticale des lits. Finalement, on montre que les hauteurs d’eau sont un bon moyen pour appréhender les mutations hydromorphologiques suite à l’arasement d’un seuil mais nécessitent tout de même d’autres approches pour compléter et affirmer les hypothèses que l’on pourrait établir.
Les impacts hydromorphologiques de l'arasement du seuil de Caubous sur la Garonne amont Les opérations d’effacements des ouvrages transversaux sont soutenues par la DCE depuis 2000 dans l’objectif de retrouver un bon état des cours d’eau. Il est entendu par bon état les qualités chimiques et écologiques. L’hydromorphologie est perçue comme un paramètre secondaire soutenant la qualité écologique. La DCE a été transposé dans le droit français au travers de la LEMA et des Grenelles de l’environnement qui consacrent une grande importance à la continuité écologique. Celle-ci est la mesure phare pour la restauration écologique. Ces lois prônent ainsi des opérations d’effacements d’ouvrages afin que les transit sédimentaires et faunistiques soient rétablis. L’objectif de ce travail repose sur la manière dont on pourrait appréhender les impacts hydromorphologiques à partir des hauteurs d’eau sur le seuil de Caubous. Ainsi, la présente recherche propose d’abord de saisir la manière dont l’arasement des seuils altère le fonctionnement d’un hydrosystème au travers de diverses études. Puis, nous nous sommes intéressés au changement de paradigme qu’ont induite les lois pour comprendre les raisons qui ont poussé à l’arasement du seuil de Caubous. La singularité du terrain nous a conduit à étudier le secteur d’étude sur les particularités physiques et anthropiques dont il fait l’objet. Les méthodes utilisées se basent sur des hauteurs d’eau de cinq limnimètres posés sur le bief en aval de Saint-Béat et des hauteurs d’eau de la station hydrologique de Saint-Béat. Pour étudier les limnimètres entre eux, nous avons adopté une approche quantitative aux moyens de statistiques. Les résultats laissent penser que le lit à l’aval du seuil s’est exhaussé directement après l’arasement. La zone amont présente quant à elle un abaissement de la ligne d’eau deux ans après, suggérant l’apparition d’une érosion régressive. La comparaison avec la station hydrologique a confirmé que lors de ces périodes fluctuantes, les hauteurs d’eau de Saint-Béat ne régissaient pas ou que peu les variations des hauteurs d’eau des limnimètres. Par la suite, l’approche qualitative a montré une puissance spécifique importante, déterminant de la capacité de réajustement du chenal. Les berges, très anthropisées, ne suggèrent aucun ajustement latéral. Quant à la nature des matériaux, majoritairement grossiers, soutient l’érosion verticale des lits. Finalement, on montre que les hauteurs d’eau sont un bon moyen pour appréhender les mutations hydromorphologiques suite à l’arasement d’un seuil mais nécessitent tout de même d’autres approches pour compléter et affirmer les hypothèses que l’on pourrait établir.