-
 Les élites de bourg au bas Moyen Âge: l’exemple de Castelnau-de-Montmiral
Les élites de bourg au bas Moyen Âge: l’exemple de Castelnau-de-Montmiral La présente étude tente de comprendre quelles étaient les sources de revenus et les affaires des élites rurales à la fin du Moyen Âge dans un bourg castral du nord du Tarn.
-
 Le culte de Sobek dans le Fayoum entre le III siècle avant J.-C. et le III siècle après J.-C.
Le culte de Sobek dans le Fayoum entre le III siècle avant J.-C. et le III siècle après J.-C. Ce mémoire s'intéresse à l'évolution du culte du dieu égyptien Sobek. Cette divinité crocodile, devenu Souchos après l’invasion grecque, se distingue par une multiplicité d'hypostases. Ce mémoire se centre uniquement à la région agricole du Fayoum, au nord-est du Nil, entre les périodes ptolémaïque et romaine de l'Egypte.
-
Le Code Rural byzantin : Historiographie et diffusion d'une source oubliée
Le Code Rural byzantin: Historiographie et diffusion d'une source oubliée, explique les différents travaux de recherche effectués sur cette source byzantine, de son origine a l'influence de celle-ci dans certains pays. De plus, ce mémoire explique la diffusion de ce code de loi en Europe de l'Est, pourquoi uniquement dans cette zone géographique et en partie les raisons de l'absence de ce code de loi en Europe Occidentale
-
La déesse Létô, mythes et cultes
La déesse grecque Létô est peu connue. Ceux qui se sont penchés sur elle savent qu'elle est la mère des jumeaux Apollon et Artémis, mais avait-elle ses propres fonctions? À travers l'étude des mythes et récits antiques consacrés à Létô, à travers ses représentations iconographiques, à travers son culte, quelle figure divine pouvons-nous dessiner? Cette étude vise à définir, selon une vision polythéiste, le champ d'action de la déesse, son mode d'intervention et ses liens avec les autres divinités. Nous nous attarderons plus particulièrement sur l'accouchement de Létô, à savoir la façon dont il est décrit et représenté par les auteurs antiques, cette déesse étant la seule dont l'accouchement soit relaté précisément dans les mythes.
-
Le Vaudou : pratiques religieuses des personnes de couleur dans la Nouvelle-Orléans du XIXe siècle.
Le travail présenté est un mémoire qui s’interroge sur la conception du Vaudou de la Nouvelle-Orléans, et l’opinion que les néo-orléanais blancs du XIXe siècle portent à une religion exercée par les Noirs de Louisiane. Entre admiration et diabolisation, cette étude vise à reconstituer l’évolution des pratiques magico-religieuses afro-américaines de la Nouvelle-Orléans, ainsi que l’histoire - ou la légende - qui en a découlé depuis la fin du XIXe. Questionner le Vaudou revient à étudier en premier lieu ce qu’est réellement cette religion africaine, ses origines et ses principes, ainsi que ses modifications depuis l’arrivée des personnes de descendance africaine à la Nouvelle-Orléans au début du XIXe siècle. De plus, l’opinion qui est perçue au travers des articles de presse ou des écrits d’historiens populaires blancs est à prendre en compte dans un mémoire qui étudie la perception du Vaudou par les néo-orléanais dans un temps où les États du Sud assimilaient les Noirs à des êtres sauvages et superstitieux. Au travers de mythes tels que le symbolisme du serpent ou l’importance de la veillée de la Saint Jean, il sera intéressant d’étudier la modifications de rites païens au profit de la religion chrétienne, pour être de nouveau intégrés dans la pratique du Vaudou. L’influence catholique est notamment perçue dans l’usage que Marie Laveau, grande prêtresse vaudoue de la Nouvelle-Orléans, fait des deux religions, intégrant le catholicisme dans les traditions africaines. Mais certains éléments de l’histoire de cette prêtresse ne sont pas à prendre avec considération, car ceux-ci découlent d’une légende dont Marie Laveau fait l’objet depuis plus de cent-soixante-dix ans. L’étude de cas présentée dans ce mémoire de première année cherche donc à replacer la vérité et la légende de l'histoire de cette femme, tout en étudiant avec attention la façon dont cette dernière s’est forgée en raison du regard péjoratif porté sur la religion du Vaudou.
-
D’une diplomatie à l’autre : la France face à l’émigration des Juifs soviétiques, 1966 – 1976
L’histoire de la population juive de Russie et d’URSS constitue l’une des plus difficiles à aborder compte tenu des nombreux massacres, pogroms et déportations de la fin du XIXème et de la première moitié du XXème siècle. En outre, l’interdit mémoriel qui frappe les populations juives en Russie et en Union soviétique ne joue pas en notre faveur. Bien que grandement étudiée, la situation des juifs en URSS dans cette période semble souvent réduite à des statistiques qui illustrent des mouvements de populations. Toutefois, notre étude suit un schéma original. D’une part, nous évoquons une continuité de la vision des juifs comme une population de seconde zone dont la mémoire, les aspirations culturelles, politiques et religieuses sont limitées voire interdites. Mais d’autre part, nous montrons que les revendications à l’émigration s’affirment de manière plus radicale. Ces revendications outrepassent ce qui, autrefois, semblait dissuader : la répression et l’incitation au silence.
Pour ce faire, notre étude se situe entre deux dates bien identifiées : du 25 décembre 1966 au 19 février 1975. Il est entendu que ces dates se justifient. Le 25 décembre 1966 Alexeï Kossyguine, président du conseil des ministres soviétique, affirme lors d’une conférence de presse à Paris que l’Union soviétique ne s’opposera pas à la réunion des familles juives. La seconde date correspond, elle, à la clôture de la deuxième conférence mondiale des communautés juives à Bruxelles.
Également, l’originalité du regard que nous portons sur notre sujet se trouve dans le fait qu’il s’agit d’une histoire basée non sur le point de vue juif ou soviétique, mais bien sur un point de vue extérieur : le point de vue du Quai d’Orsay. Pour ce faire, nous nous baserons sur les archives du Quai d’Orsay afin d’obtenir une somme d’évènements. Des évènements que nous analyserons, nuancerons ou complèterons avec les archives de l’Organisation des Nations Unies, de la Bibliothèque juive contemporaine, de la presse ou à l’aide de témoignages de juifs condamnés par la justice soviétique.
Sujette à libéralisation, l’émigration des juifs soviétique semble entrer en contraste avec un début des années 1970 placé sous le signe d’une répression singulièrement dirigée contre les populations juives. En effet, c’est dès l’année 1970 que le nombre de procès contre les juifs soviétiques croît pour se poursuivre tout au long de l’année 1971. Parallèlement, l’année 1971 marque les premières mesures de libéralisation dans l’émigration des juifs soviétiques. Une situation deux fers deux feux, dans laquelle le pouvoir judiciaire condamne les juifs soviétiques mais où le pouvoir politique semble amené à une courte libéralisation.
-
Répression et émigration : la question religieuse dans l'Aude de la Révolution à la Restauration (1789-1814)
Lorsque la Révolution a lieu à la fin du XVIIIe siècle, le département de l'Aude est déjà plongé dans une grave crise économique. À cette première crise viennent s'ajouter la répression des réfractaires et la guerre contre l'Espagne entre autres.
Le tissu social audois doit donc faire face aux événements révolutionnaires, avec ses prêtres réfractaires et nouveaux prêtres constitutionnels.
-
Histoire du regard médical français sur la transpiration au XIXe siècle
Ce mémoire de recherche s'attache à percevoir le poids de la transpiration dans les différentes fabriques de la race, de la classe et du sexe. Ces trois catégories forment la clé d'une analyse des dictionnaires médicaux sur la transpiration. Cette étude replace le poids du discours médical dans la construction du corps transpirant dans un contexte où de nombreuses mutations prennent place. Ce sujet d'étude s'intéresse aussi à la façon dont les médecins, par leur discours sur la transpiration, construisent les pratiques d'hygiène, les frontières corporelles et stigmatisent le corps transpirant.
-
 Recherche d’information dans un hypertexte et acceptation des tablettes, chez des élèves de cycle 3 : effets d'aperçus de contenu, d’habiletés et du sentiment d’efficacité personnelle. Une étude menée en condition écologique
Recherche d’information dans un hypertexte et acceptation des tablettes, chez des élèves de cycle 3 : effets d'aperçus de contenu, d’habiletés et du sentiment d’efficacité personnelle. Une étude menée en condition écologique Pour préparer nos futurs citoyens à vivre, travailler, exercer leurs droits et leurs devoirs, de manière autonome, dans notre société, à l’ère du numérique, il est important de développer, la littératie numérique scolaire des enfants, dès l’école primaire. Pour aller dans ce sens, les écoles sont de plus en plus équipées en matériel numérique mobile : en particulier des tablettes. Pourtant, dans la littérature scientifique, les conditions de réussite et de limite de l’usage des tablettes pour les apprentissages ne sont pas claires. Les tablettes seraient plus adaptées pour réaliser des activités de lecture que des activités d’écriture. Cependant, d’après les résultats de rares travaux menés chez des enfants, les tablettes entraveraient aussi les apprentissages en lecture, chez ceux qui ont peu d’habiletés en lecture sur papier. En même temps, les enfants ont tendance à penser que les tablettes sont utiles et faciles à utiliser, pour réaliser des activités de lecture. Il semblerait qu’ils ne se réfèrent pas à des critères objectifs pour évaluer les qualités instrumentales des tablettes. Toutefois, l’état de l’art n’est pas clair, non plus, sur cette question. Ainsi, dans cette thèse, nous avons examiné chez des enfants de fin d’école primaire, le potentiel de nouvelles variables (une carte navigable de la structure d’un hypertexte, des habiletés en lecture sur papier et le sentiment d’efficacité personnelle en lecture) à déterminer d’une part, les processus cognitifs sous-jacents à une tâche de recherche d’information dans un hypertexte lu sur une tablette et, d’autre part, l’acceptation des tablettes pour réaliser cette tâche. Les résultats ont montré que des enfants utilisent spontanément une carte navigable, alors qu’elle n’est pas imposée. Il semblerait que ce soit la fonctionnalité « navigable » qui les intéresse. En effet, les élèves n’ont quasiment pas utilisé une carte statique. Ensuite, en accord avec l’état de l’art, globalement, une carte navigable a soutenu la recherche d’information, mais cet effet était nuancé selon les types de question. Enfin, la carte navigable ne prédisait pas les perceptions vis-à-vis des qualités instrumentales de la tablette mais les perceptions vis-à-vis du matériel de lecture lu sur la tablette. Du côté des ressources internes, les résultats ont montré qu’il est important de considérer à la fois les aspects cognitifs et les aspects motivationnels. Plus précisément, les habiletés en lecture prédisaient plutôt les performances alors que le sentiment d’efficacité personnelle en lecture prédisait plutôt les perceptions de difficultés en recherche d’information et les perceptions de qualités instrumentales vis-à-vis du matériel de lecture-support de la recherche d’information. Ainsi, ces perceptions seraient en partie dues aux croyances initiales de l’élève quant à son sentiment d’efficacité personnelle à réaliser la tâche.
-
 Déchets sur partie basilaire : questions sur la matière première et la technologie de l'industrie en bois de cervidé du Magdalénien de la grotte du Mas d'Azil (Ariège, France)
Déchets sur partie basilaire : questions sur la matière première et la technologie de l'industrie en bois de cervidé du Magdalénien de la grotte du Mas d'Azil (Ariège, France) Notre étude porte sur l'industrie osseuse en bois de cervidé du Magdalénien de la grotte du Mas d'Azil (Ariège). Notre objectif est de comprendre les modalités de la production d'équipement en bois de cervidé à cette époque. Pour cela, notre travail se divise en deux parties.
Nous abordons d'abord la notion de matière première. Ici ce sont les question de sélection et d'acquisition des blocs de matière au Magdalénien qui nous intéressent.
Puis nous continuons avec la partie principale de notre recherche, qui porte sur l'étude technologique appliquée à l'industrie osseuse. Nous cherchons à comprendre comment les groupes préhistoriques du Magdalénien ont réalisé leurs équipements en bois de cervidé. Quelles méthodes, procédés et techniques ils ont utilisé et pour quoi faire.
Pour répondre à ces questions, nous basons notre étude sur un corpus de 65 déchets sur partie basilaire du Magdalénien de la grotte du Mas d'Azil. Ils sont issus des collections des époux Marthe et Saint-Just Péquart et d'André Alteirac, qui sont conservées au Musée de la Préhistoire du Mas d'Azil.
Pour confirmer les hypothèses que nous développons dans ce mémoire de master 2, nous intégrons une comparaison avec les résultats que nous avons obtenu l'année dernière, lors de notre master 1, qui porté sur l'industrie en bois de cervidé du Magdalénien de la grotte du Mas d'Azil, issue de la collection dite de Félix Régnault, conservée au Muséum d'histoire naturelle de Toulouse. Cette collection se compose de 183 pièces (déchets, supports et objets finis confondus) sur lesquelles nous nous appuyons pour étoffer les hypothèses de recherche de ce mémoire.
-
Mémoire de stage
Mémoire de stage sur les stages réalisés à la Cellule Archéologie de Toulouse Métropole sous la direction de Maïtena Sohn et à la Direction des Musées et des Monuments au musée Saint Raymond àToulouse sous la direction de Margaux Bekas.
-
L’Opération de Diagnostic en Archéologie Préventive
L'archéologie, de l'acquisition à la valorisation de la donnée
-
Emile Rivière et la reconnaissance de l'art pariétal : le rôle de La Mouthe
Alors que la reconnaissance de l'art pariétal préhistorique est au cœur des débats à la fin du XIXe siècle, l'authenticité d'un art aussi ancien et nécessitant un tel investissement n'est pas une évidence pour tous les préhistorien. La découverte de la grotte de La Mouthe (1895) par Emile Rivière est un élément décisif permettant de faire basculer les mentalités. Au cours de ce mémoire, nous avons pu mettre en évidence le rôle singulier que Rivière a pu jouer dans cette reconnaissance tout en retraçant les débats et les éléments clés de cette bataille intellectuelle.
-
Le caractère humaniste de l'oeuvre "Visages, Villages" réalisée par Agnès Varda et JR
L'oeuvre à quatre mains d'Agnès Varda et de JR, "Visages, Villages", est un film-documentaire dépeignant l'humanisme, comme on l'entend chez les photographes humanistes du XX ème siècle.
-
Le sang menstruel dans l'art contemporain : techniques et démarches artistiques (1966 - 2022)
La dernière décennie a vu le tabou entourant les règles être progressivement remis en question par le biais de sujets d'actualité tels que la précarité menstruelle, l'endométriose ou le syndrome du choc toxique. Précurseurs, les artistes se saisissent du sujet, mais également de la matière dès 1966. Ces œuvres réalisées au sang menstruel composent le corpus d'étude de ce mémoire. Indissociables de l'art menstruel, nous y traitons les notions de tabou et de honte ; proposons une typologie des supports artistiques en fonction de leur rattachement (photographie, performance) ou non (macrophotographie, peinture, sculpture, protections périodiques) au corps humain menstrué ; analysons les diverses démarches qui motivent les artistes à utiliser le sang menstruel.
-
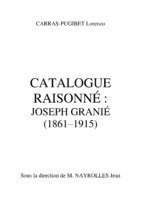 Joseph Granié (1861 - 1915), portraitiste et enlumineur de la génération symboliste
Joseph Granié (1861 - 1915), portraitiste et enlumineur de la génération symboliste Etude évoquant l'art de Joseph Granié. Nombreuses analyses abordant l'ensemble de la production de l'artiste (peinture, dessin, enluminure, illustration...). Eléments autour de la démarche de Granié et de sa pensée sur l'art. Proximités stylistiques avec des peintres de son temps, principalement symbolistes, et de grands noms du passé. Premier Catalogue raisonné. Pour une biographie détaillée de l'artiste, consulter le mémoire de M1.
-
Acquisition, traitement et restitution du mobilier archéologique
Les méthodologies employées par les opérateurs de l’archéologie préventive.
Étude des méthodologies employées par les opérateurs de l'archéologie préventive : structure, fonctionnement, attentes puis manipulation des biens archéologiques.
-
Les décors figurés peints dans les grandes demeures aristocratiques du Midi médiéval (XIVe - XVIe siècle)
Ce mémoire de recherche se concentre sur l'étude des décors figurés peints dans les pièces de vie des grandes demeures aristocratiques entre Bordeaux, Clermont-Ferrand et Montpellier. Ce mémoire de deuxième année expose une synthèse en plusieurs points sur les principales caractéristiques des peintures murales dans les châteaux. Quels sont les thèmes iconographiques représentés dans les pièces de vie de l'aristocratie ? En quoi ces décors peints sont-ils le reflet des changements des idéaux de la fin du Moyen Âge ? Et enfin, quelle place occupent les décors figurés peints dans les châteaux et comment sont-ils mis en scène ?
-
Le diagnostic archéologique : la topographie, une méthode d'enregistrement
Les diagnostics sont un aspect spécifique de l’archéologie préventive dédiés à l’évaluation du potentiel archéologique d’un site. Cet aspect particulier oblige à utiliser différentes méthodes communes à la fouille préventive et adaptées au temps limité des diagnostics. Ces techniques sont fortement axées sur les protocoles d’enregistrement des données et leur sauvegarde. Ce qui nous amène à nous poser la question suivante.
Quelles sont les méthodes d’acquisition et d’enregistrement des données en archéologie préventive dans le cadre des diagnostics et à travers la topographie ?
-
 Traditions céramiques et premières sociétés de production de la Corne de l’Afrique. Le complexe funéraire d'Antakari 3, bassin du Gobaad, République de Djibouti.
Traditions céramiques et premières sociétés de production de la Corne de l’Afrique. Le complexe funéraire d'Antakari 3, bassin du Gobaad, République de Djibouti. Outre la quantité d'inhumations découvertes à l'intérieur de la plateforme à double couronne circulaire d'Antakari, une collection céramique très décorée est à décompter parmi le mobilier associé aux sépultures. Les dates du sites sont affiliées à la période de l'introduction de l'élevage, non loin de là, sur la petite colline d'Asa Koma. Il serait alors intéressant d'étudier cette collection afin de la comparer aux productions déjà connues.
 Les élites de bourg au bas Moyen Âge: l’exemple de Castelnau-de-Montmiral La présente étude tente de comprendre quelles étaient les sources de revenus et les affaires des élites rurales à la fin du Moyen Âge dans un bourg castral du nord du Tarn.
Les élites de bourg au bas Moyen Âge: l’exemple de Castelnau-de-Montmiral La présente étude tente de comprendre quelles étaient les sources de revenus et les affaires des élites rurales à la fin du Moyen Âge dans un bourg castral du nord du Tarn. Le culte de Sobek dans le Fayoum entre le III siècle avant J.-C. et le III siècle après J.-C. Ce mémoire s'intéresse à l'évolution du culte du dieu égyptien Sobek. Cette divinité crocodile, devenu Souchos après l’invasion grecque, se distingue par une multiplicité d'hypostases. Ce mémoire se centre uniquement à la région agricole du Fayoum, au nord-est du Nil, entre les périodes ptolémaïque et romaine de l'Egypte.
Le culte de Sobek dans le Fayoum entre le III siècle avant J.-C. et le III siècle après J.-C. Ce mémoire s'intéresse à l'évolution du culte du dieu égyptien Sobek. Cette divinité crocodile, devenu Souchos après l’invasion grecque, se distingue par une multiplicité d'hypostases. Ce mémoire se centre uniquement à la région agricole du Fayoum, au nord-est du Nil, entre les périodes ptolémaïque et romaine de l'Egypte. Recherche d’information dans un hypertexte et acceptation des tablettes, chez des élèves de cycle 3 : effets d'aperçus de contenu, d’habiletés et du sentiment d’efficacité personnelle. Une étude menée en condition écologique Pour préparer nos futurs citoyens à vivre, travailler, exercer leurs droits et leurs devoirs, de manière autonome, dans notre société, à l’ère du numérique, il est important de développer, la littératie numérique scolaire des enfants, dès l’école primaire. Pour aller dans ce sens, les écoles sont de plus en plus équipées en matériel numérique mobile : en particulier des tablettes. Pourtant, dans la littérature scientifique, les conditions de réussite et de limite de l’usage des tablettes pour les apprentissages ne sont pas claires. Les tablettes seraient plus adaptées pour réaliser des activités de lecture que des activités d’écriture. Cependant, d’après les résultats de rares travaux menés chez des enfants, les tablettes entraveraient aussi les apprentissages en lecture, chez ceux qui ont peu d’habiletés en lecture sur papier. En même temps, les enfants ont tendance à penser que les tablettes sont utiles et faciles à utiliser, pour réaliser des activités de lecture. Il semblerait qu’ils ne se réfèrent pas à des critères objectifs pour évaluer les qualités instrumentales des tablettes. Toutefois, l’état de l’art n’est pas clair, non plus, sur cette question. Ainsi, dans cette thèse, nous avons examiné chez des enfants de fin d’école primaire, le potentiel de nouvelles variables (une carte navigable de la structure d’un hypertexte, des habiletés en lecture sur papier et le sentiment d’efficacité personnelle en lecture) à déterminer d’une part, les processus cognitifs sous-jacents à une tâche de recherche d’information dans un hypertexte lu sur une tablette et, d’autre part, l’acceptation des tablettes pour réaliser cette tâche. Les résultats ont montré que des enfants utilisent spontanément une carte navigable, alors qu’elle n’est pas imposée. Il semblerait que ce soit la fonctionnalité « navigable » qui les intéresse. En effet, les élèves n’ont quasiment pas utilisé une carte statique. Ensuite, en accord avec l’état de l’art, globalement, une carte navigable a soutenu la recherche d’information, mais cet effet était nuancé selon les types de question. Enfin, la carte navigable ne prédisait pas les perceptions vis-à-vis des qualités instrumentales de la tablette mais les perceptions vis-à-vis du matériel de lecture lu sur la tablette. Du côté des ressources internes, les résultats ont montré qu’il est important de considérer à la fois les aspects cognitifs et les aspects motivationnels. Plus précisément, les habiletés en lecture prédisaient plutôt les performances alors que le sentiment d’efficacité personnelle en lecture prédisait plutôt les perceptions de difficultés en recherche d’information et les perceptions de qualités instrumentales vis-à-vis du matériel de lecture-support de la recherche d’information. Ainsi, ces perceptions seraient en partie dues aux croyances initiales de l’élève quant à son sentiment d’efficacité personnelle à réaliser la tâche.
Recherche d’information dans un hypertexte et acceptation des tablettes, chez des élèves de cycle 3 : effets d'aperçus de contenu, d’habiletés et du sentiment d’efficacité personnelle. Une étude menée en condition écologique Pour préparer nos futurs citoyens à vivre, travailler, exercer leurs droits et leurs devoirs, de manière autonome, dans notre société, à l’ère du numérique, il est important de développer, la littératie numérique scolaire des enfants, dès l’école primaire. Pour aller dans ce sens, les écoles sont de plus en plus équipées en matériel numérique mobile : en particulier des tablettes. Pourtant, dans la littérature scientifique, les conditions de réussite et de limite de l’usage des tablettes pour les apprentissages ne sont pas claires. Les tablettes seraient plus adaptées pour réaliser des activités de lecture que des activités d’écriture. Cependant, d’après les résultats de rares travaux menés chez des enfants, les tablettes entraveraient aussi les apprentissages en lecture, chez ceux qui ont peu d’habiletés en lecture sur papier. En même temps, les enfants ont tendance à penser que les tablettes sont utiles et faciles à utiliser, pour réaliser des activités de lecture. Il semblerait qu’ils ne se réfèrent pas à des critères objectifs pour évaluer les qualités instrumentales des tablettes. Toutefois, l’état de l’art n’est pas clair, non plus, sur cette question. Ainsi, dans cette thèse, nous avons examiné chez des enfants de fin d’école primaire, le potentiel de nouvelles variables (une carte navigable de la structure d’un hypertexte, des habiletés en lecture sur papier et le sentiment d’efficacité personnelle en lecture) à déterminer d’une part, les processus cognitifs sous-jacents à une tâche de recherche d’information dans un hypertexte lu sur une tablette et, d’autre part, l’acceptation des tablettes pour réaliser cette tâche. Les résultats ont montré que des enfants utilisent spontanément une carte navigable, alors qu’elle n’est pas imposée. Il semblerait que ce soit la fonctionnalité « navigable » qui les intéresse. En effet, les élèves n’ont quasiment pas utilisé une carte statique. Ensuite, en accord avec l’état de l’art, globalement, une carte navigable a soutenu la recherche d’information, mais cet effet était nuancé selon les types de question. Enfin, la carte navigable ne prédisait pas les perceptions vis-à-vis des qualités instrumentales de la tablette mais les perceptions vis-à-vis du matériel de lecture lu sur la tablette. Du côté des ressources internes, les résultats ont montré qu’il est important de considérer à la fois les aspects cognitifs et les aspects motivationnels. Plus précisément, les habiletés en lecture prédisaient plutôt les performances alors que le sentiment d’efficacité personnelle en lecture prédisait plutôt les perceptions de difficultés en recherche d’information et les perceptions de qualités instrumentales vis-à-vis du matériel de lecture-support de la recherche d’information. Ainsi, ces perceptions seraient en partie dues aux croyances initiales de l’élève quant à son sentiment d’efficacité personnelle à réaliser la tâche. Déchets sur partie basilaire : questions sur la matière première et la technologie de l'industrie en bois de cervidé du Magdalénien de la grotte du Mas d'Azil (Ariège, France) Notre étude porte sur l'industrie osseuse en bois de cervidé du Magdalénien de la grotte du Mas d'Azil (Ariège). Notre objectif est de comprendre les modalités de la production d'équipement en bois de cervidé à cette époque. Pour cela, notre travail se divise en deux parties. Nous abordons d'abord la notion de matière première. Ici ce sont les question de sélection et d'acquisition des blocs de matière au Magdalénien qui nous intéressent. Puis nous continuons avec la partie principale de notre recherche, qui porte sur l'étude technologique appliquée à l'industrie osseuse. Nous cherchons à comprendre comment les groupes préhistoriques du Magdalénien ont réalisé leurs équipements en bois de cervidé. Quelles méthodes, procédés et techniques ils ont utilisé et pour quoi faire. Pour répondre à ces questions, nous basons notre étude sur un corpus de 65 déchets sur partie basilaire du Magdalénien de la grotte du Mas d'Azil. Ils sont issus des collections des époux Marthe et Saint-Just Péquart et d'André Alteirac, qui sont conservées au Musée de la Préhistoire du Mas d'Azil. Pour confirmer les hypothèses que nous développons dans ce mémoire de master 2, nous intégrons une comparaison avec les résultats que nous avons obtenu l'année dernière, lors de notre master 1, qui porté sur l'industrie en bois de cervidé du Magdalénien de la grotte du Mas d'Azil, issue de la collection dite de Félix Régnault, conservée au Muséum d'histoire naturelle de Toulouse. Cette collection se compose de 183 pièces (déchets, supports et objets finis confondus) sur lesquelles nous nous appuyons pour étoffer les hypothèses de recherche de ce mémoire.
Déchets sur partie basilaire : questions sur la matière première et la technologie de l'industrie en bois de cervidé du Magdalénien de la grotte du Mas d'Azil (Ariège, France) Notre étude porte sur l'industrie osseuse en bois de cervidé du Magdalénien de la grotte du Mas d'Azil (Ariège). Notre objectif est de comprendre les modalités de la production d'équipement en bois de cervidé à cette époque. Pour cela, notre travail se divise en deux parties. Nous abordons d'abord la notion de matière première. Ici ce sont les question de sélection et d'acquisition des blocs de matière au Magdalénien qui nous intéressent. Puis nous continuons avec la partie principale de notre recherche, qui porte sur l'étude technologique appliquée à l'industrie osseuse. Nous cherchons à comprendre comment les groupes préhistoriques du Magdalénien ont réalisé leurs équipements en bois de cervidé. Quelles méthodes, procédés et techniques ils ont utilisé et pour quoi faire. Pour répondre à ces questions, nous basons notre étude sur un corpus de 65 déchets sur partie basilaire du Magdalénien de la grotte du Mas d'Azil. Ils sont issus des collections des époux Marthe et Saint-Just Péquart et d'André Alteirac, qui sont conservées au Musée de la Préhistoire du Mas d'Azil. Pour confirmer les hypothèses que nous développons dans ce mémoire de master 2, nous intégrons une comparaison avec les résultats que nous avons obtenu l'année dernière, lors de notre master 1, qui porté sur l'industrie en bois de cervidé du Magdalénien de la grotte du Mas d'Azil, issue de la collection dite de Félix Régnault, conservée au Muséum d'histoire naturelle de Toulouse. Cette collection se compose de 183 pièces (déchets, supports et objets finis confondus) sur lesquelles nous nous appuyons pour étoffer les hypothèses de recherche de ce mémoire.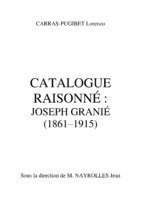 Joseph Granié (1861 - 1915), portraitiste et enlumineur de la génération symboliste Etude évoquant l'art de Joseph Granié. Nombreuses analyses abordant l'ensemble de la production de l'artiste (peinture, dessin, enluminure, illustration...). Eléments autour de la démarche de Granié et de sa pensée sur l'art. Proximités stylistiques avec des peintres de son temps, principalement symbolistes, et de grands noms du passé. Premier Catalogue raisonné. Pour une biographie détaillée de l'artiste, consulter le mémoire de M1.
Joseph Granié (1861 - 1915), portraitiste et enlumineur de la génération symboliste Etude évoquant l'art de Joseph Granié. Nombreuses analyses abordant l'ensemble de la production de l'artiste (peinture, dessin, enluminure, illustration...). Eléments autour de la démarche de Granié et de sa pensée sur l'art. Proximités stylistiques avec des peintres de son temps, principalement symbolistes, et de grands noms du passé. Premier Catalogue raisonné. Pour une biographie détaillée de l'artiste, consulter le mémoire de M1. Traditions céramiques et premières sociétés de production de la Corne de l’Afrique. Le complexe funéraire d'Antakari 3, bassin du Gobaad, République de Djibouti. Outre la quantité d'inhumations découvertes à l'intérieur de la plateforme à double couronne circulaire d'Antakari, une collection céramique très décorée est à décompter parmi le mobilier associé aux sépultures. Les dates du sites sont affiliées à la période de l'introduction de l'élevage, non loin de là, sur la petite colline d'Asa Koma. Il serait alors intéressant d'étudier cette collection afin de la comparer aux productions déjà connues.
Traditions céramiques et premières sociétés de production de la Corne de l’Afrique. Le complexe funéraire d'Antakari 3, bassin du Gobaad, République de Djibouti. Outre la quantité d'inhumations découvertes à l'intérieur de la plateforme à double couronne circulaire d'Antakari, une collection céramique très décorée est à décompter parmi le mobilier associé aux sépultures. Les dates du sites sont affiliées à la période de l'introduction de l'élevage, non loin de là, sur la petite colline d'Asa Koma. Il serait alors intéressant d'étudier cette collection afin de la comparer aux productions déjà connues.