-
 Impacts du changement climatique sur la pratique et le comportement des alpinistes amateurs : une approche qualitative
Impacts du changement climatique sur la pratique et le comportement des alpinistes amateurs : une approche qualitative Ce mémoire se concentre sur l’impact du changement climatique sur la pratique et le comportement des alpinistes amateurs. Il s’inscrit dans un contexte de transformation rapide que les montagnes subissent, attribuées au réchauffement climatique, notamment le retrait des glaciers, la fonte du pergélisol (ou permafrost) et la diminution de l’enneigement. Ces phénomènes bouleversent non seulement les paysages mais aussi les conditions dans lesquelles les alpinistes évoluent, rendant certaines pratiques plus dangereuses et incitant les pratiquants à s’adapter.
L’objectif est de mener une réflexion approfondie sur comment les alpinistes amateurs adaptent leurs pratiques face à ces changements, en s’intéressant particulièrement à leurs perceptions individuelles, leurs motivations profondes, et leur expérience. Le mémoire s’appuie sur une analyse qualitative des entretiens menés avec 30 participants et sur les conclusions de Salim et al. (2023) dans leur article adoptant une approche quantitative, pour construire une approche plus nuancée des réponses comportementales. Les dimensions abordées sont donc l’expérience, les motivations, les perceptions, et comment elles influent sur la pratique et les comportements d’adaptation adoptées par les alpinistes amateurs. L’exploration de la variabilité entre les individus et la différence de contexte conduira cette analyse, afin de comprendre les éléments sous-jacents, les conduisant à faire des choix.
-
 Agriculture et collectivités locales : Le rôle des EPCI dans l'accompagnement et le developpement de l'activité agricole.
Le cas de la communauté d'agglomération Pays Foix-Varilhes.
Agriculture et collectivités locales : Le rôle des EPCI dans l'accompagnement et le developpement de l'activité agricole.
Le cas de la communauté d'agglomération Pays Foix-Varilhes. Mémoire de licence professionnelle, dans le cadre d'un stage au sein de l'agglo Foix-Varilhes.
Réalisation d'un observatoire des exploitations agricoles du territoire, afin de connaître l'activité, recenser les besoins et projets, afin de déterminer les axes de développement dans la stratégie de l'agglo.
-
 Un atlas de la biodiversité sur le Grand Parc de l’Hers (Toulouse Métropole, Haute-Garonne)
Étude de faisabilité
Un atlas de la biodiversité sur le Grand Parc de l’Hers (Toulouse Métropole, Haute-Garonne)
Étude de faisabilité Toulouse Métropole a engagé ces dernières années la création de cinq grands parcs métropolitains, tous adossés à la trame verte et bleue. Ces parcs ont pour ambition d’être de véritables axes verts sur le territoire. Ils viennent répondre à des enjeux de sobriété foncière, d’adaptation au changement climatique, de préservation de la biodiversité, d’accès des habitants à la nature et de conciliation des usages.
La démarche Atlas de la biodiversité, déployée par l’Office Français de la Biodiversité sous la forme d’appel à projet, constitue un outil permettant de répondre à plusieurs de ces enjeux.
A l’image d’un laboratoire, le Grand Parc de l’Hers est le premier des cinq grands parcs à affirmer, au travers son plan d'action, la volonté de mettre en œuvre un atlas de la biodiversité. Cette démarche prévoit l’implication des 13 communes de son périmètre, toutes situées sur un linéaire de près de 30 km, le long de l’Hers et ses affluents.
Afin d’étudier la faisabilité d’un tel projet, ont été recueillis les retours d'expérience de trois territoires français ayant réalisé des atlas de la biodiversité à l’échelle de plusieurs communes. Des échanges avec 12 des 13 communes du Grand Parc de l’Hers ont également été organisés afin de mieux définir les contours de cet atlas.
Les résultats de ce travail apportent un éclairage riche pour aider Toulouse Métropole à s’organiser sur la mise en œuvre de cette action prévue au plan d’actions du Grand Parc de l'Hers : consulter les communes dès la préparation, identifier les partenaires, établir la gouvernance, établir un rétro-planning, co-construire avec les communes des axes thématiques fédérateur et bien calibrer le financement. Ainsi monté, l’atlas permettrait de fédérer le territoire autour de la biodiversité grâce à la mobilisation de ces divers acteurs, et apporterait une meilleure connaissance de l’état des écosystèmes, dans le but à la fois de préserver et restaurer la qualité biologique, et de développer des usages compatibles avec les enjeux écologiques. Cet atlas constituerait enfin un outil partagé de discussion et d’aide à la décision dont les connaissances pourraient être incluses aux politiques publiques et utilisées pour adapter les aménagements.
-
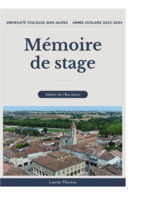 Construction d'une ressourcerie sur Fleurance
Construction d'une ressourcerie sur Fleurance Ce mémoire parle de pourquoi la mairie de Fleurance projette de réaliser une ressourcerie sur son territoire.
Et de comment moi stagiaire en licence pro ADEL est pu les aider
-
 Sensibiliser au réchauffement climatique dans la vallée de Chamonix : les glaciers comme supports de médiation.
Sensibiliser au réchauffement climatique dans la vallée de Chamonix : les glaciers comme supports de médiation. Connaître, protéger, gérer et partager : ce sont les quatre missions des réserves naturelles des Aiguilles Rouges. C’est donc au sein de l’ARNAR, l’Association des Réserves Naturelles des Aiguilles Rouges que j’ai pu contribuer à la mission de « partage ». Ici, le partage signifie faire le lien entre les experts scientifiques et le grand public. Il s’agit de transmettre les informations, de mettre en valeur les travaux scientifiques existants et d’amener le public a faire évoluer sa réflexion sur différents sujets. Cette mission de médiation et de sensibilisation est absolument nécessaire : si elle n’est pas effectuée, les nombreux travaux menés par les chercheurs ne trouvent pas d’application dans la société et restent des recherches théoriques. C’est pourquoi, au chalet du col des Montets et au sommet du Brévent, deux sites gérés en partie par l’ARNAR, ont lieu des animations et des visites de sentiers visant à aborder des sujets environnementaux. En s’appuyant sur des connaissances scientifiques et sur l’observation du paysage, nous souhaitons amener les visiteurs des deux sites à réfléchir sur ce qui les entoure et à comprendre le fonctionnement des milieux montagnards.
Parmi les grands enjeux environnementaux actuels, le réchauffement climatique est celui qui impacte le plus à la fois les sociétés humaines et les écosystèmes. De nombreuses recherches sont menées sur le sujet, notamment par le GIEC : le Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat. Pourtant, on ne voit pas émerger d’actions significatives visant à ralentir ce phénomène. Pire, la responsabilité humaine dans ce processus est de moins en moins reconnue par la population mondiale. Face à cette situation, qui nécessite une prise de conscience et un changement de modes de consommation, il est important de mettre en place des moyens de sensibilisation puissants.
Travailler sur ce sujet dans les montagnes est tout a fait pertinent car c’est un milieu qui subit particulièrement les conséquences du réchauffement climatique. Alors que la France a gagné au total 1,4 degrés au 20e siècle, les Alpes et les Pyrénées se sont réchauffées de 2 degrés sur cette période (source : Météo France). Ce réchauffement affecte grandement à la fois le tourisme, les écosystèmes, les paysages et augmente les risques en montagne. La vallée de Chamonix en est un bon exemple : encaissée entre deux versants, et surplombée par les glaciers, elle fonctionne grâce à son attractivité touristique, aujourd’hui menacée. Dans ce mémoire, nous allons essayer de tirer profit de cette attractivité touristique pour sensibiliser un grand nombre de personnes aux enjeux climatiques via des supports pédagogiques naturels : les glaciers.
-
 Comment, dans un contexte de réchauffement climatique, accompagner les entreprises à enclencher et pérenniser une démarche d’économie d’eau ?
Comment, dans un contexte de réchauffement climatique, accompagner les entreprises à enclencher et pérenniser une démarche d’économie d’eau ? Nous vivons dans un contexte de changement climatique et à ce titre, l'eau sa gestion et son économie est un sujet d'enjeu majeur pour le monde de demain. Ce sujet doit être pris en compte par tout le monde y compris les entreprises. La CCI est un acteur majeur de l'accompagnement des entreprises, elle oeuvre pour le développement économique local. A ce titre la CCI des Pays de la Loire, territoire fortement impacté par le changement climatique sur la ressource en eau propose des dispositifs d'aide pour enclencher une démarche d'économie d'eau aux entreprises des Pays de la Loire.
-
 Les réseaux de sentiers d'interprétations peuvent-ils créer une offre touristique harmonisée pour le public et les habitants ?
Les réseaux de sentiers d'interprétations peuvent-ils créer une offre touristique harmonisée pour le public et les habitants ? Le département de l'Allier souhaite développer son attraction touristique et pour ce faire, la diversité de ces dernières est nécessaire. Voici l'exemple d'un outil très important qui participe à ce développement.
-
Désignation d’Unités de Gestion ayant vocation à participer à la Stratégie Nationale des Aires Protégées, sur les forêts domaniales de l’Aude (11), l’Ariège (09), et les Pyrénées-Orientales (66)
Pour respecter ses engagements afin de protéger la biodiversité, le gouvernement Français a décidé qu’en 2030, 10 % du territoire français serait sous protection forte, et ne subirait donc plus d’intervention humaine directe. Pour accomplir cela l’État met en place la Stratégie Aires Protégées (SAP), portée notamment par le Ministère de la Transition écologique, en partenariat
avec le Ministère de la Mer. Les forêts domaniales étant des propriétés de l’État, 10 % de leur surface au minimum devront donc être sous protection forte en 2030 pour participer à la SAP, ce qui implique de rajouter environ 50 000 ha de zones de protection à celles déjà existantes.
L’Agence de l’ONF de l’Ariège l’Aude et les Pyrénées-Orientales (09-11-66), gère 88 forêts domaniales, totalisant environ 148 388 ha, dont environ 9 000 sont déjà sous protection forte.
Pour être classées, les forêts ne doivent pas subir de pression anthropique significative, c’est à dire du pâturages, des aménagement (ligne électriques, captages, bâti RTM…), ou de la production sylvicole. Pour savoir quelles zones sont éligibles selon ces critères, un lourd travail de cartographie et de consultations des forestiers a été faite.
Au vu des investigations réalisées, 11 186 ha de forêts domaniales sont éligibles au titre de la SAP, en plus des zones de protections forte déjà existante. Ainsi, l’Agence devrait donc pouvoir protéger au moins 13,57 % de ses forêts domaniales, c’est-à-dire plus que ce qui lui est demandé. Ces surfaces ont étés compilées dans un atlas cartographique en annexe A, B et C de ce rapport.
-
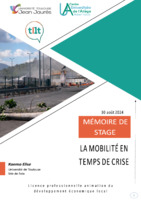 La mobilité en temps de crise
La mobilité en temps de crise Ce mémoire analyse l'impact de la crise sur la mobilité urbaine à Nouméa suite à l'arrêt des transports publics, révélant des vulnérabilités et accentuant les inégalités sociales. Il propose des solutions telles que le covoiturage et les navettes maritimes pour améliorer la résilience du système de transport, soulignant la nécessité d'une meilleure coordination et d'un cadre réglementaire adapté. L'objectif est de développer un système de mobilité plus durable et flexible pour répondre aux besoins des habitants, même en situation de crise.
-
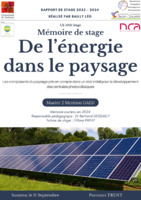 De l'énergie dans le paysage : Les composants du paysage pris en compte dans un état initial pour le développement des centrales photovoltaïque
De l'énergie dans le paysage : Les composants du paysage pris en compte dans un état initial pour le développement des centrales photovoltaïque Ce mémoire examine les méthodes d'identification et de caractérisation des critères de remarquabilité
paysagère, dans le cadre d'un état initial, pour le développement de centrales solaire. Le contexte actuel de
transition énergétique impose la mise en place de nouvelles infrastructures, telles que les centrales
photovoltaïques, dans des zones variées, souvent rurales. Cette démarche soulève des enjeux en termes
d'intégration paysagère, nécessitant une analyse afin de minimiser les impacts visuels.
Ce dossier met en avant l'importance de plusieurs éléments clés dans cette évaluation. La topographie est un
facteur déterminant : les points hauts à proximité du site peuvent accroître la visibilité des installations,
tandis que les points bas, souvent associés à des cours d'eau, sont généralement moins visibles. Les cours
d'eau, en plus de modeler la topographie, sont souvent bordés par une strate arborée qui peut jouer un rôle
en masquant partiellement les infrastructures, limitant ainsi leur impact visuel. L'occupation des sols est un
autre aspect essentiel à considérer. Les types de cultures présents sur un territoire influencent directement la
visibilité des panneaux photovoltaïques. De plus, la présence de zones bâties à proximité peut introduire des
points de vue supplémentaires vers le site, augmentant l'impact visuel des centrales.
La prise en compte du patrimoine protégé est également fondamentale. Les sites classés ou inscrits exigent
une attention particulière pour éviter de compromettre leur intégrité visuelle. L'analyse de la proximité de
ces sites par rapport au projet de nouvelles infrastructures photovoltaïques est importante afin de respecter
les contraintes légales et préserver la valeur patrimoniale des paysages concernés. Enfin, l'étude souligne
l'importance de l'analyse de la visibilité, notamment à partir de points de vue identifiés comme significatifs
pour la population locale. Cette démarche vise à anticiper et préconiser des moyens de limiter les perceptions.
Ceci dans l’optique de prévenir les potentielles réactions négatives des habitants et visiteurs face aux
nouvelles installations, en veillant à préserver les qualités esthétiques et culturelles du paysage.
L'analyse globale menée dans ce mémoire montre que l'intégration des centrales photovoltaïques dans le
paysage nécessite une approche multidimensionnelle, combinant des aspects topographiques, écologiques,
et patrimoniaux pour minimiser leur impact tout en répondant aux besoins de la transition énergétique.
-
Le socio-écosystème de la Réserve naturelle des Hauts de Chartreuse face au changement climatique (Isère, Savoie)
Les effets du changement climatique commencent à s’observer sur les Hauts de Chartreuse, un
territoire de montagne classé en réserve naturelle nationale (RNNHC) situé dans les Pré-Alpes
calcaires du Nord. Ces effets se manifestent notamment à travers la baisse du niveau de glace dans
les glacières souterraines et les demandes de stockage d’eau supplémentaire ou de réfection de
captages d’eau préexistants sur les alpages. Face à ces constats, la RNNHC se saisit de la
méthodologie issue du projet LIFE Natur’Adapt (LNA), destinée aux gestionnaires d’aires protégées
qui souhaitent se lancer dans une démarche prospective. Le stage se concentre sur l’étape de
l’analyse prospective, qui consiste à réaliser un récit climatique qui dresse les grandes trajectoires
du climat passé, présent et futur et une analyse de vulnérabilité et d’opportunité du patrimoine
naturel, des activités humaines et des outils et moyens de gestion de la RNNHC. Ce diagnostic de
vulnérabilité et d’opportunité (DVO) est alimenté par des recherches bibliographiques et la
mobilisation des acteurs techniques, scientifiques et du tourisme. Dans la continuité des tendances
déjà mesurées, les modèles climatiques visualisés projettent une augmentation des températures,
une diminution de l’enneigement et une stagnation relative des cumuls de précipitations en
Chartreuse (1500 m) à horizon lointain (2071-2100). Ces évolutions climatiques et d’autres sources
de pression font émerger des vulnérabilités sur le site. Les usages écosystémiques et humains de
l’eau sont menacés par le tarissement de certaines sources en été. La forte variabilité des
conditions météorologiques d’une année à l’autre sort du domaine de flexibilité des éleveurs et les
forêts sont exposées de façon accentuée aux sécheresses et à l’attaque de parasites. De façon
moins importante, des opportunités peuvent émerger en lien avec le changement climatique.
L’allongement de la période clémente dans l’année est favorable aux suivis scientifiques, aux
activités de plein air et à la remontée de certaines espèces en altitude. Cependant, les
opportunités pour certains éléments du socio-écosystème peuvent devenir des sources de
vulnérabilité pour d’autres. L’accès facilité au site en hiver et la concentration de la fréquentation
humaine vers les périodes d’intersaison sont susceptibles d’accentuer le dérangement des espèces.
Eux-mêmes sensibles aux évolutions climatiques, les outils et moyens de gestion de la RNNHC
devraient connaître des modifications. Celles-ci se manifesteraient par un accroissement de la
pression de surveillance lors des périodes d’intersaison et à travers la création de nouveaux outils
pédagogiques. La perspective de la mission du stage est le partage du DVO sous différentes formes
auprès de l’équipe de l’aire protégée, des acteurs mobilisés et du public.
-
 Les enjeux socio-écologiques des mares et lavognes sur les causses méridionaux héraultais et gardois.
Les enjeux socio-écologiques des mares et lavognes sur les causses méridionaux héraultais et gardois. Les mares et les lavognes sont des petits points d’eau naturels ou façonnés par les humains que l’on trouve sur les causses. Souvent oubliées ou négligées par leur petite taille, ces écosystèmes sont pourtant des oasis de biodiversité dans un contexte géologique karstique pauvre en eau. Les mares présentent sur les petites causses méridionaux ont pour certaines la spécificité d’être temporaires avec une alternance de phases d’assec et de phases inondées. Certaines sont même . Ces conditions donnent lieu à une biodiversité spécifique inféodée qui a un cycle de vie adapté.
Étant des milieux petits et isolés, les mares et les lavognes sont des écosystèmes fragiles. Ils sont liés au pâturage et sont voués à disparaître par comblement au cours du temps sans l’intervention humaine. Cependant, ces interventions doivent être limitées aux nécessaire et réaliser à la bonne période afin de préserver la biodiversité. Il est donc important de connaître les mares pour savoir les gérer de manière efficace. C’est dans cette optique là que mon stage s’intègre en recueillant des témoignages de personnes du territoire et ainsi réaliser un livret sur l’entretien des mares et lavognes qui répondent aux besoins du territoire.
-
 Coexistence et confrontation des exploitations bio et non-bio dans le Conflent, Pyrénées-Orientales
Coexistence et confrontation des exploitations bio et non-bio dans le Conflent, Pyrénées-Orientales Ce mémoire est le fruit d’un stage de recherche portant sur la question de la coexistence et de la confrontation entre les exploitations bio et non-bio au sein du territoire du Conflent.
Le stage a été encadré conjointement par l'INRAE et la Communauté de communes Conflent Canigó, s'inscrivant dans le cadre du projet de recherche DEFIBIO, qui explore les dynamiques de l'Agriculture Biologique en Occitanie face aux nouveaux défis actuels (réduction de la consommation, ralentissement des conversions, augmentation des coûts de production, impact du changement climatique, etc.).
Durant ce stage, un travail de recherche a été mené sur la question de la coexistence entre l'agriculture biologique et non-biologique dans le territoire du Conflent, qui connaît une croissance significative du secteur biologique depuis 2010 et présente une grande diversité de pratiques et de modèles agricoles. Ce territoire constitue ainsi un cas d'étude pertinent pour analyser une variété de dynamiques et d'interactions entre pratiques biologiques et non-biologiques.
La méthodologie adoptée au cours de ce stage est une analyse qualitative fondée sur des recherches bibliographiques ainsi que les résultats de vingt-neuf entretiens semi-directifs réalisés au cours du stage auprès d’agriculteurs du Conflent.
L'étude aborde la problématique suivante : Comment la coexistence des exploitations agricoles biologiques et non-biologiques dans le territoire du Conflent se caractérise-t-elle et quels sont ses enjeux sur les dynamiques agricoles contemporaines locales ?
Cette étude révèle une riche diversité de trajectoires, de pratiques et de stratégies, qui caractérisent et témoignent de la complexité des dynamiques agricoles au sein de ce territoire. La coexistence bio / non-bio se joue principalement autour de la question de l’accès et du partage d'une diversité de ressources, renforcée par des dynamiques de filière et une proximité spatiale entre agriculteurs. Au-delà de la coexistence bio / non-bio, d'autres types d'interactions, notamment entre diverses filières agricoles et modèles de production, jouent un rôle déterminant dans la structuration du paysage agricole du Conflent.
-
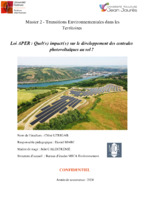 Loi APER : Quel(s) impact(s) sur le développement des centrales photovoltaïques au sol ?
Loi APER : Quel(s) impact(s) sur le développement des centrales photovoltaïques au sol ? Ce mémoire explore l'impact de la loi relative à l'accélération de la production des énergies renouvelables (loi APER), adoptée en mars 2023, sur le développement des centrales photovoltaïques au sol en France. Cette législation vise à simplifier les procédures administratives et à favoriser un déploiement rapide des projets photovoltaïques, essentiels dans le contexte de la transition énergétique. L'analyse se concentre sur la capacité de la loi à encourager l'expansion des centrales photovoltaïques au sol dans le but de répondre aux ambitions énergétiques nationales. En évaluant les mécanismes mis en place par la loi et leur influence sur le rythme de mise en œuvre des projets, ce travail cherche à déterminer si cette législation peut réellement permettre à la France de progresser vers ses objectifs climatiques à long terme.
-
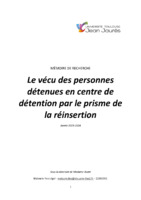 Le vécu des personnes détenues en centre de détention par le prisme de la réinsertion.
Le vécu des personnes détenues en centre de détention par le prisme de la réinsertion. Au 1er juillet 2024, 78 509 personnes étaient détenues dans les établissements
pénitentiaires français, pourtant ces individus sont très peu connus. Les travaux et réflexions
menés sur ces institutions, notamment en sociologie, centrent leur propos sur les
établissements, leurs règles et leurs fonctions. Le vécu de l’expérience carcérale, essentiel
pour comprendre dans son ensemble le principe d’enfermement et d’incarcération, est mis
de côté. Par conséquent, l’acteur de la détention, la personne détenue, n’est pas considérée,
or c’est elle qui est au centre des stratégies et des démarches pour accueillir au mieux sa peine
et sa réinsertion. Vivre enfermé entre des murs n’est pas anodin, pourtant la violence qu’est
l’incarcération est mise sous silence. Ainsi, avec la réalisation d’un terrain de recherche au sein
du centre de détention de Châteaudun, cette étude a pour objectif d’apporter une analyse du
vécu de l’enfermement et de l’incarcération dans ces établissements, par le prisme de la
réinsertion. Il sera question de s’intéresser aux prisons, entendues comme des institutions
totalitaires du fait de leursrôle d’appareil à transformer les individus, leurforme de « privation
de liberté » et leurs règles dictées par l’administration pénitentiaire. Cela conduira à se
demander comment les individus détenus pour des périodes plus ou moins longues vivent
entre les murs de ces institutions.
-
 Etude de l'articulation entre les coopérations locales et les politiques publiques agricoles sur le territoire du Nord-Comminges
Etude de l'articulation entre les coopérations locales et les politiques publiques agricoles sur le territoire du Nord-Comminges L’objet du stage s’intègre au projet COTERRA (Repenser les COllectifs agricoles dans leurs TERRitoires pour plus d’Autonomie) et vise à identifier les différentes modalités de coopérations entre agriculteurs présentes sur le territoire du Nord Comminges, au
travers d’une étude ethnographique. Ces dernières englobent des réalités très diverses, plus ou moins formelles, basées sur de l’échange de biens matériels ou immatériels, comme du temps de travail ou du partage de connaissances. Elles peuvent ainsi porter sur du prêt ou de l’achat de matériel en CUMA, des dispositifs de commandes groupées, de l’achat de fourrages entre agriculteurs ou du troc, des coups de main et autres échanges de bons procédés, etc. Mobilisant la recherche d’autonomie comme cadre théorique, l’analyse de l’articulation de ces formes de coopération avec les politiques publiques agricoles entend
saisir les freins et leviers, du point de vue des agriculteurs et d’autres acteurs du monde agricole, à l’émergence de formes de coopération agricole et d’identifier les compromis qui sont négociés dans le cadre de processus d’autonomisation collective. Ce travail a ainsi pour ambition de contribuer à une meilleure prise en compte de ces modalités de coopérations par les dispositifs actuels afin de soutenir ces démarches collectives, favorables à l’autonomie des agriculteurs et au développement de pratiques agroécologiques.
-
 Les maisons individuelles de la métropole nantaise dans un contexte de zéro artificialisation nette
Les maisons individuelles de la métropole nantaise dans un contexte de zéro artificialisation nette Nantes Métropole s'est fixé l'objectif ambitieux d'atteindre le Zéro Artificialisation Nette à l'horizon 2030. Pour y parvenir, la métropole, en raison de son histoire, possède une grande quantité de maisons individuelles, considérés comme des espaces potentiellement mutables. Dans le cadre de mon stage de six mois au sein de la Direction Stratégie et Territoire, j'ai réalisé un diagnostic approfondi de ces quartiers en m'appuyant sur une analyse morphologique et géomatique. Celle-ci visait à caractériser ces espaces en termes de proximité aux centralités, de couverture végétale, de typologie des tissus urbains et de densité. L'objectif de cette analyse était d'identifier les enjeux spécifiques et territoriaux associés à ces quartiers, afin de déterminer les secteurs stratégiques pour l'avenir, que ce soit en matière de renouvellement urbain ou de préservation des espaces naturels.
L'analyse a révélé une forte présence de maisons pavillonnaires construites entre les années 1960 et 1980, caractérisées par une grande proportion de sols perméables mais une faible diversité végétale. En revanche, les maisons plus anciennes, situées à proximité des centralités, sont plus denses et permettent de maintenir une végétation diversifiée dans des environnements plus fragiles. Avec le développement des transports en commun, certains de ces quartiers pavillonnaires situés en périphérie de Nantes semblent offrir un potentiel intéressant pour une densification mesurée, sans compromettre la qualité de vie des habitants.
-
 La stratégie de valorisation du Crémant de Loire
La stratégie de valorisation du Crémant de Loire La stratégie de valorisation du Crémant de Loire repose sur plusieurs axes clés. D'abord, elle met en avant l'identité patrimoniale du vin, soulignant son lien avec le terroir unique du Val de Loire, notamment grâce à l'utilisation de tuffeau dans les caves. Ensuite, la stratégie vise à renforcer la reconnaissance du Crémant de Loire par rapport à la référence prestigieuse comme le Champagne, en promouvant ses caractéristiques distinctives et son savoir-faire artisanal. L'attractivité touristique de la région joue également un rôle central, avec des initiatives pour intégrer le Crémant de Loire dans l'œnotourisme, en développant des expériences de dégustation et des visites de caves. Parallèlement, des efforts sont déployés pour améliorer la visibilité du Crémant de Loire dans les restaurants et les événements, ainsi que pour renforcer la communication sur ses atouts.
-
 L'évolution hydrologique du bassin-versant du Caillan sur la vallée de Nohèdes et de Conat
L'évolution hydrologique du bassin-versant du Caillan sur la vallée de Nohèdes et de Conat Depuis 2009, la réserve naturelle nationale de Nohèdes réalise tous les ans des stages sur le bilan hydrique sur le bassin-versant du Caillan dans la vallée de Nohèdes et Conat. La volonté de la structure à travers ces stages, est d’apprendre sur le fonctionnement du cours d’eau et son bassin-versant. De 2019 à 2024, le stage n’est pas reprogrammé et des tempêtes ont lieu sur le territoire. Des changements sont survenus sur le bassin-versant depuis ces épisodes. Ce rapport veut montrer l’évolution hydrologique du Caillan et de son bassin-versant de la vallée de Nohèdes à Conat. La présence d’une zone karstique sur une partie du territoire permet de réduire la quantité d’eau que la rivière peut recevoir à cause des infiltrations sur cette zone. Les débits enregistrés depuis 2009 permettent d’avoir un début de tendance sur la baisse des écoulements. Les courbes de tarage indiquent depuis Gloria en 2020, un changement de dynamique sur la rivière. Un écart est présent entre les débits calculés depuis 2020 et ceux effectués avant. Cette étude met en lien le territoire avec le changement climatique. La hausse des températures et le changement de répartition par saison et la variabilité des précipitations tendent à diminuer les débits du Caillan. La réduction de la quantité et de la durée du manteau neigeux aide aussi dans ce sens. De plus, l’assèchement des sols impacte les différentes zones humides présentes sur le territoire. Ce phénomène diminue en même temps, le niveau piézométrique de la nappe phréatique sur la partie karstique changeant les échanges entre le cours d’eau et le karst. Par conséquent, le Caillan est marqué par un changement en 2020. On observe qu’une évolution progressive en lien avec le changement climatique se déroule. Cette tendance est significative, car la présence de la ressource en eau sur le bassin-versant va diminuer d’ici 2050. Une réunion entre tous les habitants et les acteurs de la vallée est nécessaire afin d’établir un plan de gestion de la ressource en eau.
-
 La mise en œuvre du Bail Réel Solidaire en Martinique
La mise en œuvre du Bail Réel Solidaire en Martinique Ce mémoire explore la mise en place du Bail Réel Solidaire (BRS) en Martinique, un territoire insulaire confronté à des contraintes foncières importantes et une histoire socio-culturelle complexe. L'étude s'appuie sur une expérience de stage au sein de l'Établissement Public Foncier Local (EPFL) de Martinique, offrant une immersion concrète au sein des enjeux liés au logement social sur l'île.
Le BRS, inspiré du modèle du Community Land Trust américain, vise à faciliter l'accès à la propriété pour les ménages modestes en dissociant le foncier du bâti. Son application en Martinique, portée par l'Organisme de Foncier Solidaire (OFS) de l’île, s'inscrit dans une volonté de dynamiser le territoire et de diversifier l'offre de logement social.
Le contexte martiniquais présente des défis spécifiques, notamment le phénomène d'indivision qui touche près de 40% du foncier. Bien que le BRS ne puisse résoudre entièrement cette problématique, il pourrait contribuer à sa diminution à long terme.
Le BRS pourrait constituer un levier de développement local, s'alignant avec la stratégie de l'EPFL de mobilisation foncière. Son application dans les Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville (QPV) pourrait favoriser la mixité sociale et la redynamisation urbaine. Il pourrait également être un outil de mise en œuvre du PLH des Communautés d’Agglomérations, notamment en les aidant à rééquilibrer le profil démographique de celles confrontées au vieillissement de la population, par exemple.
Cependant, la réussite du BRS nécessite une mobilisation à long terme des acteurs locaux. En effet, l’histoire socio-culturelle de l’île étant complexe et l’aspiration à la propriété étant profondément ancrée dans la culture martiniquaise, un important travail de sensibilisation et de pédagogie auprès de la population sera nécessaire. La collaboration entre les différentes collectivités sera cruciale pour assurer une mise en œuvre cohérente et efficace du dispositif.
L'OFS de Martinique jouera donc un rôle central dans l'adaptation du modèle aux spécificités locales. Des revendications d’adaptations spécifiques au territoire ont déjà émergé, comme la mise en place d'un crédit d'impôt. La collaboration avec d'autres OFS ultramarins permettra de partager les expériences et d'adapter le modèle aux contextes spécifiques des territoires d'outre-mer.
Par la prise en compte de ces enjeux, la mise en place du BRS en Martinique pourrait donc être une opportunité de concilier les aspirations à l'accession à la propriété des Martiniquais avec les contraintes foncières et économiques du territoire.
 Impacts du changement climatique sur la pratique et le comportement des alpinistes amateurs : une approche qualitative Ce mémoire se concentre sur l’impact du changement climatique sur la pratique et le comportement des alpinistes amateurs. Il s’inscrit dans un contexte de transformation rapide que les montagnes subissent, attribuées au réchauffement climatique, notamment le retrait des glaciers, la fonte du pergélisol (ou permafrost) et la diminution de l’enneigement. Ces phénomènes bouleversent non seulement les paysages mais aussi les conditions dans lesquelles les alpinistes évoluent, rendant certaines pratiques plus dangereuses et incitant les pratiquants à s’adapter. L’objectif est de mener une réflexion approfondie sur comment les alpinistes amateurs adaptent leurs pratiques face à ces changements, en s’intéressant particulièrement à leurs perceptions individuelles, leurs motivations profondes, et leur expérience. Le mémoire s’appuie sur une analyse qualitative des entretiens menés avec 30 participants et sur les conclusions de Salim et al. (2023) dans leur article adoptant une approche quantitative, pour construire une approche plus nuancée des réponses comportementales. Les dimensions abordées sont donc l’expérience, les motivations, les perceptions, et comment elles influent sur la pratique et les comportements d’adaptation adoptées par les alpinistes amateurs. L’exploration de la variabilité entre les individus et la différence de contexte conduira cette analyse, afin de comprendre les éléments sous-jacents, les conduisant à faire des choix.
Impacts du changement climatique sur la pratique et le comportement des alpinistes amateurs : une approche qualitative Ce mémoire se concentre sur l’impact du changement climatique sur la pratique et le comportement des alpinistes amateurs. Il s’inscrit dans un contexte de transformation rapide que les montagnes subissent, attribuées au réchauffement climatique, notamment le retrait des glaciers, la fonte du pergélisol (ou permafrost) et la diminution de l’enneigement. Ces phénomènes bouleversent non seulement les paysages mais aussi les conditions dans lesquelles les alpinistes évoluent, rendant certaines pratiques plus dangereuses et incitant les pratiquants à s’adapter. L’objectif est de mener une réflexion approfondie sur comment les alpinistes amateurs adaptent leurs pratiques face à ces changements, en s’intéressant particulièrement à leurs perceptions individuelles, leurs motivations profondes, et leur expérience. Le mémoire s’appuie sur une analyse qualitative des entretiens menés avec 30 participants et sur les conclusions de Salim et al. (2023) dans leur article adoptant une approche quantitative, pour construire une approche plus nuancée des réponses comportementales. Les dimensions abordées sont donc l’expérience, les motivations, les perceptions, et comment elles influent sur la pratique et les comportements d’adaptation adoptées par les alpinistes amateurs. L’exploration de la variabilité entre les individus et la différence de contexte conduira cette analyse, afin de comprendre les éléments sous-jacents, les conduisant à faire des choix. Agriculture et collectivités locales : Le rôle des EPCI dans l'accompagnement et le developpement de l'activité agricole.
Le cas de la communauté d'agglomération Pays Foix-Varilhes. Mémoire de licence professionnelle, dans le cadre d'un stage au sein de l'agglo Foix-Varilhes. Réalisation d'un observatoire des exploitations agricoles du territoire, afin de connaître l'activité, recenser les besoins et projets, afin de déterminer les axes de développement dans la stratégie de l'agglo.
Agriculture et collectivités locales : Le rôle des EPCI dans l'accompagnement et le developpement de l'activité agricole.
Le cas de la communauté d'agglomération Pays Foix-Varilhes. Mémoire de licence professionnelle, dans le cadre d'un stage au sein de l'agglo Foix-Varilhes. Réalisation d'un observatoire des exploitations agricoles du territoire, afin de connaître l'activité, recenser les besoins et projets, afin de déterminer les axes de développement dans la stratégie de l'agglo. Un atlas de la biodiversité sur le Grand Parc de l’Hers (Toulouse Métropole, Haute-Garonne)
Étude de faisabilité Toulouse Métropole a engagé ces dernières années la création de cinq grands parcs métropolitains, tous adossés à la trame verte et bleue. Ces parcs ont pour ambition d’être de véritables axes verts sur le territoire. Ils viennent répondre à des enjeux de sobriété foncière, d’adaptation au changement climatique, de préservation de la biodiversité, d’accès des habitants à la nature et de conciliation des usages. La démarche Atlas de la biodiversité, déployée par l’Office Français de la Biodiversité sous la forme d’appel à projet, constitue un outil permettant de répondre à plusieurs de ces enjeux. A l’image d’un laboratoire, le Grand Parc de l’Hers est le premier des cinq grands parcs à affirmer, au travers son plan d'action, la volonté de mettre en œuvre un atlas de la biodiversité. Cette démarche prévoit l’implication des 13 communes de son périmètre, toutes situées sur un linéaire de près de 30 km, le long de l’Hers et ses affluents. Afin d’étudier la faisabilité d’un tel projet, ont été recueillis les retours d'expérience de trois territoires français ayant réalisé des atlas de la biodiversité à l’échelle de plusieurs communes. Des échanges avec 12 des 13 communes du Grand Parc de l’Hers ont également été organisés afin de mieux définir les contours de cet atlas. Les résultats de ce travail apportent un éclairage riche pour aider Toulouse Métropole à s’organiser sur la mise en œuvre de cette action prévue au plan d’actions du Grand Parc de l'Hers : consulter les communes dès la préparation, identifier les partenaires, établir la gouvernance, établir un rétro-planning, co-construire avec les communes des axes thématiques fédérateur et bien calibrer le financement. Ainsi monté, l’atlas permettrait de fédérer le territoire autour de la biodiversité grâce à la mobilisation de ces divers acteurs, et apporterait une meilleure connaissance de l’état des écosystèmes, dans le but à la fois de préserver et restaurer la qualité biologique, et de développer des usages compatibles avec les enjeux écologiques. Cet atlas constituerait enfin un outil partagé de discussion et d’aide à la décision dont les connaissances pourraient être incluses aux politiques publiques et utilisées pour adapter les aménagements.
Un atlas de la biodiversité sur le Grand Parc de l’Hers (Toulouse Métropole, Haute-Garonne)
Étude de faisabilité Toulouse Métropole a engagé ces dernières années la création de cinq grands parcs métropolitains, tous adossés à la trame verte et bleue. Ces parcs ont pour ambition d’être de véritables axes verts sur le territoire. Ils viennent répondre à des enjeux de sobriété foncière, d’adaptation au changement climatique, de préservation de la biodiversité, d’accès des habitants à la nature et de conciliation des usages. La démarche Atlas de la biodiversité, déployée par l’Office Français de la Biodiversité sous la forme d’appel à projet, constitue un outil permettant de répondre à plusieurs de ces enjeux. A l’image d’un laboratoire, le Grand Parc de l’Hers est le premier des cinq grands parcs à affirmer, au travers son plan d'action, la volonté de mettre en œuvre un atlas de la biodiversité. Cette démarche prévoit l’implication des 13 communes de son périmètre, toutes situées sur un linéaire de près de 30 km, le long de l’Hers et ses affluents. Afin d’étudier la faisabilité d’un tel projet, ont été recueillis les retours d'expérience de trois territoires français ayant réalisé des atlas de la biodiversité à l’échelle de plusieurs communes. Des échanges avec 12 des 13 communes du Grand Parc de l’Hers ont également été organisés afin de mieux définir les contours de cet atlas. Les résultats de ce travail apportent un éclairage riche pour aider Toulouse Métropole à s’organiser sur la mise en œuvre de cette action prévue au plan d’actions du Grand Parc de l'Hers : consulter les communes dès la préparation, identifier les partenaires, établir la gouvernance, établir un rétro-planning, co-construire avec les communes des axes thématiques fédérateur et bien calibrer le financement. Ainsi monté, l’atlas permettrait de fédérer le territoire autour de la biodiversité grâce à la mobilisation de ces divers acteurs, et apporterait une meilleure connaissance de l’état des écosystèmes, dans le but à la fois de préserver et restaurer la qualité biologique, et de développer des usages compatibles avec les enjeux écologiques. Cet atlas constituerait enfin un outil partagé de discussion et d’aide à la décision dont les connaissances pourraient être incluses aux politiques publiques et utilisées pour adapter les aménagements.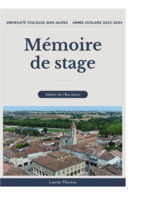 Construction d'une ressourcerie sur Fleurance Ce mémoire parle de pourquoi la mairie de Fleurance projette de réaliser une ressourcerie sur son territoire. Et de comment moi stagiaire en licence pro ADEL est pu les aider
Construction d'une ressourcerie sur Fleurance Ce mémoire parle de pourquoi la mairie de Fleurance projette de réaliser une ressourcerie sur son territoire. Et de comment moi stagiaire en licence pro ADEL est pu les aider Sensibiliser au réchauffement climatique dans la vallée de Chamonix : les glaciers comme supports de médiation. Connaître, protéger, gérer et partager : ce sont les quatre missions des réserves naturelles des Aiguilles Rouges. C’est donc au sein de l’ARNAR, l’Association des Réserves Naturelles des Aiguilles Rouges que j’ai pu contribuer à la mission de « partage ». Ici, le partage signifie faire le lien entre les experts scientifiques et le grand public. Il s’agit de transmettre les informations, de mettre en valeur les travaux scientifiques existants et d’amener le public a faire évoluer sa réflexion sur différents sujets. Cette mission de médiation et de sensibilisation est absolument nécessaire : si elle n’est pas effectuée, les nombreux travaux menés par les chercheurs ne trouvent pas d’application dans la société et restent des recherches théoriques. C’est pourquoi, au chalet du col des Montets et au sommet du Brévent, deux sites gérés en partie par l’ARNAR, ont lieu des animations et des visites de sentiers visant à aborder des sujets environnementaux. En s’appuyant sur des connaissances scientifiques et sur l’observation du paysage, nous souhaitons amener les visiteurs des deux sites à réfléchir sur ce qui les entoure et à comprendre le fonctionnement des milieux montagnards. Parmi les grands enjeux environnementaux actuels, le réchauffement climatique est celui qui impacte le plus à la fois les sociétés humaines et les écosystèmes. De nombreuses recherches sont menées sur le sujet, notamment par le GIEC : le Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat. Pourtant, on ne voit pas émerger d’actions significatives visant à ralentir ce phénomène. Pire, la responsabilité humaine dans ce processus est de moins en moins reconnue par la population mondiale. Face à cette situation, qui nécessite une prise de conscience et un changement de modes de consommation, il est important de mettre en place des moyens de sensibilisation puissants. Travailler sur ce sujet dans les montagnes est tout a fait pertinent car c’est un milieu qui subit particulièrement les conséquences du réchauffement climatique. Alors que la France a gagné au total 1,4 degrés au 20e siècle, les Alpes et les Pyrénées se sont réchauffées de 2 degrés sur cette période (source : Météo France). Ce réchauffement affecte grandement à la fois le tourisme, les écosystèmes, les paysages et augmente les risques en montagne. La vallée de Chamonix en est un bon exemple : encaissée entre deux versants, et surplombée par les glaciers, elle fonctionne grâce à son attractivité touristique, aujourd’hui menacée. Dans ce mémoire, nous allons essayer de tirer profit de cette attractivité touristique pour sensibiliser un grand nombre de personnes aux enjeux climatiques via des supports pédagogiques naturels : les glaciers.
Sensibiliser au réchauffement climatique dans la vallée de Chamonix : les glaciers comme supports de médiation. Connaître, protéger, gérer et partager : ce sont les quatre missions des réserves naturelles des Aiguilles Rouges. C’est donc au sein de l’ARNAR, l’Association des Réserves Naturelles des Aiguilles Rouges que j’ai pu contribuer à la mission de « partage ». Ici, le partage signifie faire le lien entre les experts scientifiques et le grand public. Il s’agit de transmettre les informations, de mettre en valeur les travaux scientifiques existants et d’amener le public a faire évoluer sa réflexion sur différents sujets. Cette mission de médiation et de sensibilisation est absolument nécessaire : si elle n’est pas effectuée, les nombreux travaux menés par les chercheurs ne trouvent pas d’application dans la société et restent des recherches théoriques. C’est pourquoi, au chalet du col des Montets et au sommet du Brévent, deux sites gérés en partie par l’ARNAR, ont lieu des animations et des visites de sentiers visant à aborder des sujets environnementaux. En s’appuyant sur des connaissances scientifiques et sur l’observation du paysage, nous souhaitons amener les visiteurs des deux sites à réfléchir sur ce qui les entoure et à comprendre le fonctionnement des milieux montagnards. Parmi les grands enjeux environnementaux actuels, le réchauffement climatique est celui qui impacte le plus à la fois les sociétés humaines et les écosystèmes. De nombreuses recherches sont menées sur le sujet, notamment par le GIEC : le Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat. Pourtant, on ne voit pas émerger d’actions significatives visant à ralentir ce phénomène. Pire, la responsabilité humaine dans ce processus est de moins en moins reconnue par la population mondiale. Face à cette situation, qui nécessite une prise de conscience et un changement de modes de consommation, il est important de mettre en place des moyens de sensibilisation puissants. Travailler sur ce sujet dans les montagnes est tout a fait pertinent car c’est un milieu qui subit particulièrement les conséquences du réchauffement climatique. Alors que la France a gagné au total 1,4 degrés au 20e siècle, les Alpes et les Pyrénées se sont réchauffées de 2 degrés sur cette période (source : Météo France). Ce réchauffement affecte grandement à la fois le tourisme, les écosystèmes, les paysages et augmente les risques en montagne. La vallée de Chamonix en est un bon exemple : encaissée entre deux versants, et surplombée par les glaciers, elle fonctionne grâce à son attractivité touristique, aujourd’hui menacée. Dans ce mémoire, nous allons essayer de tirer profit de cette attractivité touristique pour sensibiliser un grand nombre de personnes aux enjeux climatiques via des supports pédagogiques naturels : les glaciers. Comment, dans un contexte de réchauffement climatique, accompagner les entreprises à enclencher et pérenniser une démarche d’économie d’eau ? Nous vivons dans un contexte de changement climatique et à ce titre, l'eau sa gestion et son économie est un sujet d'enjeu majeur pour le monde de demain. Ce sujet doit être pris en compte par tout le monde y compris les entreprises. La CCI est un acteur majeur de l'accompagnement des entreprises, elle oeuvre pour le développement économique local. A ce titre la CCI des Pays de la Loire, territoire fortement impacté par le changement climatique sur la ressource en eau propose des dispositifs d'aide pour enclencher une démarche d'économie d'eau aux entreprises des Pays de la Loire.
Comment, dans un contexte de réchauffement climatique, accompagner les entreprises à enclencher et pérenniser une démarche d’économie d’eau ? Nous vivons dans un contexte de changement climatique et à ce titre, l'eau sa gestion et son économie est un sujet d'enjeu majeur pour le monde de demain. Ce sujet doit être pris en compte par tout le monde y compris les entreprises. La CCI est un acteur majeur de l'accompagnement des entreprises, elle oeuvre pour le développement économique local. A ce titre la CCI des Pays de la Loire, territoire fortement impacté par le changement climatique sur la ressource en eau propose des dispositifs d'aide pour enclencher une démarche d'économie d'eau aux entreprises des Pays de la Loire. Les réseaux de sentiers d'interprétations peuvent-ils créer une offre touristique harmonisée pour le public et les habitants ? Le département de l'Allier souhaite développer son attraction touristique et pour ce faire, la diversité de ces dernières est nécessaire. Voici l'exemple d'un outil très important qui participe à ce développement.
Les réseaux de sentiers d'interprétations peuvent-ils créer une offre touristique harmonisée pour le public et les habitants ? Le département de l'Allier souhaite développer son attraction touristique et pour ce faire, la diversité de ces dernières est nécessaire. Voici l'exemple d'un outil très important qui participe à ce développement.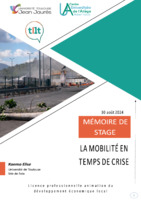 La mobilité en temps de crise Ce mémoire analyse l'impact de la crise sur la mobilité urbaine à Nouméa suite à l'arrêt des transports publics, révélant des vulnérabilités et accentuant les inégalités sociales. Il propose des solutions telles que le covoiturage et les navettes maritimes pour améliorer la résilience du système de transport, soulignant la nécessité d'une meilleure coordination et d'un cadre réglementaire adapté. L'objectif est de développer un système de mobilité plus durable et flexible pour répondre aux besoins des habitants, même en situation de crise.
La mobilité en temps de crise Ce mémoire analyse l'impact de la crise sur la mobilité urbaine à Nouméa suite à l'arrêt des transports publics, révélant des vulnérabilités et accentuant les inégalités sociales. Il propose des solutions telles que le covoiturage et les navettes maritimes pour améliorer la résilience du système de transport, soulignant la nécessité d'une meilleure coordination et d'un cadre réglementaire adapté. L'objectif est de développer un système de mobilité plus durable et flexible pour répondre aux besoins des habitants, même en situation de crise.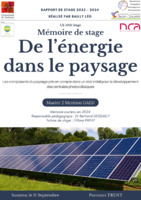 De l'énergie dans le paysage : Les composants du paysage pris en compte dans un état initial pour le développement des centrales photovoltaïque Ce mémoire examine les méthodes d'identification et de caractérisation des critères de remarquabilité paysagère, dans le cadre d'un état initial, pour le développement de centrales solaire. Le contexte actuel de transition énergétique impose la mise en place de nouvelles infrastructures, telles que les centrales photovoltaïques, dans des zones variées, souvent rurales. Cette démarche soulève des enjeux en termes d'intégration paysagère, nécessitant une analyse afin de minimiser les impacts visuels. Ce dossier met en avant l'importance de plusieurs éléments clés dans cette évaluation. La topographie est un facteur déterminant : les points hauts à proximité du site peuvent accroître la visibilité des installations, tandis que les points bas, souvent associés à des cours d'eau, sont généralement moins visibles. Les cours d'eau, en plus de modeler la topographie, sont souvent bordés par une strate arborée qui peut jouer un rôle en masquant partiellement les infrastructures, limitant ainsi leur impact visuel. L'occupation des sols est un autre aspect essentiel à considérer. Les types de cultures présents sur un territoire influencent directement la visibilité des panneaux photovoltaïques. De plus, la présence de zones bâties à proximité peut introduire des points de vue supplémentaires vers le site, augmentant l'impact visuel des centrales. La prise en compte du patrimoine protégé est également fondamentale. Les sites classés ou inscrits exigent une attention particulière pour éviter de compromettre leur intégrité visuelle. L'analyse de la proximité de ces sites par rapport au projet de nouvelles infrastructures photovoltaïques est importante afin de respecter les contraintes légales et préserver la valeur patrimoniale des paysages concernés. Enfin, l'étude souligne l'importance de l'analyse de la visibilité, notamment à partir de points de vue identifiés comme significatifs pour la population locale. Cette démarche vise à anticiper et préconiser des moyens de limiter les perceptions. Ceci dans l’optique de prévenir les potentielles réactions négatives des habitants et visiteurs face aux nouvelles installations, en veillant à préserver les qualités esthétiques et culturelles du paysage. L'analyse globale menée dans ce mémoire montre que l'intégration des centrales photovoltaïques dans le paysage nécessite une approche multidimensionnelle, combinant des aspects topographiques, écologiques, et patrimoniaux pour minimiser leur impact tout en répondant aux besoins de la transition énergétique.
De l'énergie dans le paysage : Les composants du paysage pris en compte dans un état initial pour le développement des centrales photovoltaïque Ce mémoire examine les méthodes d'identification et de caractérisation des critères de remarquabilité paysagère, dans le cadre d'un état initial, pour le développement de centrales solaire. Le contexte actuel de transition énergétique impose la mise en place de nouvelles infrastructures, telles que les centrales photovoltaïques, dans des zones variées, souvent rurales. Cette démarche soulève des enjeux en termes d'intégration paysagère, nécessitant une analyse afin de minimiser les impacts visuels. Ce dossier met en avant l'importance de plusieurs éléments clés dans cette évaluation. La topographie est un facteur déterminant : les points hauts à proximité du site peuvent accroître la visibilité des installations, tandis que les points bas, souvent associés à des cours d'eau, sont généralement moins visibles. Les cours d'eau, en plus de modeler la topographie, sont souvent bordés par une strate arborée qui peut jouer un rôle en masquant partiellement les infrastructures, limitant ainsi leur impact visuel. L'occupation des sols est un autre aspect essentiel à considérer. Les types de cultures présents sur un territoire influencent directement la visibilité des panneaux photovoltaïques. De plus, la présence de zones bâties à proximité peut introduire des points de vue supplémentaires vers le site, augmentant l'impact visuel des centrales. La prise en compte du patrimoine protégé est également fondamentale. Les sites classés ou inscrits exigent une attention particulière pour éviter de compromettre leur intégrité visuelle. L'analyse de la proximité de ces sites par rapport au projet de nouvelles infrastructures photovoltaïques est importante afin de respecter les contraintes légales et préserver la valeur patrimoniale des paysages concernés. Enfin, l'étude souligne l'importance de l'analyse de la visibilité, notamment à partir de points de vue identifiés comme significatifs pour la population locale. Cette démarche vise à anticiper et préconiser des moyens de limiter les perceptions. Ceci dans l’optique de prévenir les potentielles réactions négatives des habitants et visiteurs face aux nouvelles installations, en veillant à préserver les qualités esthétiques et culturelles du paysage. L'analyse globale menée dans ce mémoire montre que l'intégration des centrales photovoltaïques dans le paysage nécessite une approche multidimensionnelle, combinant des aspects topographiques, écologiques, et patrimoniaux pour minimiser leur impact tout en répondant aux besoins de la transition énergétique. Les enjeux socio-écologiques des mares et lavognes sur les causses méridionaux héraultais et gardois. Les mares et les lavognes sont des petits points d’eau naturels ou façonnés par les humains que l’on trouve sur les causses. Souvent oubliées ou négligées par leur petite taille, ces écosystèmes sont pourtant des oasis de biodiversité dans un contexte géologique karstique pauvre en eau. Les mares présentent sur les petites causses méridionaux ont pour certaines la spécificité d’être temporaires avec une alternance de phases d’assec et de phases inondées. Certaines sont même . Ces conditions donnent lieu à une biodiversité spécifique inféodée qui a un cycle de vie adapté. Étant des milieux petits et isolés, les mares et les lavognes sont des écosystèmes fragiles. Ils sont liés au pâturage et sont voués à disparaître par comblement au cours du temps sans l’intervention humaine. Cependant, ces interventions doivent être limitées aux nécessaire et réaliser à la bonne période afin de préserver la biodiversité. Il est donc important de connaître les mares pour savoir les gérer de manière efficace. C’est dans cette optique là que mon stage s’intègre en recueillant des témoignages de personnes du territoire et ainsi réaliser un livret sur l’entretien des mares et lavognes qui répondent aux besoins du territoire.
Les enjeux socio-écologiques des mares et lavognes sur les causses méridionaux héraultais et gardois. Les mares et les lavognes sont des petits points d’eau naturels ou façonnés par les humains que l’on trouve sur les causses. Souvent oubliées ou négligées par leur petite taille, ces écosystèmes sont pourtant des oasis de biodiversité dans un contexte géologique karstique pauvre en eau. Les mares présentent sur les petites causses méridionaux ont pour certaines la spécificité d’être temporaires avec une alternance de phases d’assec et de phases inondées. Certaines sont même . Ces conditions donnent lieu à une biodiversité spécifique inféodée qui a un cycle de vie adapté. Étant des milieux petits et isolés, les mares et les lavognes sont des écosystèmes fragiles. Ils sont liés au pâturage et sont voués à disparaître par comblement au cours du temps sans l’intervention humaine. Cependant, ces interventions doivent être limitées aux nécessaire et réaliser à la bonne période afin de préserver la biodiversité. Il est donc important de connaître les mares pour savoir les gérer de manière efficace. C’est dans cette optique là que mon stage s’intègre en recueillant des témoignages de personnes du territoire et ainsi réaliser un livret sur l’entretien des mares et lavognes qui répondent aux besoins du territoire. Coexistence et confrontation des exploitations bio et non-bio dans le Conflent, Pyrénées-Orientales Ce mémoire est le fruit d’un stage de recherche portant sur la question de la coexistence et de la confrontation entre les exploitations bio et non-bio au sein du territoire du Conflent. Le stage a été encadré conjointement par l'INRAE et la Communauté de communes Conflent Canigó, s'inscrivant dans le cadre du projet de recherche DEFIBIO, qui explore les dynamiques de l'Agriculture Biologique en Occitanie face aux nouveaux défis actuels (réduction de la consommation, ralentissement des conversions, augmentation des coûts de production, impact du changement climatique, etc.). Durant ce stage, un travail de recherche a été mené sur la question de la coexistence entre l'agriculture biologique et non-biologique dans le territoire du Conflent, qui connaît une croissance significative du secteur biologique depuis 2010 et présente une grande diversité de pratiques et de modèles agricoles. Ce territoire constitue ainsi un cas d'étude pertinent pour analyser une variété de dynamiques et d'interactions entre pratiques biologiques et non-biologiques. La méthodologie adoptée au cours de ce stage est une analyse qualitative fondée sur des recherches bibliographiques ainsi que les résultats de vingt-neuf entretiens semi-directifs réalisés au cours du stage auprès d’agriculteurs du Conflent. L'étude aborde la problématique suivante : Comment la coexistence des exploitations agricoles biologiques et non-biologiques dans le territoire du Conflent se caractérise-t-elle et quels sont ses enjeux sur les dynamiques agricoles contemporaines locales ? Cette étude révèle une riche diversité de trajectoires, de pratiques et de stratégies, qui caractérisent et témoignent de la complexité des dynamiques agricoles au sein de ce territoire. La coexistence bio / non-bio se joue principalement autour de la question de l’accès et du partage d'une diversité de ressources, renforcée par des dynamiques de filière et une proximité spatiale entre agriculteurs. Au-delà de la coexistence bio / non-bio, d'autres types d'interactions, notamment entre diverses filières agricoles et modèles de production, jouent un rôle déterminant dans la structuration du paysage agricole du Conflent.
Coexistence et confrontation des exploitations bio et non-bio dans le Conflent, Pyrénées-Orientales Ce mémoire est le fruit d’un stage de recherche portant sur la question de la coexistence et de la confrontation entre les exploitations bio et non-bio au sein du territoire du Conflent. Le stage a été encadré conjointement par l'INRAE et la Communauté de communes Conflent Canigó, s'inscrivant dans le cadre du projet de recherche DEFIBIO, qui explore les dynamiques de l'Agriculture Biologique en Occitanie face aux nouveaux défis actuels (réduction de la consommation, ralentissement des conversions, augmentation des coûts de production, impact du changement climatique, etc.). Durant ce stage, un travail de recherche a été mené sur la question de la coexistence entre l'agriculture biologique et non-biologique dans le territoire du Conflent, qui connaît une croissance significative du secteur biologique depuis 2010 et présente une grande diversité de pratiques et de modèles agricoles. Ce territoire constitue ainsi un cas d'étude pertinent pour analyser une variété de dynamiques et d'interactions entre pratiques biologiques et non-biologiques. La méthodologie adoptée au cours de ce stage est une analyse qualitative fondée sur des recherches bibliographiques ainsi que les résultats de vingt-neuf entretiens semi-directifs réalisés au cours du stage auprès d’agriculteurs du Conflent. L'étude aborde la problématique suivante : Comment la coexistence des exploitations agricoles biologiques et non-biologiques dans le territoire du Conflent se caractérise-t-elle et quels sont ses enjeux sur les dynamiques agricoles contemporaines locales ? Cette étude révèle une riche diversité de trajectoires, de pratiques et de stratégies, qui caractérisent et témoignent de la complexité des dynamiques agricoles au sein de ce territoire. La coexistence bio / non-bio se joue principalement autour de la question de l’accès et du partage d'une diversité de ressources, renforcée par des dynamiques de filière et une proximité spatiale entre agriculteurs. Au-delà de la coexistence bio / non-bio, d'autres types d'interactions, notamment entre diverses filières agricoles et modèles de production, jouent un rôle déterminant dans la structuration du paysage agricole du Conflent.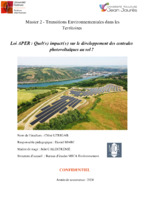 Loi APER : Quel(s) impact(s) sur le développement des centrales photovoltaïques au sol ? Ce mémoire explore l'impact de la loi relative à l'accélération de la production des énergies renouvelables (loi APER), adoptée en mars 2023, sur le développement des centrales photovoltaïques au sol en France. Cette législation vise à simplifier les procédures administratives et à favoriser un déploiement rapide des projets photovoltaïques, essentiels dans le contexte de la transition énergétique. L'analyse se concentre sur la capacité de la loi à encourager l'expansion des centrales photovoltaïques au sol dans le but de répondre aux ambitions énergétiques nationales. En évaluant les mécanismes mis en place par la loi et leur influence sur le rythme de mise en œuvre des projets, ce travail cherche à déterminer si cette législation peut réellement permettre à la France de progresser vers ses objectifs climatiques à long terme.
Loi APER : Quel(s) impact(s) sur le développement des centrales photovoltaïques au sol ? Ce mémoire explore l'impact de la loi relative à l'accélération de la production des énergies renouvelables (loi APER), adoptée en mars 2023, sur le développement des centrales photovoltaïques au sol en France. Cette législation vise à simplifier les procédures administratives et à favoriser un déploiement rapide des projets photovoltaïques, essentiels dans le contexte de la transition énergétique. L'analyse se concentre sur la capacité de la loi à encourager l'expansion des centrales photovoltaïques au sol dans le but de répondre aux ambitions énergétiques nationales. En évaluant les mécanismes mis en place par la loi et leur influence sur le rythme de mise en œuvre des projets, ce travail cherche à déterminer si cette législation peut réellement permettre à la France de progresser vers ses objectifs climatiques à long terme.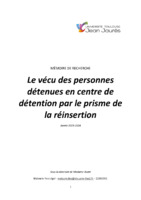 Le vécu des personnes détenues en centre de détention par le prisme de la réinsertion. Au 1er juillet 2024, 78 509 personnes étaient détenues dans les établissements pénitentiaires français, pourtant ces individus sont très peu connus. Les travaux et réflexions menés sur ces institutions, notamment en sociologie, centrent leur propos sur les établissements, leurs règles et leurs fonctions. Le vécu de l’expérience carcérale, essentiel pour comprendre dans son ensemble le principe d’enfermement et d’incarcération, est mis de côté. Par conséquent, l’acteur de la détention, la personne détenue, n’est pas considérée, or c’est elle qui est au centre des stratégies et des démarches pour accueillir au mieux sa peine et sa réinsertion. Vivre enfermé entre des murs n’est pas anodin, pourtant la violence qu’est l’incarcération est mise sous silence. Ainsi, avec la réalisation d’un terrain de recherche au sein du centre de détention de Châteaudun, cette étude a pour objectif d’apporter une analyse du vécu de l’enfermement et de l’incarcération dans ces établissements, par le prisme de la réinsertion. Il sera question de s’intéresser aux prisons, entendues comme des institutions totalitaires du fait de leursrôle d’appareil à transformer les individus, leurforme de « privation de liberté » et leurs règles dictées par l’administration pénitentiaire. Cela conduira à se demander comment les individus détenus pour des périodes plus ou moins longues vivent entre les murs de ces institutions.
Le vécu des personnes détenues en centre de détention par le prisme de la réinsertion. Au 1er juillet 2024, 78 509 personnes étaient détenues dans les établissements pénitentiaires français, pourtant ces individus sont très peu connus. Les travaux et réflexions menés sur ces institutions, notamment en sociologie, centrent leur propos sur les établissements, leurs règles et leurs fonctions. Le vécu de l’expérience carcérale, essentiel pour comprendre dans son ensemble le principe d’enfermement et d’incarcération, est mis de côté. Par conséquent, l’acteur de la détention, la personne détenue, n’est pas considérée, or c’est elle qui est au centre des stratégies et des démarches pour accueillir au mieux sa peine et sa réinsertion. Vivre enfermé entre des murs n’est pas anodin, pourtant la violence qu’est l’incarcération est mise sous silence. Ainsi, avec la réalisation d’un terrain de recherche au sein du centre de détention de Châteaudun, cette étude a pour objectif d’apporter une analyse du vécu de l’enfermement et de l’incarcération dans ces établissements, par le prisme de la réinsertion. Il sera question de s’intéresser aux prisons, entendues comme des institutions totalitaires du fait de leursrôle d’appareil à transformer les individus, leurforme de « privation de liberté » et leurs règles dictées par l’administration pénitentiaire. Cela conduira à se demander comment les individus détenus pour des périodes plus ou moins longues vivent entre les murs de ces institutions. Etude de l'articulation entre les coopérations locales et les politiques publiques agricoles sur le territoire du Nord-Comminges L’objet du stage s’intègre au projet COTERRA (Repenser les COllectifs agricoles dans leurs TERRitoires pour plus d’Autonomie) et vise à identifier les différentes modalités de coopérations entre agriculteurs présentes sur le territoire du Nord Comminges, au travers d’une étude ethnographique. Ces dernières englobent des réalités très diverses, plus ou moins formelles, basées sur de l’échange de biens matériels ou immatériels, comme du temps de travail ou du partage de connaissances. Elles peuvent ainsi porter sur du prêt ou de l’achat de matériel en CUMA, des dispositifs de commandes groupées, de l’achat de fourrages entre agriculteurs ou du troc, des coups de main et autres échanges de bons procédés, etc. Mobilisant la recherche d’autonomie comme cadre théorique, l’analyse de l’articulation de ces formes de coopération avec les politiques publiques agricoles entend saisir les freins et leviers, du point de vue des agriculteurs et d’autres acteurs du monde agricole, à l’émergence de formes de coopération agricole et d’identifier les compromis qui sont négociés dans le cadre de processus d’autonomisation collective. Ce travail a ainsi pour ambition de contribuer à une meilleure prise en compte de ces modalités de coopérations par les dispositifs actuels afin de soutenir ces démarches collectives, favorables à l’autonomie des agriculteurs et au développement de pratiques agroécologiques.
Etude de l'articulation entre les coopérations locales et les politiques publiques agricoles sur le territoire du Nord-Comminges L’objet du stage s’intègre au projet COTERRA (Repenser les COllectifs agricoles dans leurs TERRitoires pour plus d’Autonomie) et vise à identifier les différentes modalités de coopérations entre agriculteurs présentes sur le territoire du Nord Comminges, au travers d’une étude ethnographique. Ces dernières englobent des réalités très diverses, plus ou moins formelles, basées sur de l’échange de biens matériels ou immatériels, comme du temps de travail ou du partage de connaissances. Elles peuvent ainsi porter sur du prêt ou de l’achat de matériel en CUMA, des dispositifs de commandes groupées, de l’achat de fourrages entre agriculteurs ou du troc, des coups de main et autres échanges de bons procédés, etc. Mobilisant la recherche d’autonomie comme cadre théorique, l’analyse de l’articulation de ces formes de coopération avec les politiques publiques agricoles entend saisir les freins et leviers, du point de vue des agriculteurs et d’autres acteurs du monde agricole, à l’émergence de formes de coopération agricole et d’identifier les compromis qui sont négociés dans le cadre de processus d’autonomisation collective. Ce travail a ainsi pour ambition de contribuer à une meilleure prise en compte de ces modalités de coopérations par les dispositifs actuels afin de soutenir ces démarches collectives, favorables à l’autonomie des agriculteurs et au développement de pratiques agroécologiques. Les maisons individuelles de la métropole nantaise dans un contexte de zéro artificialisation nette Nantes Métropole s'est fixé l'objectif ambitieux d'atteindre le Zéro Artificialisation Nette à l'horizon 2030. Pour y parvenir, la métropole, en raison de son histoire, possède une grande quantité de maisons individuelles, considérés comme des espaces potentiellement mutables. Dans le cadre de mon stage de six mois au sein de la Direction Stratégie et Territoire, j'ai réalisé un diagnostic approfondi de ces quartiers en m'appuyant sur une analyse morphologique et géomatique. Celle-ci visait à caractériser ces espaces en termes de proximité aux centralités, de couverture végétale, de typologie des tissus urbains et de densité. L'objectif de cette analyse était d'identifier les enjeux spécifiques et territoriaux associés à ces quartiers, afin de déterminer les secteurs stratégiques pour l'avenir, que ce soit en matière de renouvellement urbain ou de préservation des espaces naturels. L'analyse a révélé une forte présence de maisons pavillonnaires construites entre les années 1960 et 1980, caractérisées par une grande proportion de sols perméables mais une faible diversité végétale. En revanche, les maisons plus anciennes, situées à proximité des centralités, sont plus denses et permettent de maintenir une végétation diversifiée dans des environnements plus fragiles. Avec le développement des transports en commun, certains de ces quartiers pavillonnaires situés en périphérie de Nantes semblent offrir un potentiel intéressant pour une densification mesurée, sans compromettre la qualité de vie des habitants.
Les maisons individuelles de la métropole nantaise dans un contexte de zéro artificialisation nette Nantes Métropole s'est fixé l'objectif ambitieux d'atteindre le Zéro Artificialisation Nette à l'horizon 2030. Pour y parvenir, la métropole, en raison de son histoire, possède une grande quantité de maisons individuelles, considérés comme des espaces potentiellement mutables. Dans le cadre de mon stage de six mois au sein de la Direction Stratégie et Territoire, j'ai réalisé un diagnostic approfondi de ces quartiers en m'appuyant sur une analyse morphologique et géomatique. Celle-ci visait à caractériser ces espaces en termes de proximité aux centralités, de couverture végétale, de typologie des tissus urbains et de densité. L'objectif de cette analyse était d'identifier les enjeux spécifiques et territoriaux associés à ces quartiers, afin de déterminer les secteurs stratégiques pour l'avenir, que ce soit en matière de renouvellement urbain ou de préservation des espaces naturels. L'analyse a révélé une forte présence de maisons pavillonnaires construites entre les années 1960 et 1980, caractérisées par une grande proportion de sols perméables mais une faible diversité végétale. En revanche, les maisons plus anciennes, situées à proximité des centralités, sont plus denses et permettent de maintenir une végétation diversifiée dans des environnements plus fragiles. Avec le développement des transports en commun, certains de ces quartiers pavillonnaires situés en périphérie de Nantes semblent offrir un potentiel intéressant pour une densification mesurée, sans compromettre la qualité de vie des habitants. La stratégie de valorisation du Crémant de Loire La stratégie de valorisation du Crémant de Loire repose sur plusieurs axes clés. D'abord, elle met en avant l'identité patrimoniale du vin, soulignant son lien avec le terroir unique du Val de Loire, notamment grâce à l'utilisation de tuffeau dans les caves. Ensuite, la stratégie vise à renforcer la reconnaissance du Crémant de Loire par rapport à la référence prestigieuse comme le Champagne, en promouvant ses caractéristiques distinctives et son savoir-faire artisanal. L'attractivité touristique de la région joue également un rôle central, avec des initiatives pour intégrer le Crémant de Loire dans l'œnotourisme, en développant des expériences de dégustation et des visites de caves. Parallèlement, des efforts sont déployés pour améliorer la visibilité du Crémant de Loire dans les restaurants et les événements, ainsi que pour renforcer la communication sur ses atouts.
La stratégie de valorisation du Crémant de Loire La stratégie de valorisation du Crémant de Loire repose sur plusieurs axes clés. D'abord, elle met en avant l'identité patrimoniale du vin, soulignant son lien avec le terroir unique du Val de Loire, notamment grâce à l'utilisation de tuffeau dans les caves. Ensuite, la stratégie vise à renforcer la reconnaissance du Crémant de Loire par rapport à la référence prestigieuse comme le Champagne, en promouvant ses caractéristiques distinctives et son savoir-faire artisanal. L'attractivité touristique de la région joue également un rôle central, avec des initiatives pour intégrer le Crémant de Loire dans l'œnotourisme, en développant des expériences de dégustation et des visites de caves. Parallèlement, des efforts sont déployés pour améliorer la visibilité du Crémant de Loire dans les restaurants et les événements, ainsi que pour renforcer la communication sur ses atouts. L'évolution hydrologique du bassin-versant du Caillan sur la vallée de Nohèdes et de Conat Depuis 2009, la réserve naturelle nationale de Nohèdes réalise tous les ans des stages sur le bilan hydrique sur le bassin-versant du Caillan dans la vallée de Nohèdes et Conat. La volonté de la structure à travers ces stages, est d’apprendre sur le fonctionnement du cours d’eau et son bassin-versant. De 2019 à 2024, le stage n’est pas reprogrammé et des tempêtes ont lieu sur le territoire. Des changements sont survenus sur le bassin-versant depuis ces épisodes. Ce rapport veut montrer l’évolution hydrologique du Caillan et de son bassin-versant de la vallée de Nohèdes à Conat. La présence d’une zone karstique sur une partie du territoire permet de réduire la quantité d’eau que la rivière peut recevoir à cause des infiltrations sur cette zone. Les débits enregistrés depuis 2009 permettent d’avoir un début de tendance sur la baisse des écoulements. Les courbes de tarage indiquent depuis Gloria en 2020, un changement de dynamique sur la rivière. Un écart est présent entre les débits calculés depuis 2020 et ceux effectués avant. Cette étude met en lien le territoire avec le changement climatique. La hausse des températures et le changement de répartition par saison et la variabilité des précipitations tendent à diminuer les débits du Caillan. La réduction de la quantité et de la durée du manteau neigeux aide aussi dans ce sens. De plus, l’assèchement des sols impacte les différentes zones humides présentes sur le territoire. Ce phénomène diminue en même temps, le niveau piézométrique de la nappe phréatique sur la partie karstique changeant les échanges entre le cours d’eau et le karst. Par conséquent, le Caillan est marqué par un changement en 2020. On observe qu’une évolution progressive en lien avec le changement climatique se déroule. Cette tendance est significative, car la présence de la ressource en eau sur le bassin-versant va diminuer d’ici 2050. Une réunion entre tous les habitants et les acteurs de la vallée est nécessaire afin d’établir un plan de gestion de la ressource en eau.
L'évolution hydrologique du bassin-versant du Caillan sur la vallée de Nohèdes et de Conat Depuis 2009, la réserve naturelle nationale de Nohèdes réalise tous les ans des stages sur le bilan hydrique sur le bassin-versant du Caillan dans la vallée de Nohèdes et Conat. La volonté de la structure à travers ces stages, est d’apprendre sur le fonctionnement du cours d’eau et son bassin-versant. De 2019 à 2024, le stage n’est pas reprogrammé et des tempêtes ont lieu sur le territoire. Des changements sont survenus sur le bassin-versant depuis ces épisodes. Ce rapport veut montrer l’évolution hydrologique du Caillan et de son bassin-versant de la vallée de Nohèdes à Conat. La présence d’une zone karstique sur une partie du territoire permet de réduire la quantité d’eau que la rivière peut recevoir à cause des infiltrations sur cette zone. Les débits enregistrés depuis 2009 permettent d’avoir un début de tendance sur la baisse des écoulements. Les courbes de tarage indiquent depuis Gloria en 2020, un changement de dynamique sur la rivière. Un écart est présent entre les débits calculés depuis 2020 et ceux effectués avant. Cette étude met en lien le territoire avec le changement climatique. La hausse des températures et le changement de répartition par saison et la variabilité des précipitations tendent à diminuer les débits du Caillan. La réduction de la quantité et de la durée du manteau neigeux aide aussi dans ce sens. De plus, l’assèchement des sols impacte les différentes zones humides présentes sur le territoire. Ce phénomène diminue en même temps, le niveau piézométrique de la nappe phréatique sur la partie karstique changeant les échanges entre le cours d’eau et le karst. Par conséquent, le Caillan est marqué par un changement en 2020. On observe qu’une évolution progressive en lien avec le changement climatique se déroule. Cette tendance est significative, car la présence de la ressource en eau sur le bassin-versant va diminuer d’ici 2050. Une réunion entre tous les habitants et les acteurs de la vallée est nécessaire afin d’établir un plan de gestion de la ressource en eau. La mise en œuvre du Bail Réel Solidaire en Martinique Ce mémoire explore la mise en place du Bail Réel Solidaire (BRS) en Martinique, un territoire insulaire confronté à des contraintes foncières importantes et une histoire socio-culturelle complexe. L'étude s'appuie sur une expérience de stage au sein de l'Établissement Public Foncier Local (EPFL) de Martinique, offrant une immersion concrète au sein des enjeux liés au logement social sur l'île. Le BRS, inspiré du modèle du Community Land Trust américain, vise à faciliter l'accès à la propriété pour les ménages modestes en dissociant le foncier du bâti. Son application en Martinique, portée par l'Organisme de Foncier Solidaire (OFS) de l’île, s'inscrit dans une volonté de dynamiser le territoire et de diversifier l'offre de logement social. Le contexte martiniquais présente des défis spécifiques, notamment le phénomène d'indivision qui touche près de 40% du foncier. Bien que le BRS ne puisse résoudre entièrement cette problématique, il pourrait contribuer à sa diminution à long terme. Le BRS pourrait constituer un levier de développement local, s'alignant avec la stratégie de l'EPFL de mobilisation foncière. Son application dans les Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville (QPV) pourrait favoriser la mixité sociale et la redynamisation urbaine. Il pourrait également être un outil de mise en œuvre du PLH des Communautés d’Agglomérations, notamment en les aidant à rééquilibrer le profil démographique de celles confrontées au vieillissement de la population, par exemple. Cependant, la réussite du BRS nécessite une mobilisation à long terme des acteurs locaux. En effet, l’histoire socio-culturelle de l’île étant complexe et l’aspiration à la propriété étant profondément ancrée dans la culture martiniquaise, un important travail de sensibilisation et de pédagogie auprès de la population sera nécessaire. La collaboration entre les différentes collectivités sera cruciale pour assurer une mise en œuvre cohérente et efficace du dispositif. L'OFS de Martinique jouera donc un rôle central dans l'adaptation du modèle aux spécificités locales. Des revendications d’adaptations spécifiques au territoire ont déjà émergé, comme la mise en place d'un crédit d'impôt. La collaboration avec d'autres OFS ultramarins permettra de partager les expériences et d'adapter le modèle aux contextes spécifiques des territoires d'outre-mer. Par la prise en compte de ces enjeux, la mise en place du BRS en Martinique pourrait donc être une opportunité de concilier les aspirations à l'accession à la propriété des Martiniquais avec les contraintes foncières et économiques du territoire.
La mise en œuvre du Bail Réel Solidaire en Martinique Ce mémoire explore la mise en place du Bail Réel Solidaire (BRS) en Martinique, un territoire insulaire confronté à des contraintes foncières importantes et une histoire socio-culturelle complexe. L'étude s'appuie sur une expérience de stage au sein de l'Établissement Public Foncier Local (EPFL) de Martinique, offrant une immersion concrète au sein des enjeux liés au logement social sur l'île. Le BRS, inspiré du modèle du Community Land Trust américain, vise à faciliter l'accès à la propriété pour les ménages modestes en dissociant le foncier du bâti. Son application en Martinique, portée par l'Organisme de Foncier Solidaire (OFS) de l’île, s'inscrit dans une volonté de dynamiser le territoire et de diversifier l'offre de logement social. Le contexte martiniquais présente des défis spécifiques, notamment le phénomène d'indivision qui touche près de 40% du foncier. Bien que le BRS ne puisse résoudre entièrement cette problématique, il pourrait contribuer à sa diminution à long terme. Le BRS pourrait constituer un levier de développement local, s'alignant avec la stratégie de l'EPFL de mobilisation foncière. Son application dans les Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville (QPV) pourrait favoriser la mixité sociale et la redynamisation urbaine. Il pourrait également être un outil de mise en œuvre du PLH des Communautés d’Agglomérations, notamment en les aidant à rééquilibrer le profil démographique de celles confrontées au vieillissement de la population, par exemple. Cependant, la réussite du BRS nécessite une mobilisation à long terme des acteurs locaux. En effet, l’histoire socio-culturelle de l’île étant complexe et l’aspiration à la propriété étant profondément ancrée dans la culture martiniquaise, un important travail de sensibilisation et de pédagogie auprès de la population sera nécessaire. La collaboration entre les différentes collectivités sera cruciale pour assurer une mise en œuvre cohérente et efficace du dispositif. L'OFS de Martinique jouera donc un rôle central dans l'adaptation du modèle aux spécificités locales. Des revendications d’adaptations spécifiques au territoire ont déjà émergé, comme la mise en place d'un crédit d'impôt. La collaboration avec d'autres OFS ultramarins permettra de partager les expériences et d'adapter le modèle aux contextes spécifiques des territoires d'outre-mer. Par la prise en compte de ces enjeux, la mise en place du BRS en Martinique pourrait donc être une opportunité de concilier les aspirations à l'accession à la propriété des Martiniquais avec les contraintes foncières et économiques du territoire.