-
 Corps et Intimité : Conception de dispositifs olfactifs
Corps et Intimité : Conception de dispositifs olfactifs Ce mémoire explore la réévaluation des odeurs corporelles, un domaine souvent négligé et stigmatisé dans notre société contemporaine. En revisitant l’importance des odeurs du corps humain à travers une approche interdisciplinaire, nous avons étudié leurs dimensions biologiques, culturelles, artistiques et sociales. Notre recherche commence par une analyse approfondie des bases biologiques et neurobiologiques des odeurs corporelles, explorant comment ces signaux olfactifs sont perçus et interprétés par notre cerveau. Puis nous examinons les tabous culturels et les perceptions sociales qui entourent ces odeurs, révélant leur rôle crucial dans la communication et les interactions interpersonnelles.
La seconde partie du mémoire s’intéresse à la création sacrée, artistique et sociale liée aux odeurs corporelles. Nous explorons des pratiques ancestrales de préservation et de purification, telles que la momification en Égypte ancienne et les rituels de guérison chez les Shipibo-Conibo. En étudiant l’usage de l’encens dans diverses traditions asiatiques, nous avons mis en lumière comment les odeurs sont utilisées pour harmoniser l’esprit et le corps, purifiant et élevant l’expérience spirituelle.
Un accent particulier a été mis sur la transformation olfactive du corps à travers la chimie des parfums, considérés comme des extensions de l’identité et des outils d’expression artistique et culturelle. Enfin, nous avons abordé la gestion des odeurs dans l’espace public, examinant comment les normes sociales et les technologies influencent notre tolérance et perception des odeurs.
Mon projet de diplôme, «Matières à sentir», incarne cette réévaluation en plaçant les odeurs corporelles au cœur d’une installation artistique et sensorielle. Cette œuvre vise à redonner légitimité et valeur à ces odeurs, en explorant leur rôle essentiel dans notre expérience sensorielle et sociale.
En somme, ce mémoire invite à une redécouverte des odeurs corporelles, nous poussant à les apprécier non seulement comme des éléments de notre biologie, mais aussi comme des composantes essentielles de notre culture et de notre humanité. Cette approche sensorielle enrichit notre compréhension de l’identité et des interactions humaines, soulignant l’importance des sens dans la formation de nos identités et relations sociales.
-
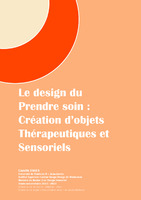 Le design du Prendre soin : Création d’objets Thérapeutiques et Sensoriels
Le design du Prendre soin : Création d’objets Thérapeutiques et Sensoriels Tout au long de cette année, j'ai rencontré des enseignants qui accueillaient dans leurs classes des enfants en situation de handicap, en particulier ceux atteints de Troubles du Spectre l'Autistique. Cela a mis en évidence un besoin urgent d'outils et de solutions pour ces élèves, qui ont souvent du mal à se concentrer en classe. Atteinte du Syndrome de Gilles de la Tourette, je comprends très bien ces difficultés, car j'ai moi - même eu du mal à me concentrer à cause de mes tics durant mes études. Cependant, j'ai constaté que le fait de dessiner ou de manipuler des objets m'aidait à mieux me concentrer. Après ces observations, j'ai axé mes recherches sur le care design. Le livre de Jehanne Dautrey "Design et pensées du care, pour un design des micro luttes et des singularités", publié en 2019, a été un point de départ essentiel. En effet, ce livre m’a mis sur la piste ‘’d’un design soucieux des singularités des personnes autant que celles des situations’’. Grâce à ce livre, ainsi que l’analyse du projet Therapeutique Felt - Tip Pen de Mathieu, Lehanneur (où le design permet d’améliorer le traitement médical en créant un objet ludique pouvant s’apparenter à un jouet), mes recherches se sont précisées. Mes pistes de recherches sur le thème du soin s’élargissent désormais à l’accompagnement, aux objets thérapeutiques, aux gestes automatiques, ou encore à la gradation des émotions.
En parallèle, mes recherches se sont également orientées vers l’usage, notamment après avoir étudié le projet CASS d’Adrien, BONNEROT, réalisé en 2011. Ce projet m’a par exemple fait prendre conscience de l’importance qu’il peut y avoir à affubler deux possibilités d’utilisation différentes et donc deux fonctions distinctes à un objet. Effectivement, ce procédé permet d’accompagner l’usager sur deux temps différents et deux besoins différents. Par exemple, dans le cas du projet CASS, ‘‘la première étape consiste à détruire l’objet pour évacuer notre violence, puis, dans un second temps, de le reconstruire afin de détourner l’attention de la frustration initiale et de s’apaiser’’.
Dans un troisième temps, le besoin de penser conjointement la préservation de l’environnement et la conception d’un projet design m’ont amenée à étudier la notion d’éco-conception. Pour ce faire, j’ai commencé par m’intéresser au livre d’Ernseto Oroza et de Pénélop De Bozzi intitulé, ‘‘Objets réinventés’’, éditions Alternatives, Paris, publié en 2002. Ce livre m’a ouvert les yeux sur la préciosité des objets du quotidien, mais aussi sur la richesse de ressources matérielles que représentent ces objets parfois délaissés, revendus sur des vides - grenier ou dans des Emmaüs. Suite à la lecture de cet ouvrage, associé à la relecture du projet ‘‘Réanim, la médecine des objets’’ des 5.5 Designers, dans lequel ‘‘les objets courants, trouvés dans les décharges, la rue, chez des particuliers, sont considérés comme des richesses inexploitées et réhabilités par le designer qui devient alors médecin et utilise son savoir-faire pour optimiser l’espérance de vie de ces objets’’, Il m’est apparu que ces recherches étaient centrales dans ma démarche de designer sensoriel, et qu’il me fallait mettre en place des processus de récoltes pour ensuite pouvoir expérimenter et concevoir des objets ayant un impact le plus réduit possible sur l’environnement.
-
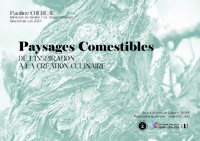 Paysages Comestibles : de l'inspiration à la création culinaire
Paysages Comestibles : de l'inspiration à la création culinaire Dans un monde où la quête de durabilité et de reconnection à la nature est plus pressante que jamais, ce mémoire explore comment la fusion entre le paysage et la pratique culinaire ouvre des perspectives innovantes et enrichissantes. À travers une approche multidisciplinaire, nous découvrons comment les paysages, avec leurs cycles naturels et leur richesse sensorielle, peuvent devenir une source inépuisable d’inspiration pour la création culinaire.
Ce voyage commence par une exploration du paysage en tant qu’inspiration esthétique et sensorielle, influençant la création culinaire de manière profonde. En nous plongeant dans des environnements naturels et culturels, nous découvrons comment ces contextes peuvent transformer l’expérience culinaire en une aventure immersive et sensorielle.
La deuxième partie du mémoire met en lumière le paysage nourricier et culinaire, soulignant l’importance de manger en accord avec le terroir et les saisons. En intégrant le design culinaire, la scénographie et le design global, nous dévoilons la richesse des interactions possibles entre la lumière, le son, les textures et les flaveurs.
Enfin, nous plongeons dans la création de paysages comestibles. En tant que paysagiste culinaire, je définis ma posture, mes valeurs et ma méthodologie de création. L’application de ces concepts à mon projet de fin d’étude illustre comment le paysage peut être intégré de manière artistique dans la création culinaire, transformant chaque repas en une œuvre d’art multisensorielle.
Ce mémoire propose une nouvelle vision du design culinaire, où chaque plat raconte une histoire, chaque saveur évoque un paysage, et chaque repas devient une célébration des saisons et de la nature. Une lecture essentielle pour quiconque est passionné par l’intersection de l’art, de la nature et de la gastronomie.
-
 Le toucher la nuit, Potentialité tactile nocturne pour la création de matières atmosphériques
Le toucher la nuit, Potentialité tactile nocturne pour la création de matières atmosphériques Le toucher est le premier des cinq sens à faire son apparition dans le développement du corps humain. Il est fondamental dans notre interaction avec ce qui nous entoure. Le toucher est porteur d’une particularité, pouvant être à la fois un sens physique mais également intangible. Il accède donc à une part d’atmosphérité avec laquelle il entre relationnellement en contact avec les autres.
Ce mémoire porte sur l’opportunité que le milieu nocturne apporte au sens du toucher. L’amoindrissement de la vue, la nuit, entraîne une hyperesthésie des sens. Le corps vit des expériences sensorielles plus intenses, la nuit apparaît comme libératrice des mœurs sociales, le toucher est plus vrai, moins réfréné. J’ai initié mon travail à travers la photographie argentique pour capter ces atmosphères nocturnes tactiles, le grain de la photo faisant ressortir des impressions atmosphériques. Comment le toucher peut-il remplacer la vue pour nous guider dans la nuit ?
Nous pouvons alors nous interroger : l’opportunité sensorielle nocturne du toucher permet-elle de mobiliser ses différentes typologies tactiles pour la création de matières, génératrices d’atmosphères, dans l’optique d’une meilleure appréhension de la voiture par son utilisateur ?
-
 Études et notations sensorielles pour la conception d'ambiances sonores urbaines
Études et notations sensorielles pour la conception d'ambiances sonores urbaines Dès l’avènement de l’industrialisation, les bouleversements qui ont eu lieu dans notre environnement sonore ont contribué à l'évolution de notre relation au son, reflétant les changements économiques, technologiques et sociaux de notre société.
Dans de nombreuses enquêtes, des scientifiques ont identifié des impacts physiologiques résultant de la surexposition sonore : fatigue, stress, diminution de l'acuité, maux de tête. Malgré ces impacts, le son reste une composante souvent négligée dans la conception architecturale et urbaine. L’environnement sonore devient une préoccupation lorsqu’il est perturbateur et affecte notre qualité de vie.
Cette observation met en évidence un écart entre l’évolution de notre patrimoine sonore et notre capacité à concevoir avec ces nouveaux sons. Nos méthodes de conception doivent être repensées pour intégrer pleinement cette dimension sensorielle.
Ce mémoire s’interroge donc sur la manière dont les ambiances urbaines sonores ont un impact sur nos sensations physiques et psychologiques. Il tente de comprendre les liens qu'entretient l’Homme avec son environnement sonore afin de trouver des solutions pour améliorer ces constats. Le design apparaît ainsi comme un des moyens de penser la conception urbaine autrement, afin de faciliter la (re)connection de l’Homme à son environnement sonore.
-
 Couleur Matière-Lumière et Conception d’Ambiances : Création d’Espaces Immersifs
Couleur Matière-Lumière et Conception d’Ambiances : Création d’Espaces Immersifs L'alliance subtile entre la couleur, la matière et la lumière constitue le cœur de notre expérience visuelle et sensorielle au sein de l'espace. Cette triade ne se limite plus à de simples composantes esthétiques, mais devient un élément clé dans la création d'ambiances immersives, invitant à une exploration novatrice des possibilités infinies.
Il ne s'agit plus simplement de créer des intérieurs agréables à l'œil, mais de concevoir des univers où chaque nuance, chaque texture et chaque jeu de lumière orchestrent une symphonie immersive, engageant l'observateur dans un dialogue émotionnel et esthétique.
Au cœur de cette réflexion, émerge une interrogation fondamentale : comment la relation dynamique entre couleur, matière et lumière peut-elle être explorée de manière innovante dans le processus de conception d'ambiances pour la création d'espaces immersifs ? Cette question stimule notre imagination et nous incite à repenser les paradigmes établis, à défier les normes et à embrasser une approche où la créativité et l'audace sont les maîtres-mots.
Ainsi, plongeons-nous dans l'univers fascinant de la couleur, de la matière et de la lumière, à la recherche de nouvelles façons de concevoir des espaces qui vont au-delà de l'esthétique pour créer des expériences sensorielles. La création d'espaces immersifs devient ainsi le terrain d'expression d'une symbiose artistique, où la magie opère à travers la fusion inventive de ces éléments, transformant les lieux en scènes vivantes qui captivent et transportent.
-
 Esthétique du non teint : couleurs naturelles pour une conception durable
Esthétique du non teint : couleurs naturelles pour une conception durable Dans un monde de plus en plus frénétique, les teintes naturelles émergent comme une réponse à un besoin profond de ralentir. Par leur caractère désaturé et terne, des couleurs comme le beige, le greige et l’écru évoquent une certaine neutralité permettant de se fondre harmonieusement à l’environnement. Ces nuances, qui semblent à première vue peu colorées, pourraient bientôt remplacer le vert comme nouvelle couleur identitaire du développement durable. Entre non-couleur, carnation, couleur de dissimulation et colorant, les états du non-teint sont multiples. Cette recherche vise à mettre en avant le domaine encore peu étudié des couleurs neutres. Par une approche à la fois chromatique, physique, anthropologique et épistémologique mon étude explore les caractéristiques uniques du non-teint, à la croisée entre couleur lumière et couleur matière. Cette esthétique émergente se développe dans un contexte poreux entre production industrielle, pratiques sensibles et durabilité. Ce mémoire de recherche questionne le rôle et la pratique du designer coloriste dans les domaines ultra-normés de l'ingénierie et de l’aéronautique, en apportant un nouveau regard sur la couleur raisonnée. À mesure que les tendances et l'industrie évoluent vers une conception plus durable, les teintes naturelles s'imposent comme la nouvelle palette du designer couleur, matière et finitions.
-
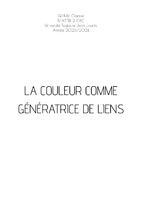 La couleur comme génératrice de liens
La couleur comme génératrice de liens Comment et en quoi la couleur peut-elle être génératrice de liens?
-
 Récits chromatiques : Le potentiel narratif de la couleur dans l'ornement
Récits chromatiques : Le potentiel narratif de la couleur dans l'ornement Intriguée par le fait que nous aimons les histoires, et comment ces histoires peuvent nous inspirer, j’avais dans un premier temps choisi
de travailler sur le thème de la rêverie éveillée. En continuant sur cette lancée, j’ai fini par m’intéresser de plus en plus à la question de la couleur et des ornements, non plus comme simples outils créatifs,
mais bien comme de nouveaux moyens de concevoir une narration. Au sein de ce mémoire, la couleur est étudiée en tant que notion principale. Premièrement, elle est rattachée à l’idée de signe, en analogie avec le langage. Ensuite, la « couleur-signe » devient expressive en révélant son potentiel narratif par l’impact qu’elle exerce sur les lecteurs ou spectateurs. La couleur-signe est finalement écrite par le biais des ornements : ceux-ci la modèlent et mettent en valeur sa capacité narrative. Ce mémoire décrira les mécaniques opérées entre couleur et ornement au service d’une narration dans le but de proposer de nouveaux supports plus immersifs, avec une insistance sur l’importance de l’expérience sensorielle, notamment tactile et visuelle.
-
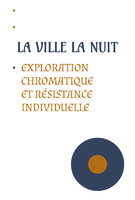 La ville la nuit, exploration chromatique et résistance individuelle
La ville la nuit, exploration chromatique et résistance individuelle Ce mémoire traite des nombreux enjeux liés à la problématique même que constitue la ville la nuit. Il retrace l'histoire de la peur de la nuit pour se diriger vers une poétisation de celle-ci par les moyens du coloristes.
-
 Couleurs de la Méditerranée: Prescriptions chromatiques pour les secteurs de l'architecture et du bien-être.
Couleurs de la Méditerranée: Prescriptions chromatiques pour les secteurs de l'architecture et du bien-être. J’ai choisi le sujet « Les Couleurs de la Méditerranée : Prescription Chromatique pour les secteurs de l’Architecture et le Bien-être » parce que je crois que le monde est de plus en plus dominé par des tons neutres (blancs, gris, noirs), ce qui peut rendre la vie monotone et terne. L’utilisation omniprésente de ces couleurs neutres dans le design et l’architecture modernes conduit souvent à des environnements qui manquent de vivacité et de chaleur, affectant potentiellement notre humeur et notre bien-être général. Mon objectif est de réintroduire des couleurs vives dans nos vies pour inspirer à nouveau le bonheur et l’harmonie avec la nature. En infusant nos espaces de couleurs dynamiques et diversifiées, nous pouvons créer des environnements qui nous stimulent et nous énergisent.
Je suis particulièrement intéressé par l’exploration des couleurs de la région méditerranéenne, réputée pour son ambiance de vacances, ses teintes vibrantes et son atmosphère paisible. La palette méditerranéenne comprend des bleus riches rappelant la mer, des terracottas chauds et des jaunes reflétant les paysages baignés de soleil, ainsi que des verts luxuriants
évoquant la flore abondante. Ces couleurs ne créent pas seulement des environnements esthétiquement plaisants, mais évoquent également un sentiment de détente, de joie et de connexion à la nature.
Mon enquête se concentre sur la question de savoir si l’adoption du style et de la palette de couleurs méditerranéens dans l’architecture peut améliorer notre qualité de vie
et notre bien-être mental, et comment cela peut être mis en œuvre de manière efficace.
Au cours de mes recherches, j’ai examiné les effets de ces couleurs et comment elles peuvent être utilisées dans
divers éléments architecturaux, tels que le design intérieur, les façades extérieures et les espaces publics. De
plus, j’ai exploré des stratégies pratiques pour incorporer les couleurs méditerranéennes dans les pratiques
architecturales modernes, en tenant compte de facteurs comme le climat, le contexte culturel et la durabilité.
Enfin, j’ai conclu et démontré qu’une utilisation délibérée et réfléchie des couleurs peut contribuer de
manière significative à la création d’environnements de vie plus harmonieux et stimulants.
-
 Poétiques du noir pour la conception d’ambiances destinées à la détente
Poétiques du noir pour la conception d’ambiances destinées à la détente Dans le contexte actuel, marqué par la présence croissante des effets de la pollution, qu'elle soit visuelle, lumineuse, sonore ou sensorielle, que ce soit dans les espaces communs ou dans notre intimité, il est impératif d'explorer comment, en tant que designers, nous pouvons enrichir notre quotidien. Il devient essentiel de réhabiliter ces espaces pour qu'ils deviennent des sources de poésie, propices à la détente et au bien-être des usagers quotidiens, qu'ils cessent d'être perçus comme des contraintes et qu'ils deviennent des lieux agréables.
Une question fondamentale se pose : avez-vous déjà perçu cette teinte comme poétique ou sensible ? Vous l'a-t-on déjà décrite ainsi, enfant, adolescent ou adulte ? Cette question, objet de cette étude, se déploie dans une analyse rétrospective des multiples usages du noir jusqu'à nos jours, en accordant une attention particulière à ses qualités esthétiques et ses bienfaits physiques et psychologiques pour la conception d’ambiances destinées à la détente.
Convaincue que la couleur noire peut être porteuse de poésie, nous utiliserons les qualités esthétiques de cette teinte pour créer des paysages immersif et méditatif noirs afin de réhabiliter ces espaces sensoriellement pollués. L'objectif de ce mémoire est de mettre en lumière cette couleur, de lui donner des qualificatifs poétiques et sensibles, en la libérant de son association immédiate avec le luxe ou la neutralité dans la société contemporaine.
-
 Exploration des correspondances entre Couleur, Lumière et Son : étude matérielle et immersive
Exploration des correspondances entre Couleur, Lumière et Son : étude matérielle et immersive Ce mémoire explore les relations entre la couleur, la lumière et le son, en mettant en avant leur interaction matérielle et leur application dans des dispositifs immersifs. Il commence par une analyse de la couleur en tant que matière, en examinant son histoire et les techniques de représentation. La lumière est ensuite explorée, en se concentrant sur l’optique physique et la vision, ainsi que l’effet de la lumière sur la matière ou plus précisément de sa mise en valeur par la lumière. Les caractéristiques du son sont ensuite analysées pour que je puisse mettre en avant les correspondances physiques, physiologiques et biologiques qu’il existe avec la couleur et la lumière. J’examine également les liens linguistiques ainsi que la synesthésie, où les perceptions sensorielles se chevauchent. Des études de cas concrètes de divers artistes et designers sont présentées pour illustrer ces concepts en passant de la scénographie, a des expériences et expérimentations scientifiques où lumière-son et couleur-son interagissent ensemble. Les relations entre la couleur, la lumière presque matérielle, et le son sont mises en avant, sans oublier l’influence de la synesthésie dans l’art. Le but de ce mémoire est d’encourager une approche de conception interdisciplinaire et multisensorielle dans le design.
En intégrant différentes disciplines et en sollicitant plusieurs sens, ce travail vise à montrer comment une telle approche peut enrichir et transformer les pratiques traditionnelles du design.
-
 Auto-construire, c'est s'auto-construire
Auto-construire, c'est s'auto-construire Démarche volontaire et engagée, fruit d’une résistance face à un système souvent impersonnel et aliénant, c’est en choisissant de construire eux-mêmes leur maison que les auto-constructeurs affirment leur capacité à prendre en main leur destin. L’auto-construction apparaît comme bien plus qu’une simple méthode de construction. En offrant la possibilité de se libérer des normes conventionnelles, d’acquérir des compétences et des connaissances, de retrouver une connexion avec son environnement et de s’affirmer dans sa singularité, elle ouvre la voie à de nouvelles formes de liberté et de réalisation de soi. Comment, à travers l’objet d’une maison, d’une cabane, d’une yourte, d’une tiny house ou d’un camion aménagé, la démarche d’auto-construire permet-elle de se construire soi-même ? Comment expliquer le lien entre la création d’un foyer et la création d’un nouveau soi ? L’acquisition de nouveaux champs de compétences et la possibilité de nouveaux échanges permettent-elles de s’émanciper ? Et si oui, de quoi ? Auto-construire, comment est-ce aussi s’auto-construire ?
-
 L'induction matériologique dans l'espace urbain
L'induction matériologique dans l'espace urbain Le monde est en perpétuel mouvement, mais il en va de même pour nos espaces quotidiens, notamment le milieu urbain. En effet, les enjeux de notre société moderne (tel que l’écologie par exemple) demandent au designer de repenser nos espaces en s’adaptant au changement. Afin de comprendre son environnement, le designer doit l’étudier méticuleusement, sous toutes ses formes. Le designer est un artiste-ingénieur, qui mêle l’esthétique à la technique pour proposer des solutions durables. C’est ainsi qu’on peut s’apercevoir que le designer, à l’image de l’archéologue, doit fouiller l’existant, la matière des villes, pour en comprendre l’histoire avant de repenser l’avenir. La matière devient source d’histoire, d’information, grâce à son récit qui lui est propre. Mais la matière devient également source d’échange, de communication et d’expression. Elle incarne la matière physique et tout un univers symbolique, sensoriel. C’est un outil englobant plusieurs domaines, proposant plusieurs outils de recherche favorables au designer. La ville est comme un assemblage de toutes ces matières, ces textures, rassemblées dans le temps et les époques et dont son esthétique actuelle est due à cette composition spatiale réalisée dans l’histoire. Le passé devient source d’inspiration, et l’avenir des espaces urbains devient un projet. Dans cette étude, nous chercherons, à travers les artistes et designers pertinents, à nous interroger sur le rôle du designer et à sa pratique en tant que chercheur-concepteur. A la croisée des domaines, mêlant les facultés, le design devient un art des sciences, capable d’interpréter la matière et de lui redonner vie par un usage du domaine de l’art et du design.
-
 La mise en espace du récit
La mise en espace du récit Dans la création, le texte est souvent en premier et le lieu, le décor, l’espace vient en second. Il est évident pour chacun, que l’adaptation d’un récit littéraire vers l’espace est possible. Mais est-ce que l’inverse est aussi vrai ? L’espace créateur d’un récit et narratif pour lui-même ? Que doit l’espace littéraire à l’espace physique ?
Ma recherche commence par une recherche inductive, notamment par la marche, la collection de données et l’observation – chromatique, sonore, visuelle… – puis dans un second temps, je viens confronter ces données sous forme d’analyse chromatique, de carte sonore afin de faire naître la création. Dans le cadre de ce mémoire, cela a donné lieu à une balade touristique autour d’Alice au Pays des Merveilles et la création d’un jardin axé sur les couleurs de ce conte.
L’espace a sa propre spécificité narrative – échelle, déambulation, chroma, matériaux – qui peut créer une nouvelle manière de faire récit et d’écrire.
L’espace comme altérité de l’écriture ; imaginons une écriture dans la matière, en profondeur, ou un livre uniquement parfumé, où l’odeur raconte. Par ses spécificités narratives, l’espace peut influencer le récit littéraire et tous les autres médiums. Telle une poïétique de l’intermédiaire.
-
 L'Habitat Océanien : un modèle à bâtir
L'Habitat Océanien : un modèle à bâtir Le sujet du logement en Océanie, et plus particulièrement en Nouvelle-Calédonie, a pris une place importante sur la scène politique depuis 2022. Le symposium de 2023 sur le sujet m'a amené à me demander si une approche de designer ne serait pas pertinente puisqu'elle est interdisciplinaire. J'ai décidé d'aborder cette question à travers les modalités interculturelles d'une poïétique endogène en design d'espace calédonien afin de mettre au point un cahier des charges transculturel pour les nouveaux logements locaux et de proposer de nouveaux modèles de construction. Inspirée par l'ethnographie, j'ai élaboré une méthodologie à l’intersection de la science et de l'art, reproductible mais sensible. J'ai échangé avec plusieurs personnes en Nouvelle-Calédonie, j'ai visité leurs habitations et découvert leur mode de vie et leur histoire, tout en me familiarisant avec les pratiques du design social, ce qui a remodelé mon approche.
Il est délicat de définir des modalités transculturelles, car la culture évolue, mais ce document peut être considéré comme une première ébauche, un point de départ pour concevoir de futurs projets et un témoignage sur la culture calédonienne à ce stade de l'histoire.
Cette recherche m'a conduite à une représentation graphique de la dynamique interculturelle calédonienne et à la mise en évidence d'un mode de vie culturel et environnemental partagé. Au regard de mon travail, il apparaît que l'identité culturelle est, dans une certaine mesure, un choix et que des problématiques majeures, essentiellement politiques, restent encore à traiter pour libérer la créativité et la poïétique endogène.
-
 L'enfant au musée, une approche de scénographe?
L'enfant au musée, une approche de scénographe? Dans mes expériences professionnelles en tant que scénographe, j’ai remarqué le lien insuffisant entre les scénographes et les médiateurs dans les musées. Pour moi, le besoin de partager avec tous les publics possibles est au cœur de notre métier. C’est pourquoi j’ai décidé de commencer mes recherches en m’interrogeant, en tant que scénographe, sur mon impact sur les enfants à long terme.
Ce mémoire découle de mes dix années d’expérience avec les enfants, que je considère comme l’avenir, car ils deviendront les adultes de demain. Mes recherches se concentrent sur la pédagogie, et sur les capacités des musées à transmettre les savoirs à leur publics, spécifiquement les enfants, et particulièrement de mon point de vue de scénographe. Les enfants ont-ils une place au musée? Par quelles approches? Quelles en sont les limites? Quels sont les enjeux pour les musées d’accueillir ou non ces jeunes publics ?
Les musées sont des espaces uniques avec des règles spécifiques, servant non seulement de gardiens du passé de l’humanité mais aussi d’expérimentation sociétale pour envisager l’avenir. Mon approche a consisté à commencer par une expérience de terrain mêlant visites et entretiens inspirants, et une première approche de typologie des dispositifs muséaux. Ainsi, mon mémoire est entièrement nourri par ma pratique personnelle, ma position professionnelle et m’a aidé à mieux comprendre mon propre environnement.
Dans cette recherche j’ai essayé de déterminer en quoi les enfants deviennent une source d’inspiration essentielle pour la créativité des concepteurs de musées, et comment ils peuvent en devenir des modèles de conception muséale. Selon moi, faire l’effort de comprendre les capacités cognitives et mémorielles des enfants est significatif lorsque le scénographe veut être innovant pour l’avenir, car il a entre les mains des adultes en devenir. Ainsi comprendre comment ils fonctionnent, permet au scénographe de concevoir des outils et de proposer des solutions plus adaptées et novatrices.
Cette recherche m’a fait prendre conscience de l’impact significatif que les scénographes peuvent avoir sur toutes les générations en partageant efficacement les savoirs et la mémoire des musées, grâce à la médiation et à la vulgarisation à destination des publics. Cette approche enrichit non seulement l’expérience muséale pour les jeunes visiteurs, mais les accompagne à devenir des adultes éclairés et réfléchis.
-
 La question des matériaux écofictionnels comme moteur narratif et structurel pour le design d'espace
La question des matériaux écofictionnels comme moteur narratif et structurel pour le design d'espace La nature et la fiction ont toujours été des intérêts importants et des sujets de recherche passionnants à mes yeux. Les échanges qui s’opèrent entre eux sur les aspects créatifs, sensibles et techniques sont récurrents, c’est la raison de ce travail sur l’étude des points de contacts entre les deux. La problématique étudiée dans ce mémoire est l’utilisation et l’apport de matériaux éco fictionnels comme moteur narratif et structurel pour le design d’espace. Après avoir étudié la place thématique et matérielle de la nature dans l’espace fictionnel, j’ai présenté des arguments pour expliquer en quoi ces matériaux peuvent être bénéfiques et utilisés dans le design d’espace fonctionnel. Ceux-ci sont articulés selon trois grandes approches : la technicité et la conception, la perception et la sensorialité de la nature, et enfin l’aspect psychologique. L’importance et la pertinence de l’étude de ce sujet réside dans son usage à la fois aux conteurs et conteuses, ainsi qu’aux architectes afin de leur permettre de travailler ensemble. La nature approchée par l’angle spécifique fictionnel peut à son tour être transposée à nos propres espaces et nous aider à les repenser, notamment dans une époque marquée par la crise climatique. Des écoles, des étudiantes et étudiants se penchent aussi sur la question telle que l’Umeå School of Architecture de l’université d’ Umeå en Suède, dans une étude intitulée Using Stop Motion Animation to Sketch in Architecture: A practical approach écrite par Ru Zarin, Kent Lindbergh and Prof Daniel Fallman. Les découvertes sur les apports de cette connexion ne sont pas seulement de l’ordre du matériel avec la question de l’éco-conception, mais elles enrichissent aussi notre vision du monde, nos processus créatifs et notre conception de l’espace et de la ville. Par cette recherche, je cherche à pousser le lecteur à s’interroger sur le lien unique qui unit le récit, la nature et l’espace.
-
 Le module naturel
Le module naturel Les Hommes domestiquent la nature en y implantant de la modularité, reflet de leur corps, les émancipant ainsi de leur nature, démontrant d’une relation conflictuelle entre nature et culture. En effet, on a aujourd’hui une opposition entre milieu naturel et milieu urbain qui fait partie intégrante de notre paysage culturel.
L’adaptabilité au milieu naturel demande alors une réflexion sur
le rapport de notre corps avec la nature, donc interroge de fait
l’artificialité de la forme des modules multifonctions. Or ils
sont des vecteurs importants de sensorialités, qui traduisent
diverses perceptions propres à chaque individu. Toutefois
il préexiste une porosité entre notre nature intérieure et la
nature extérieure, le module nécessitant une interaction
avec le corps des Hommes pour pouvoir fonctionner.
 Corps et Intimité : Conception de dispositifs olfactifs Ce mémoire explore la réévaluation des odeurs corporelles, un domaine souvent négligé et stigmatisé dans notre société contemporaine. En revisitant l’importance des odeurs du corps humain à travers une approche interdisciplinaire, nous avons étudié leurs dimensions biologiques, culturelles, artistiques et sociales. Notre recherche commence par une analyse approfondie des bases biologiques et neurobiologiques des odeurs corporelles, explorant comment ces signaux olfactifs sont perçus et interprétés par notre cerveau. Puis nous examinons les tabous culturels et les perceptions sociales qui entourent ces odeurs, révélant leur rôle crucial dans la communication et les interactions interpersonnelles. La seconde partie du mémoire s’intéresse à la création sacrée, artistique et sociale liée aux odeurs corporelles. Nous explorons des pratiques ancestrales de préservation et de purification, telles que la momification en Égypte ancienne et les rituels de guérison chez les Shipibo-Conibo. En étudiant l’usage de l’encens dans diverses traditions asiatiques, nous avons mis en lumière comment les odeurs sont utilisées pour harmoniser l’esprit et le corps, purifiant et élevant l’expérience spirituelle. Un accent particulier a été mis sur la transformation olfactive du corps à travers la chimie des parfums, considérés comme des extensions de l’identité et des outils d’expression artistique et culturelle. Enfin, nous avons abordé la gestion des odeurs dans l’espace public, examinant comment les normes sociales et les technologies influencent notre tolérance et perception des odeurs. Mon projet de diplôme, «Matières à sentir», incarne cette réévaluation en plaçant les odeurs corporelles au cœur d’une installation artistique et sensorielle. Cette œuvre vise à redonner légitimité et valeur à ces odeurs, en explorant leur rôle essentiel dans notre expérience sensorielle et sociale. En somme, ce mémoire invite à une redécouverte des odeurs corporelles, nous poussant à les apprécier non seulement comme des éléments de notre biologie, mais aussi comme des composantes essentielles de notre culture et de notre humanité. Cette approche sensorielle enrichit notre compréhension de l’identité et des interactions humaines, soulignant l’importance des sens dans la formation de nos identités et relations sociales.
Corps et Intimité : Conception de dispositifs olfactifs Ce mémoire explore la réévaluation des odeurs corporelles, un domaine souvent négligé et stigmatisé dans notre société contemporaine. En revisitant l’importance des odeurs du corps humain à travers une approche interdisciplinaire, nous avons étudié leurs dimensions biologiques, culturelles, artistiques et sociales. Notre recherche commence par une analyse approfondie des bases biologiques et neurobiologiques des odeurs corporelles, explorant comment ces signaux olfactifs sont perçus et interprétés par notre cerveau. Puis nous examinons les tabous culturels et les perceptions sociales qui entourent ces odeurs, révélant leur rôle crucial dans la communication et les interactions interpersonnelles. La seconde partie du mémoire s’intéresse à la création sacrée, artistique et sociale liée aux odeurs corporelles. Nous explorons des pratiques ancestrales de préservation et de purification, telles que la momification en Égypte ancienne et les rituels de guérison chez les Shipibo-Conibo. En étudiant l’usage de l’encens dans diverses traditions asiatiques, nous avons mis en lumière comment les odeurs sont utilisées pour harmoniser l’esprit et le corps, purifiant et élevant l’expérience spirituelle. Un accent particulier a été mis sur la transformation olfactive du corps à travers la chimie des parfums, considérés comme des extensions de l’identité et des outils d’expression artistique et culturelle. Enfin, nous avons abordé la gestion des odeurs dans l’espace public, examinant comment les normes sociales et les technologies influencent notre tolérance et perception des odeurs. Mon projet de diplôme, «Matières à sentir», incarne cette réévaluation en plaçant les odeurs corporelles au cœur d’une installation artistique et sensorielle. Cette œuvre vise à redonner légitimité et valeur à ces odeurs, en explorant leur rôle essentiel dans notre expérience sensorielle et sociale. En somme, ce mémoire invite à une redécouverte des odeurs corporelles, nous poussant à les apprécier non seulement comme des éléments de notre biologie, mais aussi comme des composantes essentielles de notre culture et de notre humanité. Cette approche sensorielle enrichit notre compréhension de l’identité et des interactions humaines, soulignant l’importance des sens dans la formation de nos identités et relations sociales.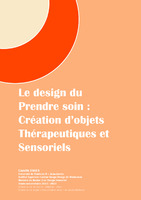 Le design du Prendre soin : Création d’objets Thérapeutiques et Sensoriels Tout au long de cette année, j'ai rencontré des enseignants qui accueillaient dans leurs classes des enfants en situation de handicap, en particulier ceux atteints de Troubles du Spectre l'Autistique. Cela a mis en évidence un besoin urgent d'outils et de solutions pour ces élèves, qui ont souvent du mal à se concentrer en classe. Atteinte du Syndrome de Gilles de la Tourette, je comprends très bien ces difficultés, car j'ai moi - même eu du mal à me concentrer à cause de mes tics durant mes études. Cependant, j'ai constaté que le fait de dessiner ou de manipuler des objets m'aidait à mieux me concentrer. Après ces observations, j'ai axé mes recherches sur le care design. Le livre de Jehanne Dautrey "Design et pensées du care, pour un design des micro luttes et des singularités", publié en 2019, a été un point de départ essentiel. En effet, ce livre m’a mis sur la piste ‘’d’un design soucieux des singularités des personnes autant que celles des situations’’. Grâce à ce livre, ainsi que l’analyse du projet Therapeutique Felt - Tip Pen de Mathieu, Lehanneur (où le design permet d’améliorer le traitement médical en créant un objet ludique pouvant s’apparenter à un jouet), mes recherches se sont précisées. Mes pistes de recherches sur le thème du soin s’élargissent désormais à l’accompagnement, aux objets thérapeutiques, aux gestes automatiques, ou encore à la gradation des émotions. En parallèle, mes recherches se sont également orientées vers l’usage, notamment après avoir étudié le projet CASS d’Adrien, BONNEROT, réalisé en 2011. Ce projet m’a par exemple fait prendre conscience de l’importance qu’il peut y avoir à affubler deux possibilités d’utilisation différentes et donc deux fonctions distinctes à un objet. Effectivement, ce procédé permet d’accompagner l’usager sur deux temps différents et deux besoins différents. Par exemple, dans le cas du projet CASS, ‘‘la première étape consiste à détruire l’objet pour évacuer notre violence, puis, dans un second temps, de le reconstruire afin de détourner l’attention de la frustration initiale et de s’apaiser’’. Dans un troisième temps, le besoin de penser conjointement la préservation de l’environnement et la conception d’un projet design m’ont amenée à étudier la notion d’éco-conception. Pour ce faire, j’ai commencé par m’intéresser au livre d’Ernseto Oroza et de Pénélop De Bozzi intitulé, ‘‘Objets réinventés’’, éditions Alternatives, Paris, publié en 2002. Ce livre m’a ouvert les yeux sur la préciosité des objets du quotidien, mais aussi sur la richesse de ressources matérielles que représentent ces objets parfois délaissés, revendus sur des vides - grenier ou dans des Emmaüs. Suite à la lecture de cet ouvrage, associé à la relecture du projet ‘‘Réanim, la médecine des objets’’ des 5.5 Designers, dans lequel ‘‘les objets courants, trouvés dans les décharges, la rue, chez des particuliers, sont considérés comme des richesses inexploitées et réhabilités par le designer qui devient alors médecin et utilise son savoir-faire pour optimiser l’espérance de vie de ces objets’’, Il m’est apparu que ces recherches étaient centrales dans ma démarche de designer sensoriel, et qu’il me fallait mettre en place des processus de récoltes pour ensuite pouvoir expérimenter et concevoir des objets ayant un impact le plus réduit possible sur l’environnement.
Le design du Prendre soin : Création d’objets Thérapeutiques et Sensoriels Tout au long de cette année, j'ai rencontré des enseignants qui accueillaient dans leurs classes des enfants en situation de handicap, en particulier ceux atteints de Troubles du Spectre l'Autistique. Cela a mis en évidence un besoin urgent d'outils et de solutions pour ces élèves, qui ont souvent du mal à se concentrer en classe. Atteinte du Syndrome de Gilles de la Tourette, je comprends très bien ces difficultés, car j'ai moi - même eu du mal à me concentrer à cause de mes tics durant mes études. Cependant, j'ai constaté que le fait de dessiner ou de manipuler des objets m'aidait à mieux me concentrer. Après ces observations, j'ai axé mes recherches sur le care design. Le livre de Jehanne Dautrey "Design et pensées du care, pour un design des micro luttes et des singularités", publié en 2019, a été un point de départ essentiel. En effet, ce livre m’a mis sur la piste ‘’d’un design soucieux des singularités des personnes autant que celles des situations’’. Grâce à ce livre, ainsi que l’analyse du projet Therapeutique Felt - Tip Pen de Mathieu, Lehanneur (où le design permet d’améliorer le traitement médical en créant un objet ludique pouvant s’apparenter à un jouet), mes recherches se sont précisées. Mes pistes de recherches sur le thème du soin s’élargissent désormais à l’accompagnement, aux objets thérapeutiques, aux gestes automatiques, ou encore à la gradation des émotions. En parallèle, mes recherches se sont également orientées vers l’usage, notamment après avoir étudié le projet CASS d’Adrien, BONNEROT, réalisé en 2011. Ce projet m’a par exemple fait prendre conscience de l’importance qu’il peut y avoir à affubler deux possibilités d’utilisation différentes et donc deux fonctions distinctes à un objet. Effectivement, ce procédé permet d’accompagner l’usager sur deux temps différents et deux besoins différents. Par exemple, dans le cas du projet CASS, ‘‘la première étape consiste à détruire l’objet pour évacuer notre violence, puis, dans un second temps, de le reconstruire afin de détourner l’attention de la frustration initiale et de s’apaiser’’. Dans un troisième temps, le besoin de penser conjointement la préservation de l’environnement et la conception d’un projet design m’ont amenée à étudier la notion d’éco-conception. Pour ce faire, j’ai commencé par m’intéresser au livre d’Ernseto Oroza et de Pénélop De Bozzi intitulé, ‘‘Objets réinventés’’, éditions Alternatives, Paris, publié en 2002. Ce livre m’a ouvert les yeux sur la préciosité des objets du quotidien, mais aussi sur la richesse de ressources matérielles que représentent ces objets parfois délaissés, revendus sur des vides - grenier ou dans des Emmaüs. Suite à la lecture de cet ouvrage, associé à la relecture du projet ‘‘Réanim, la médecine des objets’’ des 5.5 Designers, dans lequel ‘‘les objets courants, trouvés dans les décharges, la rue, chez des particuliers, sont considérés comme des richesses inexploitées et réhabilités par le designer qui devient alors médecin et utilise son savoir-faire pour optimiser l’espérance de vie de ces objets’’, Il m’est apparu que ces recherches étaient centrales dans ma démarche de designer sensoriel, et qu’il me fallait mettre en place des processus de récoltes pour ensuite pouvoir expérimenter et concevoir des objets ayant un impact le plus réduit possible sur l’environnement.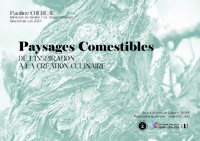 Paysages Comestibles : de l'inspiration à la création culinaire Dans un monde où la quête de durabilité et de reconnection à la nature est plus pressante que jamais, ce mémoire explore comment la fusion entre le paysage et la pratique culinaire ouvre des perspectives innovantes et enrichissantes. À travers une approche multidisciplinaire, nous découvrons comment les paysages, avec leurs cycles naturels et leur richesse sensorielle, peuvent devenir une source inépuisable d’inspiration pour la création culinaire. Ce voyage commence par une exploration du paysage en tant qu’inspiration esthétique et sensorielle, influençant la création culinaire de manière profonde. En nous plongeant dans des environnements naturels et culturels, nous découvrons comment ces contextes peuvent transformer l’expérience culinaire en une aventure immersive et sensorielle. La deuxième partie du mémoire met en lumière le paysage nourricier et culinaire, soulignant l’importance de manger en accord avec le terroir et les saisons. En intégrant le design culinaire, la scénographie et le design global, nous dévoilons la richesse des interactions possibles entre la lumière, le son, les textures et les flaveurs. Enfin, nous plongeons dans la création de paysages comestibles. En tant que paysagiste culinaire, je définis ma posture, mes valeurs et ma méthodologie de création. L’application de ces concepts à mon projet de fin d’étude illustre comment le paysage peut être intégré de manière artistique dans la création culinaire, transformant chaque repas en une œuvre d’art multisensorielle. Ce mémoire propose une nouvelle vision du design culinaire, où chaque plat raconte une histoire, chaque saveur évoque un paysage, et chaque repas devient une célébration des saisons et de la nature. Une lecture essentielle pour quiconque est passionné par l’intersection de l’art, de la nature et de la gastronomie.
Paysages Comestibles : de l'inspiration à la création culinaire Dans un monde où la quête de durabilité et de reconnection à la nature est plus pressante que jamais, ce mémoire explore comment la fusion entre le paysage et la pratique culinaire ouvre des perspectives innovantes et enrichissantes. À travers une approche multidisciplinaire, nous découvrons comment les paysages, avec leurs cycles naturels et leur richesse sensorielle, peuvent devenir une source inépuisable d’inspiration pour la création culinaire. Ce voyage commence par une exploration du paysage en tant qu’inspiration esthétique et sensorielle, influençant la création culinaire de manière profonde. En nous plongeant dans des environnements naturels et culturels, nous découvrons comment ces contextes peuvent transformer l’expérience culinaire en une aventure immersive et sensorielle. La deuxième partie du mémoire met en lumière le paysage nourricier et culinaire, soulignant l’importance de manger en accord avec le terroir et les saisons. En intégrant le design culinaire, la scénographie et le design global, nous dévoilons la richesse des interactions possibles entre la lumière, le son, les textures et les flaveurs. Enfin, nous plongeons dans la création de paysages comestibles. En tant que paysagiste culinaire, je définis ma posture, mes valeurs et ma méthodologie de création. L’application de ces concepts à mon projet de fin d’étude illustre comment le paysage peut être intégré de manière artistique dans la création culinaire, transformant chaque repas en une œuvre d’art multisensorielle. Ce mémoire propose une nouvelle vision du design culinaire, où chaque plat raconte une histoire, chaque saveur évoque un paysage, et chaque repas devient une célébration des saisons et de la nature. Une lecture essentielle pour quiconque est passionné par l’intersection de l’art, de la nature et de la gastronomie. Le toucher la nuit, Potentialité tactile nocturne pour la création de matières atmosphériques Le toucher est le premier des cinq sens à faire son apparition dans le développement du corps humain. Il est fondamental dans notre interaction avec ce qui nous entoure. Le toucher est porteur d’une particularité, pouvant être à la fois un sens physique mais également intangible. Il accède donc à une part d’atmosphérité avec laquelle il entre relationnellement en contact avec les autres. Ce mémoire porte sur l’opportunité que le milieu nocturne apporte au sens du toucher. L’amoindrissement de la vue, la nuit, entraîne une hyperesthésie des sens. Le corps vit des expériences sensorielles plus intenses, la nuit apparaît comme libératrice des mœurs sociales, le toucher est plus vrai, moins réfréné. J’ai initié mon travail à travers la photographie argentique pour capter ces atmosphères nocturnes tactiles, le grain de la photo faisant ressortir des impressions atmosphériques. Comment le toucher peut-il remplacer la vue pour nous guider dans la nuit ? Nous pouvons alors nous interroger : l’opportunité sensorielle nocturne du toucher permet-elle de mobiliser ses différentes typologies tactiles pour la création de matières, génératrices d’atmosphères, dans l’optique d’une meilleure appréhension de la voiture par son utilisateur ?
Le toucher la nuit, Potentialité tactile nocturne pour la création de matières atmosphériques Le toucher est le premier des cinq sens à faire son apparition dans le développement du corps humain. Il est fondamental dans notre interaction avec ce qui nous entoure. Le toucher est porteur d’une particularité, pouvant être à la fois un sens physique mais également intangible. Il accède donc à une part d’atmosphérité avec laquelle il entre relationnellement en contact avec les autres. Ce mémoire porte sur l’opportunité que le milieu nocturne apporte au sens du toucher. L’amoindrissement de la vue, la nuit, entraîne une hyperesthésie des sens. Le corps vit des expériences sensorielles plus intenses, la nuit apparaît comme libératrice des mœurs sociales, le toucher est plus vrai, moins réfréné. J’ai initié mon travail à travers la photographie argentique pour capter ces atmosphères nocturnes tactiles, le grain de la photo faisant ressortir des impressions atmosphériques. Comment le toucher peut-il remplacer la vue pour nous guider dans la nuit ? Nous pouvons alors nous interroger : l’opportunité sensorielle nocturne du toucher permet-elle de mobiliser ses différentes typologies tactiles pour la création de matières, génératrices d’atmosphères, dans l’optique d’une meilleure appréhension de la voiture par son utilisateur ? Études et notations sensorielles pour la conception d'ambiances sonores urbaines Dès l’avènement de l’industrialisation, les bouleversements qui ont eu lieu dans notre environnement sonore ont contribué à l'évolution de notre relation au son, reflétant les changements économiques, technologiques et sociaux de notre société. Dans de nombreuses enquêtes, des scientifiques ont identifié des impacts physiologiques résultant de la surexposition sonore : fatigue, stress, diminution de l'acuité, maux de tête. Malgré ces impacts, le son reste une composante souvent négligée dans la conception architecturale et urbaine. L’environnement sonore devient une préoccupation lorsqu’il est perturbateur et affecte notre qualité de vie. Cette observation met en évidence un écart entre l’évolution de notre patrimoine sonore et notre capacité à concevoir avec ces nouveaux sons. Nos méthodes de conception doivent être repensées pour intégrer pleinement cette dimension sensorielle. Ce mémoire s’interroge donc sur la manière dont les ambiances urbaines sonores ont un impact sur nos sensations physiques et psychologiques. Il tente de comprendre les liens qu'entretient l’Homme avec son environnement sonore afin de trouver des solutions pour améliorer ces constats. Le design apparaît ainsi comme un des moyens de penser la conception urbaine autrement, afin de faciliter la (re)connection de l’Homme à son environnement sonore.
Études et notations sensorielles pour la conception d'ambiances sonores urbaines Dès l’avènement de l’industrialisation, les bouleversements qui ont eu lieu dans notre environnement sonore ont contribué à l'évolution de notre relation au son, reflétant les changements économiques, technologiques et sociaux de notre société. Dans de nombreuses enquêtes, des scientifiques ont identifié des impacts physiologiques résultant de la surexposition sonore : fatigue, stress, diminution de l'acuité, maux de tête. Malgré ces impacts, le son reste une composante souvent négligée dans la conception architecturale et urbaine. L’environnement sonore devient une préoccupation lorsqu’il est perturbateur et affecte notre qualité de vie. Cette observation met en évidence un écart entre l’évolution de notre patrimoine sonore et notre capacité à concevoir avec ces nouveaux sons. Nos méthodes de conception doivent être repensées pour intégrer pleinement cette dimension sensorielle. Ce mémoire s’interroge donc sur la manière dont les ambiances urbaines sonores ont un impact sur nos sensations physiques et psychologiques. Il tente de comprendre les liens qu'entretient l’Homme avec son environnement sonore afin de trouver des solutions pour améliorer ces constats. Le design apparaît ainsi comme un des moyens de penser la conception urbaine autrement, afin de faciliter la (re)connection de l’Homme à son environnement sonore. Couleur Matière-Lumière et Conception d’Ambiances : Création d’Espaces Immersifs L'alliance subtile entre la couleur, la matière et la lumière constitue le cœur de notre expérience visuelle et sensorielle au sein de l'espace. Cette triade ne se limite plus à de simples composantes esthétiques, mais devient un élément clé dans la création d'ambiances immersives, invitant à une exploration novatrice des possibilités infinies. Il ne s'agit plus simplement de créer des intérieurs agréables à l'œil, mais de concevoir des univers où chaque nuance, chaque texture et chaque jeu de lumière orchestrent une symphonie immersive, engageant l'observateur dans un dialogue émotionnel et esthétique. Au cœur de cette réflexion, émerge une interrogation fondamentale : comment la relation dynamique entre couleur, matière et lumière peut-elle être explorée de manière innovante dans le processus de conception d'ambiances pour la création d'espaces immersifs ? Cette question stimule notre imagination et nous incite à repenser les paradigmes établis, à défier les normes et à embrasser une approche où la créativité et l'audace sont les maîtres-mots. Ainsi, plongeons-nous dans l'univers fascinant de la couleur, de la matière et de la lumière, à la recherche de nouvelles façons de concevoir des espaces qui vont au-delà de l'esthétique pour créer des expériences sensorielles. La création d'espaces immersifs devient ainsi le terrain d'expression d'une symbiose artistique, où la magie opère à travers la fusion inventive de ces éléments, transformant les lieux en scènes vivantes qui captivent et transportent.
Couleur Matière-Lumière et Conception d’Ambiances : Création d’Espaces Immersifs L'alliance subtile entre la couleur, la matière et la lumière constitue le cœur de notre expérience visuelle et sensorielle au sein de l'espace. Cette triade ne se limite plus à de simples composantes esthétiques, mais devient un élément clé dans la création d'ambiances immersives, invitant à une exploration novatrice des possibilités infinies. Il ne s'agit plus simplement de créer des intérieurs agréables à l'œil, mais de concevoir des univers où chaque nuance, chaque texture et chaque jeu de lumière orchestrent une symphonie immersive, engageant l'observateur dans un dialogue émotionnel et esthétique. Au cœur de cette réflexion, émerge une interrogation fondamentale : comment la relation dynamique entre couleur, matière et lumière peut-elle être explorée de manière innovante dans le processus de conception d'ambiances pour la création d'espaces immersifs ? Cette question stimule notre imagination et nous incite à repenser les paradigmes établis, à défier les normes et à embrasser une approche où la créativité et l'audace sont les maîtres-mots. Ainsi, plongeons-nous dans l'univers fascinant de la couleur, de la matière et de la lumière, à la recherche de nouvelles façons de concevoir des espaces qui vont au-delà de l'esthétique pour créer des expériences sensorielles. La création d'espaces immersifs devient ainsi le terrain d'expression d'une symbiose artistique, où la magie opère à travers la fusion inventive de ces éléments, transformant les lieux en scènes vivantes qui captivent et transportent. Esthétique du non teint : couleurs naturelles pour une conception durable Dans un monde de plus en plus frénétique, les teintes naturelles émergent comme une réponse à un besoin profond de ralentir. Par leur caractère désaturé et terne, des couleurs comme le beige, le greige et l’écru évoquent une certaine neutralité permettant de se fondre harmonieusement à l’environnement. Ces nuances, qui semblent à première vue peu colorées, pourraient bientôt remplacer le vert comme nouvelle couleur identitaire du développement durable. Entre non-couleur, carnation, couleur de dissimulation et colorant, les états du non-teint sont multiples. Cette recherche vise à mettre en avant le domaine encore peu étudié des couleurs neutres. Par une approche à la fois chromatique, physique, anthropologique et épistémologique mon étude explore les caractéristiques uniques du non-teint, à la croisée entre couleur lumière et couleur matière. Cette esthétique émergente se développe dans un contexte poreux entre production industrielle, pratiques sensibles et durabilité. Ce mémoire de recherche questionne le rôle et la pratique du designer coloriste dans les domaines ultra-normés de l'ingénierie et de l’aéronautique, en apportant un nouveau regard sur la couleur raisonnée. À mesure que les tendances et l'industrie évoluent vers une conception plus durable, les teintes naturelles s'imposent comme la nouvelle palette du designer couleur, matière et finitions.
Esthétique du non teint : couleurs naturelles pour une conception durable Dans un monde de plus en plus frénétique, les teintes naturelles émergent comme une réponse à un besoin profond de ralentir. Par leur caractère désaturé et terne, des couleurs comme le beige, le greige et l’écru évoquent une certaine neutralité permettant de se fondre harmonieusement à l’environnement. Ces nuances, qui semblent à première vue peu colorées, pourraient bientôt remplacer le vert comme nouvelle couleur identitaire du développement durable. Entre non-couleur, carnation, couleur de dissimulation et colorant, les états du non-teint sont multiples. Cette recherche vise à mettre en avant le domaine encore peu étudié des couleurs neutres. Par une approche à la fois chromatique, physique, anthropologique et épistémologique mon étude explore les caractéristiques uniques du non-teint, à la croisée entre couleur lumière et couleur matière. Cette esthétique émergente se développe dans un contexte poreux entre production industrielle, pratiques sensibles et durabilité. Ce mémoire de recherche questionne le rôle et la pratique du designer coloriste dans les domaines ultra-normés de l'ingénierie et de l’aéronautique, en apportant un nouveau regard sur la couleur raisonnée. À mesure que les tendances et l'industrie évoluent vers une conception plus durable, les teintes naturelles s'imposent comme la nouvelle palette du designer couleur, matière et finitions.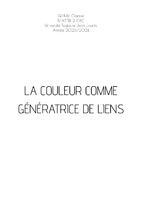 La couleur comme génératrice de liens Comment et en quoi la couleur peut-elle être génératrice de liens?
La couleur comme génératrice de liens Comment et en quoi la couleur peut-elle être génératrice de liens? Récits chromatiques : Le potentiel narratif de la couleur dans l'ornement Intriguée par le fait que nous aimons les histoires, et comment ces histoires peuvent nous inspirer, j’avais dans un premier temps choisi de travailler sur le thème de la rêverie éveillée. En continuant sur cette lancée, j’ai fini par m’intéresser de plus en plus à la question de la couleur et des ornements, non plus comme simples outils créatifs, mais bien comme de nouveaux moyens de concevoir une narration. Au sein de ce mémoire, la couleur est étudiée en tant que notion principale. Premièrement, elle est rattachée à l’idée de signe, en analogie avec le langage. Ensuite, la « couleur-signe » devient expressive en révélant son potentiel narratif par l’impact qu’elle exerce sur les lecteurs ou spectateurs. La couleur-signe est finalement écrite par le biais des ornements : ceux-ci la modèlent et mettent en valeur sa capacité narrative. Ce mémoire décrira les mécaniques opérées entre couleur et ornement au service d’une narration dans le but de proposer de nouveaux supports plus immersifs, avec une insistance sur l’importance de l’expérience sensorielle, notamment tactile et visuelle.
Récits chromatiques : Le potentiel narratif de la couleur dans l'ornement Intriguée par le fait que nous aimons les histoires, et comment ces histoires peuvent nous inspirer, j’avais dans un premier temps choisi de travailler sur le thème de la rêverie éveillée. En continuant sur cette lancée, j’ai fini par m’intéresser de plus en plus à la question de la couleur et des ornements, non plus comme simples outils créatifs, mais bien comme de nouveaux moyens de concevoir une narration. Au sein de ce mémoire, la couleur est étudiée en tant que notion principale. Premièrement, elle est rattachée à l’idée de signe, en analogie avec le langage. Ensuite, la « couleur-signe » devient expressive en révélant son potentiel narratif par l’impact qu’elle exerce sur les lecteurs ou spectateurs. La couleur-signe est finalement écrite par le biais des ornements : ceux-ci la modèlent et mettent en valeur sa capacité narrative. Ce mémoire décrira les mécaniques opérées entre couleur et ornement au service d’une narration dans le but de proposer de nouveaux supports plus immersifs, avec une insistance sur l’importance de l’expérience sensorielle, notamment tactile et visuelle.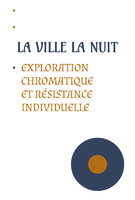 La ville la nuit, exploration chromatique et résistance individuelle Ce mémoire traite des nombreux enjeux liés à la problématique même que constitue la ville la nuit. Il retrace l'histoire de la peur de la nuit pour se diriger vers une poétisation de celle-ci par les moyens du coloristes.
La ville la nuit, exploration chromatique et résistance individuelle Ce mémoire traite des nombreux enjeux liés à la problématique même que constitue la ville la nuit. Il retrace l'histoire de la peur de la nuit pour se diriger vers une poétisation de celle-ci par les moyens du coloristes. Couleurs de la Méditerranée: Prescriptions chromatiques pour les secteurs de l'architecture et du bien-être. J’ai choisi le sujet « Les Couleurs de la Méditerranée : Prescription Chromatique pour les secteurs de l’Architecture et le Bien-être » parce que je crois que le monde est de plus en plus dominé par des tons neutres (blancs, gris, noirs), ce qui peut rendre la vie monotone et terne. L’utilisation omniprésente de ces couleurs neutres dans le design et l’architecture modernes conduit souvent à des environnements qui manquent de vivacité et de chaleur, affectant potentiellement notre humeur et notre bien-être général. Mon objectif est de réintroduire des couleurs vives dans nos vies pour inspirer à nouveau le bonheur et l’harmonie avec la nature. En infusant nos espaces de couleurs dynamiques et diversifiées, nous pouvons créer des environnements qui nous stimulent et nous énergisent. Je suis particulièrement intéressé par l’exploration des couleurs de la région méditerranéenne, réputée pour son ambiance de vacances, ses teintes vibrantes et son atmosphère paisible. La palette méditerranéenne comprend des bleus riches rappelant la mer, des terracottas chauds et des jaunes reflétant les paysages baignés de soleil, ainsi que des verts luxuriants évoquant la flore abondante. Ces couleurs ne créent pas seulement des environnements esthétiquement plaisants, mais évoquent également un sentiment de détente, de joie et de connexion à la nature. Mon enquête se concentre sur la question de savoir si l’adoption du style et de la palette de couleurs méditerranéens dans l’architecture peut améliorer notre qualité de vie et notre bien-être mental, et comment cela peut être mis en œuvre de manière efficace. Au cours de mes recherches, j’ai examiné les effets de ces couleurs et comment elles peuvent être utilisées dans divers éléments architecturaux, tels que le design intérieur, les façades extérieures et les espaces publics. De plus, j’ai exploré des stratégies pratiques pour incorporer les couleurs méditerranéennes dans les pratiques architecturales modernes, en tenant compte de facteurs comme le climat, le contexte culturel et la durabilité. Enfin, j’ai conclu et démontré qu’une utilisation délibérée et réfléchie des couleurs peut contribuer de manière significative à la création d’environnements de vie plus harmonieux et stimulants.
Couleurs de la Méditerranée: Prescriptions chromatiques pour les secteurs de l'architecture et du bien-être. J’ai choisi le sujet « Les Couleurs de la Méditerranée : Prescription Chromatique pour les secteurs de l’Architecture et le Bien-être » parce que je crois que le monde est de plus en plus dominé par des tons neutres (blancs, gris, noirs), ce qui peut rendre la vie monotone et terne. L’utilisation omniprésente de ces couleurs neutres dans le design et l’architecture modernes conduit souvent à des environnements qui manquent de vivacité et de chaleur, affectant potentiellement notre humeur et notre bien-être général. Mon objectif est de réintroduire des couleurs vives dans nos vies pour inspirer à nouveau le bonheur et l’harmonie avec la nature. En infusant nos espaces de couleurs dynamiques et diversifiées, nous pouvons créer des environnements qui nous stimulent et nous énergisent. Je suis particulièrement intéressé par l’exploration des couleurs de la région méditerranéenne, réputée pour son ambiance de vacances, ses teintes vibrantes et son atmosphère paisible. La palette méditerranéenne comprend des bleus riches rappelant la mer, des terracottas chauds et des jaunes reflétant les paysages baignés de soleil, ainsi que des verts luxuriants évoquant la flore abondante. Ces couleurs ne créent pas seulement des environnements esthétiquement plaisants, mais évoquent également un sentiment de détente, de joie et de connexion à la nature. Mon enquête se concentre sur la question de savoir si l’adoption du style et de la palette de couleurs méditerranéens dans l’architecture peut améliorer notre qualité de vie et notre bien-être mental, et comment cela peut être mis en œuvre de manière efficace. Au cours de mes recherches, j’ai examiné les effets de ces couleurs et comment elles peuvent être utilisées dans divers éléments architecturaux, tels que le design intérieur, les façades extérieures et les espaces publics. De plus, j’ai exploré des stratégies pratiques pour incorporer les couleurs méditerranéennes dans les pratiques architecturales modernes, en tenant compte de facteurs comme le climat, le contexte culturel et la durabilité. Enfin, j’ai conclu et démontré qu’une utilisation délibérée et réfléchie des couleurs peut contribuer de manière significative à la création d’environnements de vie plus harmonieux et stimulants. Poétiques du noir pour la conception d’ambiances destinées à la détente Dans le contexte actuel, marqué par la présence croissante des effets de la pollution, qu'elle soit visuelle, lumineuse, sonore ou sensorielle, que ce soit dans les espaces communs ou dans notre intimité, il est impératif d'explorer comment, en tant que designers, nous pouvons enrichir notre quotidien. Il devient essentiel de réhabiliter ces espaces pour qu'ils deviennent des sources de poésie, propices à la détente et au bien-être des usagers quotidiens, qu'ils cessent d'être perçus comme des contraintes et qu'ils deviennent des lieux agréables. Une question fondamentale se pose : avez-vous déjà perçu cette teinte comme poétique ou sensible ? Vous l'a-t-on déjà décrite ainsi, enfant, adolescent ou adulte ? Cette question, objet de cette étude, se déploie dans une analyse rétrospective des multiples usages du noir jusqu'à nos jours, en accordant une attention particulière à ses qualités esthétiques et ses bienfaits physiques et psychologiques pour la conception d’ambiances destinées à la détente. Convaincue que la couleur noire peut être porteuse de poésie, nous utiliserons les qualités esthétiques de cette teinte pour créer des paysages immersif et méditatif noirs afin de réhabiliter ces espaces sensoriellement pollués. L'objectif de ce mémoire est de mettre en lumière cette couleur, de lui donner des qualificatifs poétiques et sensibles, en la libérant de son association immédiate avec le luxe ou la neutralité dans la société contemporaine.
Poétiques du noir pour la conception d’ambiances destinées à la détente Dans le contexte actuel, marqué par la présence croissante des effets de la pollution, qu'elle soit visuelle, lumineuse, sonore ou sensorielle, que ce soit dans les espaces communs ou dans notre intimité, il est impératif d'explorer comment, en tant que designers, nous pouvons enrichir notre quotidien. Il devient essentiel de réhabiliter ces espaces pour qu'ils deviennent des sources de poésie, propices à la détente et au bien-être des usagers quotidiens, qu'ils cessent d'être perçus comme des contraintes et qu'ils deviennent des lieux agréables. Une question fondamentale se pose : avez-vous déjà perçu cette teinte comme poétique ou sensible ? Vous l'a-t-on déjà décrite ainsi, enfant, adolescent ou adulte ? Cette question, objet de cette étude, se déploie dans une analyse rétrospective des multiples usages du noir jusqu'à nos jours, en accordant une attention particulière à ses qualités esthétiques et ses bienfaits physiques et psychologiques pour la conception d’ambiances destinées à la détente. Convaincue que la couleur noire peut être porteuse de poésie, nous utiliserons les qualités esthétiques de cette teinte pour créer des paysages immersif et méditatif noirs afin de réhabiliter ces espaces sensoriellement pollués. L'objectif de ce mémoire est de mettre en lumière cette couleur, de lui donner des qualificatifs poétiques et sensibles, en la libérant de son association immédiate avec le luxe ou la neutralité dans la société contemporaine. Exploration des correspondances entre Couleur, Lumière et Son : étude matérielle et immersive Ce mémoire explore les relations entre la couleur, la lumière et le son, en mettant en avant leur interaction matérielle et leur application dans des dispositifs immersifs. Il commence par une analyse de la couleur en tant que matière, en examinant son histoire et les techniques de représentation. La lumière est ensuite explorée, en se concentrant sur l’optique physique et la vision, ainsi que l’effet de la lumière sur la matière ou plus précisément de sa mise en valeur par la lumière. Les caractéristiques du son sont ensuite analysées pour que je puisse mettre en avant les correspondances physiques, physiologiques et biologiques qu’il existe avec la couleur et la lumière. J’examine également les liens linguistiques ainsi que la synesthésie, où les perceptions sensorielles se chevauchent. Des études de cas concrètes de divers artistes et designers sont présentées pour illustrer ces concepts en passant de la scénographie, a des expériences et expérimentations scientifiques où lumière-son et couleur-son interagissent ensemble. Les relations entre la couleur, la lumière presque matérielle, et le son sont mises en avant, sans oublier l’influence de la synesthésie dans l’art. Le but de ce mémoire est d’encourager une approche de conception interdisciplinaire et multisensorielle dans le design. En intégrant différentes disciplines et en sollicitant plusieurs sens, ce travail vise à montrer comment une telle approche peut enrichir et transformer les pratiques traditionnelles du design.
Exploration des correspondances entre Couleur, Lumière et Son : étude matérielle et immersive Ce mémoire explore les relations entre la couleur, la lumière et le son, en mettant en avant leur interaction matérielle et leur application dans des dispositifs immersifs. Il commence par une analyse de la couleur en tant que matière, en examinant son histoire et les techniques de représentation. La lumière est ensuite explorée, en se concentrant sur l’optique physique et la vision, ainsi que l’effet de la lumière sur la matière ou plus précisément de sa mise en valeur par la lumière. Les caractéristiques du son sont ensuite analysées pour que je puisse mettre en avant les correspondances physiques, physiologiques et biologiques qu’il existe avec la couleur et la lumière. J’examine également les liens linguistiques ainsi que la synesthésie, où les perceptions sensorielles se chevauchent. Des études de cas concrètes de divers artistes et designers sont présentées pour illustrer ces concepts en passant de la scénographie, a des expériences et expérimentations scientifiques où lumière-son et couleur-son interagissent ensemble. Les relations entre la couleur, la lumière presque matérielle, et le son sont mises en avant, sans oublier l’influence de la synesthésie dans l’art. Le but de ce mémoire est d’encourager une approche de conception interdisciplinaire et multisensorielle dans le design. En intégrant différentes disciplines et en sollicitant plusieurs sens, ce travail vise à montrer comment une telle approche peut enrichir et transformer les pratiques traditionnelles du design. Auto-construire, c'est s'auto-construire Démarche volontaire et engagée, fruit d’une résistance face à un système souvent impersonnel et aliénant, c’est en choisissant de construire eux-mêmes leur maison que les auto-constructeurs affirment leur capacité à prendre en main leur destin. L’auto-construction apparaît comme bien plus qu’une simple méthode de construction. En offrant la possibilité de se libérer des normes conventionnelles, d’acquérir des compétences et des connaissances, de retrouver une connexion avec son environnement et de s’affirmer dans sa singularité, elle ouvre la voie à de nouvelles formes de liberté et de réalisation de soi. Comment, à travers l’objet d’une maison, d’une cabane, d’une yourte, d’une tiny house ou d’un camion aménagé, la démarche d’auto-construire permet-elle de se construire soi-même ? Comment expliquer le lien entre la création d’un foyer et la création d’un nouveau soi ? L’acquisition de nouveaux champs de compétences et la possibilité de nouveaux échanges permettent-elles de s’émanciper ? Et si oui, de quoi ? Auto-construire, comment est-ce aussi s’auto-construire ?
Auto-construire, c'est s'auto-construire Démarche volontaire et engagée, fruit d’une résistance face à un système souvent impersonnel et aliénant, c’est en choisissant de construire eux-mêmes leur maison que les auto-constructeurs affirment leur capacité à prendre en main leur destin. L’auto-construction apparaît comme bien plus qu’une simple méthode de construction. En offrant la possibilité de se libérer des normes conventionnelles, d’acquérir des compétences et des connaissances, de retrouver une connexion avec son environnement et de s’affirmer dans sa singularité, elle ouvre la voie à de nouvelles formes de liberté et de réalisation de soi. Comment, à travers l’objet d’une maison, d’une cabane, d’une yourte, d’une tiny house ou d’un camion aménagé, la démarche d’auto-construire permet-elle de se construire soi-même ? Comment expliquer le lien entre la création d’un foyer et la création d’un nouveau soi ? L’acquisition de nouveaux champs de compétences et la possibilité de nouveaux échanges permettent-elles de s’émanciper ? Et si oui, de quoi ? Auto-construire, comment est-ce aussi s’auto-construire ? L'induction matériologique dans l'espace urbain Le monde est en perpétuel mouvement, mais il en va de même pour nos espaces quotidiens, notamment le milieu urbain. En effet, les enjeux de notre société moderne (tel que l’écologie par exemple) demandent au designer de repenser nos espaces en s’adaptant au changement. Afin de comprendre son environnement, le designer doit l’étudier méticuleusement, sous toutes ses formes. Le designer est un artiste-ingénieur, qui mêle l’esthétique à la technique pour proposer des solutions durables. C’est ainsi qu’on peut s’apercevoir que le designer, à l’image de l’archéologue, doit fouiller l’existant, la matière des villes, pour en comprendre l’histoire avant de repenser l’avenir. La matière devient source d’histoire, d’information, grâce à son récit qui lui est propre. Mais la matière devient également source d’échange, de communication et d’expression. Elle incarne la matière physique et tout un univers symbolique, sensoriel. C’est un outil englobant plusieurs domaines, proposant plusieurs outils de recherche favorables au designer. La ville est comme un assemblage de toutes ces matières, ces textures, rassemblées dans le temps et les époques et dont son esthétique actuelle est due à cette composition spatiale réalisée dans l’histoire. Le passé devient source d’inspiration, et l’avenir des espaces urbains devient un projet. Dans cette étude, nous chercherons, à travers les artistes et designers pertinents, à nous interroger sur le rôle du designer et à sa pratique en tant que chercheur-concepteur. A la croisée des domaines, mêlant les facultés, le design devient un art des sciences, capable d’interpréter la matière et de lui redonner vie par un usage du domaine de l’art et du design.
L'induction matériologique dans l'espace urbain Le monde est en perpétuel mouvement, mais il en va de même pour nos espaces quotidiens, notamment le milieu urbain. En effet, les enjeux de notre société moderne (tel que l’écologie par exemple) demandent au designer de repenser nos espaces en s’adaptant au changement. Afin de comprendre son environnement, le designer doit l’étudier méticuleusement, sous toutes ses formes. Le designer est un artiste-ingénieur, qui mêle l’esthétique à la technique pour proposer des solutions durables. C’est ainsi qu’on peut s’apercevoir que le designer, à l’image de l’archéologue, doit fouiller l’existant, la matière des villes, pour en comprendre l’histoire avant de repenser l’avenir. La matière devient source d’histoire, d’information, grâce à son récit qui lui est propre. Mais la matière devient également source d’échange, de communication et d’expression. Elle incarne la matière physique et tout un univers symbolique, sensoriel. C’est un outil englobant plusieurs domaines, proposant plusieurs outils de recherche favorables au designer. La ville est comme un assemblage de toutes ces matières, ces textures, rassemblées dans le temps et les époques et dont son esthétique actuelle est due à cette composition spatiale réalisée dans l’histoire. Le passé devient source d’inspiration, et l’avenir des espaces urbains devient un projet. Dans cette étude, nous chercherons, à travers les artistes et designers pertinents, à nous interroger sur le rôle du designer et à sa pratique en tant que chercheur-concepteur. A la croisée des domaines, mêlant les facultés, le design devient un art des sciences, capable d’interpréter la matière et de lui redonner vie par un usage du domaine de l’art et du design. La mise en espace du récit Dans la création, le texte est souvent en premier et le lieu, le décor, l’espace vient en second. Il est évident pour chacun, que l’adaptation d’un récit littéraire vers l’espace est possible. Mais est-ce que l’inverse est aussi vrai ? L’espace créateur d’un récit et narratif pour lui-même ? Que doit l’espace littéraire à l’espace physique ? Ma recherche commence par une recherche inductive, notamment par la marche, la collection de données et l’observation – chromatique, sonore, visuelle… – puis dans un second temps, je viens confronter ces données sous forme d’analyse chromatique, de carte sonore afin de faire naître la création. Dans le cadre de ce mémoire, cela a donné lieu à une balade touristique autour d’Alice au Pays des Merveilles et la création d’un jardin axé sur les couleurs de ce conte. L’espace a sa propre spécificité narrative – échelle, déambulation, chroma, matériaux – qui peut créer une nouvelle manière de faire récit et d’écrire. L’espace comme altérité de l’écriture ; imaginons une écriture dans la matière, en profondeur, ou un livre uniquement parfumé, où l’odeur raconte. Par ses spécificités narratives, l’espace peut influencer le récit littéraire et tous les autres médiums. Telle une poïétique de l’intermédiaire.
La mise en espace du récit Dans la création, le texte est souvent en premier et le lieu, le décor, l’espace vient en second. Il est évident pour chacun, que l’adaptation d’un récit littéraire vers l’espace est possible. Mais est-ce que l’inverse est aussi vrai ? L’espace créateur d’un récit et narratif pour lui-même ? Que doit l’espace littéraire à l’espace physique ? Ma recherche commence par une recherche inductive, notamment par la marche, la collection de données et l’observation – chromatique, sonore, visuelle… – puis dans un second temps, je viens confronter ces données sous forme d’analyse chromatique, de carte sonore afin de faire naître la création. Dans le cadre de ce mémoire, cela a donné lieu à une balade touristique autour d’Alice au Pays des Merveilles et la création d’un jardin axé sur les couleurs de ce conte. L’espace a sa propre spécificité narrative – échelle, déambulation, chroma, matériaux – qui peut créer une nouvelle manière de faire récit et d’écrire. L’espace comme altérité de l’écriture ; imaginons une écriture dans la matière, en profondeur, ou un livre uniquement parfumé, où l’odeur raconte. Par ses spécificités narratives, l’espace peut influencer le récit littéraire et tous les autres médiums. Telle une poïétique de l’intermédiaire. L'Habitat Océanien : un modèle à bâtir Le sujet du logement en Océanie, et plus particulièrement en Nouvelle-Calédonie, a pris une place importante sur la scène politique depuis 2022. Le symposium de 2023 sur le sujet m'a amené à me demander si une approche de designer ne serait pas pertinente puisqu'elle est interdisciplinaire. J'ai décidé d'aborder cette question à travers les modalités interculturelles d'une poïétique endogène en design d'espace calédonien afin de mettre au point un cahier des charges transculturel pour les nouveaux logements locaux et de proposer de nouveaux modèles de construction. Inspirée par l'ethnographie, j'ai élaboré une méthodologie à l’intersection de la science et de l'art, reproductible mais sensible. J'ai échangé avec plusieurs personnes en Nouvelle-Calédonie, j'ai visité leurs habitations et découvert leur mode de vie et leur histoire, tout en me familiarisant avec les pratiques du design social, ce qui a remodelé mon approche. Il est délicat de définir des modalités transculturelles, car la culture évolue, mais ce document peut être considéré comme une première ébauche, un point de départ pour concevoir de futurs projets et un témoignage sur la culture calédonienne à ce stade de l'histoire. Cette recherche m'a conduite à une représentation graphique de la dynamique interculturelle calédonienne et à la mise en évidence d'un mode de vie culturel et environnemental partagé. Au regard de mon travail, il apparaît que l'identité culturelle est, dans une certaine mesure, un choix et que des problématiques majeures, essentiellement politiques, restent encore à traiter pour libérer la créativité et la poïétique endogène.
L'Habitat Océanien : un modèle à bâtir Le sujet du logement en Océanie, et plus particulièrement en Nouvelle-Calédonie, a pris une place importante sur la scène politique depuis 2022. Le symposium de 2023 sur le sujet m'a amené à me demander si une approche de designer ne serait pas pertinente puisqu'elle est interdisciplinaire. J'ai décidé d'aborder cette question à travers les modalités interculturelles d'une poïétique endogène en design d'espace calédonien afin de mettre au point un cahier des charges transculturel pour les nouveaux logements locaux et de proposer de nouveaux modèles de construction. Inspirée par l'ethnographie, j'ai élaboré une méthodologie à l’intersection de la science et de l'art, reproductible mais sensible. J'ai échangé avec plusieurs personnes en Nouvelle-Calédonie, j'ai visité leurs habitations et découvert leur mode de vie et leur histoire, tout en me familiarisant avec les pratiques du design social, ce qui a remodelé mon approche. Il est délicat de définir des modalités transculturelles, car la culture évolue, mais ce document peut être considéré comme une première ébauche, un point de départ pour concevoir de futurs projets et un témoignage sur la culture calédonienne à ce stade de l'histoire. Cette recherche m'a conduite à une représentation graphique de la dynamique interculturelle calédonienne et à la mise en évidence d'un mode de vie culturel et environnemental partagé. Au regard de mon travail, il apparaît que l'identité culturelle est, dans une certaine mesure, un choix et que des problématiques majeures, essentiellement politiques, restent encore à traiter pour libérer la créativité et la poïétique endogène. L'enfant au musée, une approche de scénographe? Dans mes expériences professionnelles en tant que scénographe, j’ai remarqué le lien insuffisant entre les scénographes et les médiateurs dans les musées. Pour moi, le besoin de partager avec tous les publics possibles est au cœur de notre métier. C’est pourquoi j’ai décidé de commencer mes recherches en m’interrogeant, en tant que scénographe, sur mon impact sur les enfants à long terme. Ce mémoire découle de mes dix années d’expérience avec les enfants, que je considère comme l’avenir, car ils deviendront les adultes de demain. Mes recherches se concentrent sur la pédagogie, et sur les capacités des musées à transmettre les savoirs à leur publics, spécifiquement les enfants, et particulièrement de mon point de vue de scénographe. Les enfants ont-ils une place au musée? Par quelles approches? Quelles en sont les limites? Quels sont les enjeux pour les musées d’accueillir ou non ces jeunes publics ? Les musées sont des espaces uniques avec des règles spécifiques, servant non seulement de gardiens du passé de l’humanité mais aussi d’expérimentation sociétale pour envisager l’avenir. Mon approche a consisté à commencer par une expérience de terrain mêlant visites et entretiens inspirants, et une première approche de typologie des dispositifs muséaux. Ainsi, mon mémoire est entièrement nourri par ma pratique personnelle, ma position professionnelle et m’a aidé à mieux comprendre mon propre environnement. Dans cette recherche j’ai essayé de déterminer en quoi les enfants deviennent une source d’inspiration essentielle pour la créativité des concepteurs de musées, et comment ils peuvent en devenir des modèles de conception muséale. Selon moi, faire l’effort de comprendre les capacités cognitives et mémorielles des enfants est significatif lorsque le scénographe veut être innovant pour l’avenir, car il a entre les mains des adultes en devenir. Ainsi comprendre comment ils fonctionnent, permet au scénographe de concevoir des outils et de proposer des solutions plus adaptées et novatrices. Cette recherche m’a fait prendre conscience de l’impact significatif que les scénographes peuvent avoir sur toutes les générations en partageant efficacement les savoirs et la mémoire des musées, grâce à la médiation et à la vulgarisation à destination des publics. Cette approche enrichit non seulement l’expérience muséale pour les jeunes visiteurs, mais les accompagne à devenir des adultes éclairés et réfléchis.
L'enfant au musée, une approche de scénographe? Dans mes expériences professionnelles en tant que scénographe, j’ai remarqué le lien insuffisant entre les scénographes et les médiateurs dans les musées. Pour moi, le besoin de partager avec tous les publics possibles est au cœur de notre métier. C’est pourquoi j’ai décidé de commencer mes recherches en m’interrogeant, en tant que scénographe, sur mon impact sur les enfants à long terme. Ce mémoire découle de mes dix années d’expérience avec les enfants, que je considère comme l’avenir, car ils deviendront les adultes de demain. Mes recherches se concentrent sur la pédagogie, et sur les capacités des musées à transmettre les savoirs à leur publics, spécifiquement les enfants, et particulièrement de mon point de vue de scénographe. Les enfants ont-ils une place au musée? Par quelles approches? Quelles en sont les limites? Quels sont les enjeux pour les musées d’accueillir ou non ces jeunes publics ? Les musées sont des espaces uniques avec des règles spécifiques, servant non seulement de gardiens du passé de l’humanité mais aussi d’expérimentation sociétale pour envisager l’avenir. Mon approche a consisté à commencer par une expérience de terrain mêlant visites et entretiens inspirants, et une première approche de typologie des dispositifs muséaux. Ainsi, mon mémoire est entièrement nourri par ma pratique personnelle, ma position professionnelle et m’a aidé à mieux comprendre mon propre environnement. Dans cette recherche j’ai essayé de déterminer en quoi les enfants deviennent une source d’inspiration essentielle pour la créativité des concepteurs de musées, et comment ils peuvent en devenir des modèles de conception muséale. Selon moi, faire l’effort de comprendre les capacités cognitives et mémorielles des enfants est significatif lorsque le scénographe veut être innovant pour l’avenir, car il a entre les mains des adultes en devenir. Ainsi comprendre comment ils fonctionnent, permet au scénographe de concevoir des outils et de proposer des solutions plus adaptées et novatrices. Cette recherche m’a fait prendre conscience de l’impact significatif que les scénographes peuvent avoir sur toutes les générations en partageant efficacement les savoirs et la mémoire des musées, grâce à la médiation et à la vulgarisation à destination des publics. Cette approche enrichit non seulement l’expérience muséale pour les jeunes visiteurs, mais les accompagne à devenir des adultes éclairés et réfléchis. La question des matériaux écofictionnels comme moteur narratif et structurel pour le design d'espace La nature et la fiction ont toujours été des intérêts importants et des sujets de recherche passionnants à mes yeux. Les échanges qui s’opèrent entre eux sur les aspects créatifs, sensibles et techniques sont récurrents, c’est la raison de ce travail sur l’étude des points de contacts entre les deux. La problématique étudiée dans ce mémoire est l’utilisation et l’apport de matériaux éco fictionnels comme moteur narratif et structurel pour le design d’espace. Après avoir étudié la place thématique et matérielle de la nature dans l’espace fictionnel, j’ai présenté des arguments pour expliquer en quoi ces matériaux peuvent être bénéfiques et utilisés dans le design d’espace fonctionnel. Ceux-ci sont articulés selon trois grandes approches : la technicité et la conception, la perception et la sensorialité de la nature, et enfin l’aspect psychologique. L’importance et la pertinence de l’étude de ce sujet réside dans son usage à la fois aux conteurs et conteuses, ainsi qu’aux architectes afin de leur permettre de travailler ensemble. La nature approchée par l’angle spécifique fictionnel peut à son tour être transposée à nos propres espaces et nous aider à les repenser, notamment dans une époque marquée par la crise climatique. Des écoles, des étudiantes et étudiants se penchent aussi sur la question telle que l’Umeå School of Architecture de l’université d’ Umeå en Suède, dans une étude intitulée Using Stop Motion Animation to Sketch in Architecture: A practical approach écrite par Ru Zarin, Kent Lindbergh and Prof Daniel Fallman. Les découvertes sur les apports de cette connexion ne sont pas seulement de l’ordre du matériel avec la question de l’éco-conception, mais elles enrichissent aussi notre vision du monde, nos processus créatifs et notre conception de l’espace et de la ville. Par cette recherche, je cherche à pousser le lecteur à s’interroger sur le lien unique qui unit le récit, la nature et l’espace.
La question des matériaux écofictionnels comme moteur narratif et structurel pour le design d'espace La nature et la fiction ont toujours été des intérêts importants et des sujets de recherche passionnants à mes yeux. Les échanges qui s’opèrent entre eux sur les aspects créatifs, sensibles et techniques sont récurrents, c’est la raison de ce travail sur l’étude des points de contacts entre les deux. La problématique étudiée dans ce mémoire est l’utilisation et l’apport de matériaux éco fictionnels comme moteur narratif et structurel pour le design d’espace. Après avoir étudié la place thématique et matérielle de la nature dans l’espace fictionnel, j’ai présenté des arguments pour expliquer en quoi ces matériaux peuvent être bénéfiques et utilisés dans le design d’espace fonctionnel. Ceux-ci sont articulés selon trois grandes approches : la technicité et la conception, la perception et la sensorialité de la nature, et enfin l’aspect psychologique. L’importance et la pertinence de l’étude de ce sujet réside dans son usage à la fois aux conteurs et conteuses, ainsi qu’aux architectes afin de leur permettre de travailler ensemble. La nature approchée par l’angle spécifique fictionnel peut à son tour être transposée à nos propres espaces et nous aider à les repenser, notamment dans une époque marquée par la crise climatique. Des écoles, des étudiantes et étudiants se penchent aussi sur la question telle que l’Umeå School of Architecture de l’université d’ Umeå en Suède, dans une étude intitulée Using Stop Motion Animation to Sketch in Architecture: A practical approach écrite par Ru Zarin, Kent Lindbergh and Prof Daniel Fallman. Les découvertes sur les apports de cette connexion ne sont pas seulement de l’ordre du matériel avec la question de l’éco-conception, mais elles enrichissent aussi notre vision du monde, nos processus créatifs et notre conception de l’espace et de la ville. Par cette recherche, je cherche à pousser le lecteur à s’interroger sur le lien unique qui unit le récit, la nature et l’espace. Le module naturel Les Hommes domestiquent la nature en y implantant de la modularité, reflet de leur corps, les émancipant ainsi de leur nature, démontrant d’une relation conflictuelle entre nature et culture. En effet, on a aujourd’hui une opposition entre milieu naturel et milieu urbain qui fait partie intégrante de notre paysage culturel. L’adaptabilité au milieu naturel demande alors une réflexion sur le rapport de notre corps avec la nature, donc interroge de fait l’artificialité de la forme des modules multifonctions. Or ils sont des vecteurs importants de sensorialités, qui traduisent diverses perceptions propres à chaque individu. Toutefois il préexiste une porosité entre notre nature intérieure et la nature extérieure, le module nécessitant une interaction avec le corps des Hommes pour pouvoir fonctionner.
Le module naturel Les Hommes domestiquent la nature en y implantant de la modularité, reflet de leur corps, les émancipant ainsi de leur nature, démontrant d’une relation conflictuelle entre nature et culture. En effet, on a aujourd’hui une opposition entre milieu naturel et milieu urbain qui fait partie intégrante de notre paysage culturel. L’adaptabilité au milieu naturel demande alors une réflexion sur le rapport de notre corps avec la nature, donc interroge de fait l’artificialité de la forme des modules multifonctions. Or ils sont des vecteurs importants de sensorialités, qui traduisent diverses perceptions propres à chaque individu. Toutefois il préexiste une porosité entre notre nature intérieure et la nature extérieure, le module nécessitant une interaction avec le corps des Hommes pour pouvoir fonctionner.